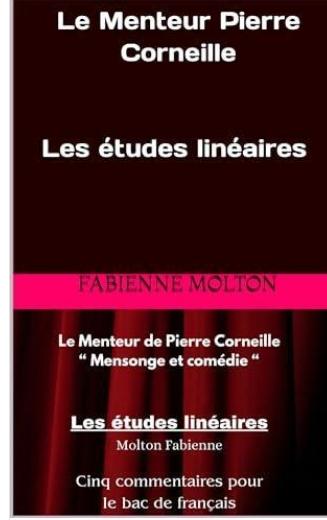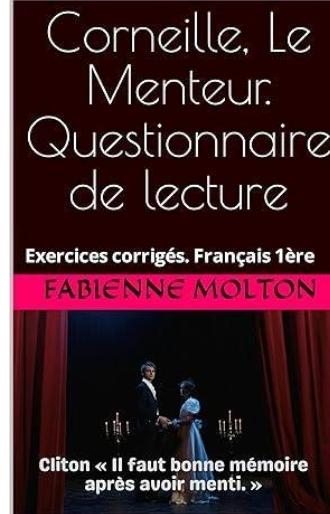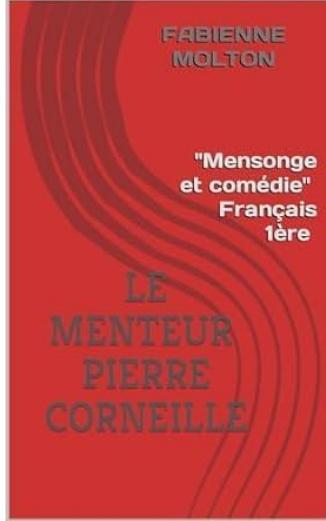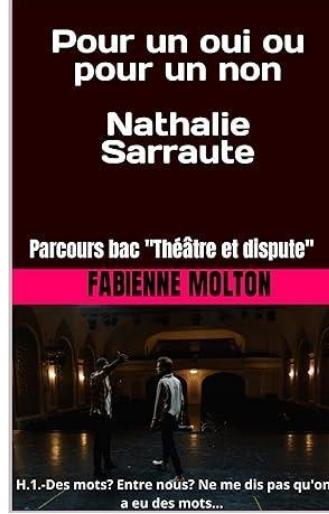Le personnage adjuvant, Camus, Claudel, Gary : question sur corpus

Corpus : Camus, Gary, Claudel
*** Le personnage adjuvant
Objet d'étude : le roman et ses personnages
Texte 1
Une épidémie de peste sévit à Oran, en Algérie, dans les années quarante. Lorsque le fléau disparaît enfin, il fait une dernière victime en la personne de Tarrou, l'ami du médecin Rieux, le héros du roman.
À midi, la fièvre était à son sommet. Une sorte de toux viscérale secouait le corps du malade qui commença seulement à cracher du sang. Les ganglions avaient cessé d'enfler. Ils étaient toujours là, durs comme des écrous, vissés dans le creux des articulations, et Rieux jugea impossible de les ouvrir. Dans les intervalles de la fièvre et de la toux, Tarrou de loin en loin regardait encore ses amis. Mais, bientôt, ses yeux s'ouvrirent de moins en moins souvent, et la lumière qui venait alors éclairer sa face dévastée se fit plus pâle à chaque fois. L'orage qui secouait ce corps de soubresauts convulsifs l'illuminait d'éclairs de plus en plus rares et Tarrou dérivait lentement au fond de cette tempête. Rieux n'avait plus devant lui qu'un masque désormais inerte où le sourire avait disparu. Cette forme humaine qui lui avait été si proche, percée maintenant de coups d'épieu, brûlée par un mal surhumain, tordue par tous les vents haineux du ciel, s'immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste et il ne pouvait rien contre ce naufrage. Il devait rester sur le rivage, les mains vides et le cœur tordu, sans armes et sans recours, une fois de plus, contre ce désastre. Et à la fin, ce furent bien les larmes de l'impuissance qui empêchèrent Rieux de voir Tarrou se tourner brusquement contre le mur, et expirer dans une plainte creuse, comme si, quelque part en lui, une corde essentielle s'était rompue. La nuit qui suivit ne fut pas celle de la lutte, mais celle du silence. Dans cette chambre retranchée du monde, au-dessus de ce corps mort maintenant habillé, Rieux sentit planer le calme surprenant qui, bien des nuits auparavant, sur les terrasses au-dessus de la peste, avait suivi l'attaque des portes. Déjà, à cette époque, il avait pensé à ce silence qui s'élevait des lits où il avait laissé mourir des hommes. C'était partout la même pause, le même intervalle solennel, toujours le même apaisement qui suivait les combats, c'était le silence de la défaite. Mais pour celui qui enveloppait maintenant son ami, il était si compact, il s'accordait si étroitement au silence des rues et de la ville libérée de la peste, que Rieux sentait bien qu'il s'agissait cette fois de la défaite définitive, celle qui termine les guerres et fait de la paix elle-même une souffrance sans guérison. Le docteur ne savait pas si, pour finir, Tarrou avait retrouvé la paix, mais, dans ce moment tout au moins, il croyait savoir qu'il n'y aurait plus jamais de paix possible pour lui-même, pas plus qu'il n'y a d'armistice pour la mère amputée de son fils ou pour l'homme qui ensevelit son ami.
Albert Camus, La Peste, 1947.
Texte 2
Romain, alors qu'il est lycéen, découvre un jour sa mère en proie à un malaise et apprend ainsi qu'elle est diabétique.
Je sentis qu'il fallait me dépêcher, qu'il me fallait en toute hâte écrire le chef-d'œuvre immortel, lequel, en faisant de moi le plus jeune Tolstoï de tous les temps, me permettrait d'apporter immédiatement à ma mère la récompense de ses peines et le couronnement de sa vie. Je m'attelai d'arrache-pied à la besogne. Avec l'accord de ma mère, j'abandonnai provisoirement le lycée, et, m'enfermant une fois de plus dans ma chambre, me ruai à l'assaut. Je plaçai devant moi trois mille feuilles de papier blanc, ce qui était, d'après mes calculs, l'équivalent de Guerre et Paix, et ma mère m'offrit une robe de chambre très ample, modelée sur celle qui avait fait déjà la réputation de Balzac. Cinq fois par jour, elle entrouvrait la porte, déposait sur la table un plateau de victuailles et ressortait sur la pointe des pieds. J'écrivais alors sous le pseudonyme de François Mermont. Cependant, comme mes œuvres m'étaient régulièrement renvoyées par les éditeurs, nous décidâmes que le pseudonyme était mauvais, et j'écrivis le volume suivant sous le nom de Lucien Brûlard. Ce pseudonyme ne paraissait pas non plus satisfaire les éditeurs. Je me souviens qu'un de ces superbes, qui sévissait alors à la NRF, à un moment où je crevais de faim à Paris, me retourna un manuscrit, avec ces mots : « Prenez une maîtresse et revenez dans dix ans. » Lorsque je revins, en effet, dix ans plus tard, en 1945, il n'était malheureusement plus là : on l'avait déjà fusillé. Le monde s'était rétréci pour moi jusqu'à devenir une feuille de papier contre laquelle je me jetais de tout le lyrisme exaspéré de l'adolescence. Et cependant, en dépit de ces naïvetés, ce fut à cette époque que je m'éveillai entièrement à la gravité de l'enjeu et à sa nature profonde. Je fus étreint par un besoin de justice pour l'homme tout entier, quelles que fussent ses incarnations méprisables ou criminelles, qui me jeta enfin et pour la première fois au pied de mon œuvre future, et s'il est vrai que cette aspiration avait, dans ma tendresse de fils, sa racine douloureuse, tout mon être fut enserré peu à peu dans ses prolongements, jusqu'à ce que la création littéraire devînt pour moi ce qu'elle est toujours, à ses grands moments d'authenticité, une feinte pour tenter d'échapper à l'intolérable, une façon de rendre l'âme pour demeurer vivant.
Romain Gary, La Promesse de l'aube, 1960.
Texte 3
Monsieur Linh fuit son pays d'Asie en guerre et s'exile en Occident avec sa petite-fille, Sang diû.
C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. Le voyage dure longtemps. Des jours et des jours. Et tout ce temps, le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc qui finit par s'unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis. Quand on veut le faire entrer dans sa cabine, il se laisse guider sans rien dire, mais on le retrouve un peu plus tard, sur le pont arrière, une main tenant le bastingage, l'autre serrant l'enfant, la petite valise de cuir bouilli posée à ses pieds. Une sangle entoure la valise afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, comme si à l'intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une poignée de terre. C'est là tout ce qu'il a pu emporter. Et l'enfant bien sûr. L'enfant est sage. C'est une fille. Elle avait six semaines lorsque Monsieur Linh est monté à bord avec un nombre infini d'autres gens semblables à lui, des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l'on a regroupés à la hâte et qui se sont laissé faire. Six semaines. C'est le temps que dure le voyage. Si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'un siècle.
Philippe Claudel, La Petite Fille de Monsieur Linh, 2005.
Question
Quelle image du héros de roman chacun de ces textes propose-t-il ?Question : la correction
Les textes du présent corpus sont tous trois extraits de récits des xxe et xxie siècles. Le premier est tiré de La Peste de Camus, roman publié en 1947. Le deuxième est extrait de l'autobiographie de Romain Gary intitulée La Promesse de l'aube, publiée en 1960. Le dernier extrait est tiré d'un roman de Philippe Claudel publié en 2005, La Petite Fille de Monsieur Linh. Ces trois extraits donnent diverses images du héros confronté à l'adversité. Dans La Peste, le docteur Rieux assiste, impuissant, à la mort de son ami Tarrou. Le narrateur-personnage de La Promesse de l'aube, pour plaire à sa mère malade, entreprend de se lancer dans l'écriture. Dans le roman de Philippe Claudel, le personnage de Monsieur Linh doit fuir son pays en bateau, portant dans ses bras sa petite-fille de six semaines. Le docteur Rieux et Monsieur Linh incarnent chacun à leur manière des héros tragiques, impuissants mais dignes face à un événement douloureux. Le narrateur du roman de Camus insiste sur l'impuissance du médecin : il juge « impossible » d'ouvrir les ganglions de son ami agonisant ; « il ne [peut] rien » contre le « naufrage » de Tarrou ; enfin, ce sont les « larmes de l'impuissance » qu'il verse quand son ami expire. Rieux est également un héros « révolté », qui, malgré l'absurdité du monde et « le silence de la défaite », s'est efforcé de livrer des « combats » contre la peste. Dans cette scène, Rieux donne aussi l'image d'un héros pathétique, qui vient de perdre un ami « qui lui avait été si proche », alors même que la ville vient d'être « libérée de la peste ». Cette situation douloureuse le conduit à un exil moral : « il n'y aurait plus jamais de paix possible pour lui-même ». Dans le roman de Philippe Claudel, nous n'accédons pas avec autant de précision aux pensées du héros, mais la dignité du personnage de Monsieur Linh est déjà suggérée par la manière dont il est présenté : « debout à l'arrière d'un bateau ». Comme Rieux, sa douleur n'est jamais explicitée, mais elle est sensible à travers l'évocation du massacre de ses proches : ceux qui « savaient [son nom] sont morts autour de lui ». On comprend également que l'exil qu'il subit est un arrachement insupportable, par l'obstination avec laquelle il fixe l'horizon de son pays qui s'éloigne inexorablement, mais aussi par des signes tels que sa valise, dont le contenu dérisoire laisse deviner une fuite précipitée, et, bien sûr, sa petite-fille de six semaines, probable rescapée du massacre, qu'il emmène dans son exil. Monsieur Linh incarne donc une figure à la fois tragique et pathétique ; il est l'image souffrante et sublime de la guerre civile et de l'exil ; il est également le héros qui, malgré l'horreur et la peine endurées, se place du côté de la vie, en jetant ses dernières forces dans l'éducation de sa petite-fille. Le personnage de La Promesse de l'aube est présenté par son narrateur avec plus de distance. Il semble incarner davantage un héros de roman d'apprentissage : d'abord adolescent fougueux et naïf, il cherche à écrire, pour consoler sa mère malade de ses peines, un « chef-d'œuvre immortel », et se rêve d'emblée en « plus jeune Tolstoï de tous les temps ». À partir de là, il s'applique les clichés de l'écrivain forçat, qui, avec la respectueuse complicité de sa mère, s'enferme dans sa chambre et veut noircir « trois mille feuilles de papier blanc ». Cependant, cette naïveté initiale semble amener le héros à prendre conscience de sa véritable vocation d'écrivain, et des enjeux profonds de son désir d'écrire. Le jeune homme mue progressivement vers une forme d'humanisme, « étreint par un besoin de justice pour l'homme tout entier ». Les personnages de ce corpus illustrent bien la figure dominante du héros dans la littérature moderne : doté, à l'instar des héros « traditionnels », de vertus positives – courage, dignité –, il reste cependant humain dans son impuissance à changer le monde, sa faiblesse ou sa naïveté.
Quel est le rôle du personnage adjuvant?
Par exemple dans la Promesse de l'aube de R. Gary : la mère = aide à persévérer
Dans Claudel, la Petite fille de M. Linh = le personnage adjuvant est la petite fille qui est une poupée. Toute l'histoire se rapporte à cette petite fille. Il n'y aurait pas d'histoire sans elle.
Pour aller plus loin
Date de dernière mise à jour : 11/10/2018
Les commentaires sont clôturés