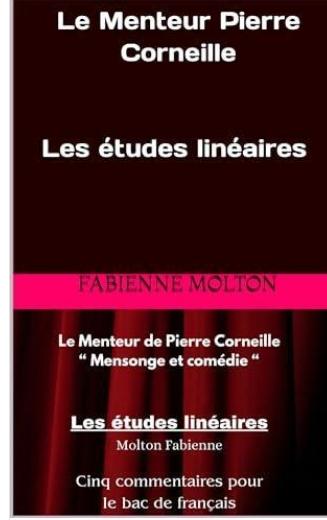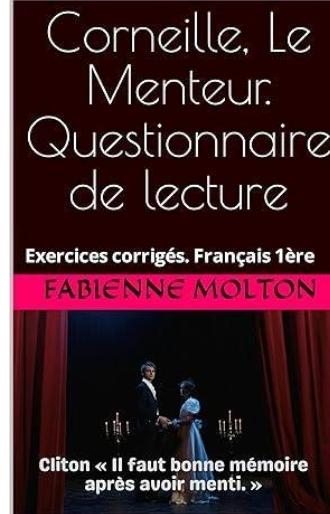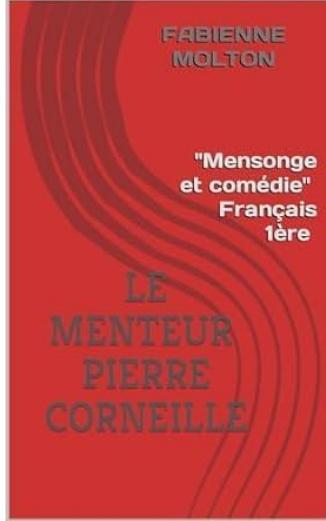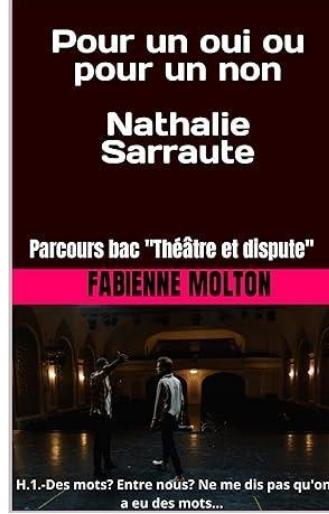1) Définitions et problématique
-
Rappel : la philosophie, une "conscience critique"…
La conscience est un thème majeur de la philosophie, sans doute parce que cette dernière se définit elle-même comme une sorte de “conscience supérieure” ou de « conscience critique », un redoublement de la pensée ordinaire se voulant « réflexion ».
-
Exemple de définition
Lalande (20è) - "La conscience est la connaissance plus ou moins claire qu’un sujet possède de ses états, de ses pensées et de lui-même.” On admet donc que la conscience est une forme de connaissance, une connaissance de soi. "Sujet" : la conscience est l'attribut d'un sujet unique et suppose celui-ci ; "états" fait référence aux états psychologiques, nécessairement variés et changeants, d'un sujet ; les "pensées apparaissent comme le contenu principal de la conscience ; "lui-même" renvoie à l'identité et donc à la connaissance de soi.
-
Etymologie
L’étymologie du mot semble confirmer cette hypothèse puisque cum-scientia en latin signifie « avec le savoir ». Il s’agirait donc d’une connaissance se rapportant à soi-même : savoir qui l’on est, ce que l’on pense, ce que l'on fait.
-
"Connais-toi toi-même" (Socrate) : sens de la formule
-
Modalités et limites d'une connaissance de soi
Cette connaissance est-elle possible, a-t-elle des limites ? Est-ce que la réflexion suffit ? Faut-il plutôt agir, faut-il plutôt se fier aux autres ? Et surtout : n'est-ce pas la quête (plutôt que le résultat) à jamais inachevée d'une vie ? On a vu (cf. leçon « Le Sujet ») que le fait d'être-sujet se décidait en réalité dans le temps, comme un processus ou un devenir. La manière dont un sujet prend conscience de lui-même doit donc s'apparenter à un processus. Tout le problème de la conscience tient dans ce vecteur, ce trajet qui part (I) du rapport immédiat à soi-même qu’on peut appeler simplement « conscience de soi », qui (II) transite par une étape de « reconnaissance de soi » à travers l’action et la reconnaissance d’autrui, et qui débouche finalement (III) dans une sorte d'extériorisation de soi, de « conscience-hors-de-soi » : cela définit d’une part l’existence comme ouverture et engagement dans un monde où il s'agit moins pour le sujet de se connaître que d'être efficace, et d’autres part cela concerne des formes quasiment « objectives » de la conscience, sociales et collectives, qui déterminent au moins partiellement la conscience individuelle (III). Finalement, se connaître soi-même reviendrait surtout à connaître les facteurs extérieurs qui nous déterminent en nous laissant l'illusion d'être une conscience individuelle maîtresse d'elle-même. « Se connaître soi-même » reviendrait-il– comme avait lui-même ironisé Socrate - à « savoir qu’on ne sait rien » ?
2) Comment se manifeste et se forme la conscience de soi ?
-
L'âme ou l'intériorité
L’« âme » est un vieux terme (psyché en grec, anima en latin) qui désigne originellement le principe vivant d’une chose, ce qui anime une chose. Bien souvent on emploie indifféremment « âme » ou « esprit », mais son assimilation avec l’esprit au sens intellectuel ou même psychologique du terme est un phénomène tardif. Aristote distinguait encore une âme végétative, et il est absurde d’affirmer que les « animaux » (terme tout droit dérivé d’anima) n’ont pas d’âme ni de psychisme sous quelque forme que ce soit. Seulement, il leur manque sans doute l’intellect et, ce qui est encore plus gênant, la conscience claire d'un "moi".
-
Le moi ou les trois figures de l'Identité : Mêmeté (individualité), Ipséité (subjectivité), Unicité (singularité)
Mêmeté (individualité) : répond alors à la question du "quoi", "que suis-je?" objectivement, pour les autres. Un individu, un "soi" plutôt qu''un "moi". C'est ce que résume la notion de «caractère», entendu comme «l'ensemble des dispositions durables à quoi on reconnaît une personne» (Ricoeur). La mêmeté apparaît comme la part objective de l'identité personnelle.
Ipséité (subjectivité) : se rattache à la question du "qui, "qui suis-je ?" subjectivement, pour moi-même. L'ipséité constitue la part subjective de l'identité personnelle. Elle définit le "quant-à-soi', la subjectivité, le sentiment intime d'avoir un "moi" propre. « Je suis moi », je ne suis pas toi, et je ne le serai jamais ! Voilà un aspect assurément essentiel de la conscience. Quant à savoir précisément qui je suis, quant à faire de cet individualité une personne, cela suppose un certain parcours qui sépare justement le fait d’avoir un moi (identité immédiate quasi-instinctive) et le fait d’être un sujet (personnalité consciente et mature).
Unicité" (singularité et solitude) : c'est une conséquence des deux propriéts précédentes, s'y rapportant de deux manière différentes. Objectivement, l'unicité du soi, l'identité n'est rien d'autre qu'une singularité (sociologique). On a beau se noyer dans la masse, on demeure toujours reconnaissable ! Subjectivement, l'unicité du moi, l'identité n'est rien d'autre qu'une forme particulièrement radicale et vertigineuse de solitude (psychologique, voire métaphysique). Au fondement de toute question humaine, on retrouve celle-ci, initiale, inévitable et pourtant quasi-informulable : “pourquoi moi ?”, “pourquoi suis-je moi ?”. Pourquoi suis-je enfermé dans la coquille de ce moi ridicule, étroite fenêtre par laquelle j’entrevois le monde. La vérité c'est que le moi n’est pas une « chose » de ce monde mais seulement un point de vue sur le monde et les choses, juste un moi parmi d’autres mois qui ne sont jamais que d’autres points de vue… Ne pas oublier que l'être-un, l'Identité est synonyme de Multiplicité.
-
L'identification imaginaire : le stade du miroir
La conscience de ce moi individuel n’est nullement évidente ni surtout immédiate. Elle est le résultat d’un processus d’identification que les psychologues connaissent bien et que nous pouvons scinder en deux phases successives: une identification imaginaire et une identification symbolique (au moyen du langage)
La première, baptisée « stade du miroir » par le psychologue suisse Henri Wallon, concerne le processus par lequel le jeune enfant, dès l'âge de 6 mois, parvient à la reconnaissance de sa propre image, de sa propre forme corporelle. En effet, aux premiers âges de la vie, l’enfant ne perçoit distinctement que des fragments de son corps, puisque à aucun moment il n’a pu se contempler dans un miroir. Il le peut évidemment grâce à un adulte qui le porte, mais justement avant un certain degré de maturité psychologique, une telle image sera vue mais elle ne sera pas perçue, c’est-à-dire reconnue : c’est ce qui se passe avec l’animal qui, placé devant un miroir, soit fait mine de ne rien voir soit se comporte agressivement comme s’il était face à un congénère, à un autre. Or un beau jour il advient que, porté par l’adulte qui s’avère être sa mère ou son père - lequel exhibe fièrement sa progéniture devant le miroir et lui témoigne ostensiblement à cette occasion tout son amour – l’enfant va sourire au miroir, ou plutôt en souriant au regard de l’adulte va du même coup sourire à sa propre image et donc se reconnaître (comment ne pourrait-ce pas être lui, cette chose regardée à la fois par l’adulte depuis le miroir et par lui-même depuis le réel ?). On comprend bien que sans la participation de l’autre, ici de l’adulte, sans l’attestation qu’il apporte et à la condition expresse qu’il se montre bienveillant, (on peut imaginer les conséquences dans le cas contraire où c’est le « mauvais œil » qui est rencontré : de quoi développer une sacrée psychose) aucune identification ne pourrait fonctionner. On comprend aussi pourquoi l’expérience du miroir ne «fonctionne» pas avec les animaux : ce n’est pas une question d’intelligence, ou de conscience a priori ou non (puisque c’est un aspect de la conscience qui est ainsi formé), mais de sociabilité ou plutôt d’« intersubjectivité » a priori : paradoxalement, il faut être deux au départ pour le Un de l’identification soit possible. Il n’y a pas ces jeux de regard entre la mère chimpanzé et son bébé, cette identification au regard de l’autre. En résumé : « je » me vois d’abord tel que je suis vu par l’autre (« bien vu », de préférence…), et en plus je ne me vois pas tel que je suis vraiment. N’oublions pas en effet que l’identification imaginaire résulte d’un stratagème et d’un mensonge : alors que à 6 mois je ne suis en réalité qu’une larve rampant laborieusement à même la moquette, voici que je m’aperçois tout d’un coup grand et debout, entier et si beau (c’est l’autre qui en atteste) ! Cela justifie bien cette jubilation et ces éclats de rire qui ne cesseront plus… Si ce n’est pas du narcissisme ! C’est le psychanalyste français Jacques Lacan qui a révélé toute cette dimension narcissique, allons jusqu’à dire libidineuse, du stade du miroir. Mais il laisse entendre également que, au-delà des deux protagonistes réels nouant ainsi un lien imaginaire, se tient une instance proprement symbolique, qui est celle du langage : il fallait bien que ces deux là aient quelque chose à se dire – d'ailleurs l'adulte parle dans ces moments et l'enfant rie -, finalement, il fallait que les regards signifient quelque chose, qu’ils se questionnent et se répondent, pour que le message « tu es toi » puisse passer.
bienveillant, (on peut imaginer les conséquences dans le cas contraire où c’est le « mauvais œil » qui est rencontré : de quoi développer une sacrée psychose) aucune identification ne pourrait fonctionner. On comprend aussi pourquoi l’expérience du miroir ne «fonctionne» pas avec les animaux : ce n’est pas une question d’intelligence, ou de conscience a priori ou non (puisque c’est un aspect de la conscience qui est ainsi formé), mais de sociabilité ou plutôt d’« intersubjectivité » a priori : paradoxalement, il faut être deux au départ pour le Un de l’identification soit possible. Il n’y a pas ces jeux de regard entre la mère chimpanzé et son bébé, cette identification au regard de l’autre. En résumé : « je » me vois d’abord tel que je suis vu par l’autre (« bien vu », de préférence…), et en plus je ne me vois pas tel que je suis vraiment. N’oublions pas en effet que l’identification imaginaire résulte d’un stratagème et d’un mensonge : alors que à 6 mois je ne suis en réalité qu’une larve rampant laborieusement à même la moquette, voici que je m’aperçois tout d’un coup grand et debout, entier et si beau (c’est l’autre qui en atteste) ! Cela justifie bien cette jubilation et ces éclats de rire qui ne cesseront plus… Si ce n’est pas du narcissisme ! C’est le psychanalyste français Jacques Lacan qui a révélé toute cette dimension narcissique, allons jusqu’à dire libidineuse, du stade du miroir. Mais il laisse entendre également que, au-delà des deux protagonistes réels nouant ainsi un lien imaginaire, se tient une instance proprement symbolique, qui est celle du langage : il fallait bien que ces deux là aient quelque chose à se dire – d'ailleurs l'adulte parle dans ces moments et l'enfant rie -, finalement, il fallait que les regards signifient quelque chose, qu’ils se questionnent et se répondent, pour que le message « tu es toi » puisse passer.
-
L'accès au langage, l'usage du "Je"
- Kant (18è) - "Mais il est remarquable que l'enfant, qui sait déjà parler assez correctement, ne commence pourtant qu'assez tard (peut-être bien un an après) à dire Je; jusque là, il parlait de lui à la troisième personne (Karl veut manger, marcher, etc.); et il semble que pour lui ce soit comme une lumière qui vient de se lever, quand il commence à dire Je; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. - Auparavant il ne faisait que se sentir, maintenant il se pense". Justement, la deuxième forme d’identification est d’ordre symbolique, au sens où elle s'opère au moyen du langage. Elle intervient beaucoup plus tard, notamment avec la maîtrise des formes pronominales. Kant avait déjà remarqué que l’enfant jusque vers 3 ans parlait souvent de lui à la troisième personne, qu’il ne parvenait pas à aligner d’un seul jet le pronom personnel sujet « je » et sa forme complément d’objet « me » ou « moi » : ainsi au lieu de dire « je me suis fais mal », toto va dire « toto s’est fait mal ». Cette maîtrise une fois acquise n’est pas seulement formelle, logique et grammaticale, elle comporte des implications sociales et existentielles. Qu’est-ce que cela signifie, le fait que l’enfant maîtrise désormais l’usage combiné du « je » et du « moi », sinon que son individualité jusque là confuse s’inscrit distinctement dans une chaîne qui est celle de la vie et notamment de la vie sociale, où le « moi » est en sans cesse en butte aux autres mois, où la joie le dispute à la tristesse, où la mort succède à la vie…
-
La pensée et la conscience réfléchie
- Descartes (17è) - “Par le nom de pensée j’entends ce qui est tellement en nous que nous en avons immédiatement connaissance”. - Spinoza (17è) - “Dès qu’on sait quelque chose, on sait par-là même qu’on le sait, et en même temps on sait qu’on sait qu’on sait et ainsi à l’infini.” A juste titre, on ramène souvent la conscience au phénomène de la pensée prise au sens le plus large. Descartes (qui emploie peu le mot « conscience ») assimile clairement pensée et connaissance. Le propre de la pensée, contrairement à la simple perception externe, c’est non seulement de pouvoir se représenter des objets divers mais aussi de pouvoir se représenter elle-même : c’est précisément en cela qu’elle est consciente, c’est-à-dire réfléchie (pas au sens de « raisonnable » mais simplement de « réflexive »). Quand je pense à quelque chose, immédiatement je sais que je le pense, et ainsi de suite… Donc, pour Descartes, toute pensée est consciente, et toute conscience n’est faite que de pensée.
- Descartes – "Je pense donc je suis." - Descartes - "Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser." Mais Descartes va plus loin, non content de montrer que la pensée suffit à se saisir elle-même, il montre que le sujet, dans l’acte de penser, se saisit lui-même dans son existence et dans son essence. Descartes expose de manière raisonnée et philosophique ce que nous avons exposé dans un premier temps comme un savoir intuitif : je sais que j'existe et je sais que je suis moi. "Je pense donc je suis" : il y a trois vérités en une : 1) je pense, donc je suis, j'existe (parce que je peux douter de tout, sauf du fait que je pense : je ne peux même pas imaginer que je n'existe pas) ; 2) je pense, donc je suis bien moi (sujet), c'est moi qui pense (personne ne peut penser à ma place) ; 3) je pense, donc je suis essentiellement un être pensant (si ma pensée se trouve à ce point liée à mon existence, ma pensée doit être en même temps le principe de mon existence, c’est-à-dire mon essence).
Quelle est la première de toutes les vérités, une vérité indubitable, qui résisterait aux formes de doute les plus extrêmes voire les plus extravagantes ? C'est la certitude d'exister et d'être soi-même. Pour le démontrer Descartes procède en plusieurs étapes successives, bien que mentalement, l’expérience que nous allons décrire soit fulgurante. 1) Dubito. Descartes aligne une série de doutes successifs. D’abord il part du constat que les sens nous trompent souvent, et avec eux l’imagination. Apparemment les vérités logiques et mathématiques semblent résister au doute : que je dorme ou que je veille, 2 et 3 font toujours 5. Et pourtant si l’esprit adhère à ces évidences de façon immédiate, il ignore la source de telles vérités : qui me dit que, même en raisonnant de la sorte, je ne suis pas en train de rêver ? 2) Cogito. Or c’est en imaginant précisément que les vérités pourraient n’avoir aucun fondement, par exemple qu’un mauvais génie pourrait s’amuser à me tromper systématiquement, que j’aperçois alors la première vérité évidente. Car qu’on me trompe ou non, dès lors que je doute, au moment où je doute, une chose est sûre et certaine : c’est que je pense. Douter, c’est penser. Donc à supposer que je pense faussement chaque fois que je pense, il est certain néanmoins que je pense, et que c’est moi qui pense, autrement dit ma conscience. 3) Ego sum. Ce qui nous amène à la formule complète : cogito ergo sum. Si je ne peux pas douter que je pense, je ne peux pas douter non plus que c’est bien moi qui pense : personne ne peut penser à ma place ! Il y a un rapport immédiat, une identification entre la pensée, l’être, et le moi. « Je pense donc je suis » n’est qu’une apparente déduction (malgré le « donc »), c’est une intuition immédiate. C’est pourquoi on ne saurait dire de la même manière et dans le même sens «je marche donc je suis » : certes, pour marcher, il faut être, c’est logique, et pour penser il faut être aussi, c’est encore logique, mais le fait de marcher n’est pas une activité réfléchie comme le fait de penser ; à la limite, je puis avoir l’illusion de marcher ou bien marcher artificiellement, mais comment avoir l’illusion de penser ou de penser moi-même ! 4) Res cogitans (chose pensante). Ce n’est pas tout : si ma pensée se trouve à ce point liée à mon existence, ma pensée doit être en même temps le principe de mon existence, c’est-à-dire mon essence. Cette prise de conscience de mon existence par la pensée me conduit tout droit à une définition non moins certaine de mon essence en tant que sujet et être humain : « Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser » (Le Discours de la méthode). Descartes distingue deux substances : la matière et la pensée, plus une troisième qui combine les deux chez l’être humain, l’union de l’âme et du corps. L’homme est l’union d’une âme et d’un corps, mais le pôle essentiel de cette nature humaine est bien l’âme. Cette notion de « substance », rappelons-nous qu’elle renvoie à l’ancienne définition du « sujet » ; et il ne fait pas de doute que pour Descartes, même si le sujet se découvre lui-même en tant que conscience, il existe (pré-existe ?) quand même en tant que substance : deux conceptions du sujet se trouvent ici imbriquées… 5) Dieu existe. Ajoutons un dernier élément pour clore cette démonstration. Considérant que la pensée est immatérielle, et n’imaginant nullement qu’elle puisse être produite par des processus physico-chimiques (comment l’aurait-il su, au 17è siècle ?), Descartes rejoint logiquement la thèse chrétienne selon laquelle l’âme, cette «chose pensante », doit être immortelle et de nature divine. Donc si la première vérité est que j’existe, la seconde doit être que Dieu existe.
Avec Descartes, pour la première fois dans le cadre d’une démarche philosophique assumée, la conscience réfléchit sur son existence et se pose elle-même comme sujet. Oui de ce point de vue, indéniablement, la conscience parvient à la connaissance de soi. Mais, bien que fondamentale, cette connaissance paraît en même temps bien mince. Pour valider une quelconque connaissance de soi, il faut paradoxalement la relativiser, et pour cela il faut peut-être distinguer plusieurs formes de conscience…
- Descartes – "Je pense donc je suis." - Descartes - "Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser." Mais Descartes va plus loin, non content de montrer que la pensée suffit à se saisir elle-même, il montre que le sujet, dans l’acte de penser, se saisit lui-même dans son existence et dans son essence. Descartes expose de manière raisonnée et philosophique ce que nous avons exposé dans un premier temps comme un savoir intuitif : je sais que j'existe et je sais que je suis moi. "Je pense donc je suis" : il y a trois vérités en une : 1) je pense, donc je suis, j'existe (parce que je peux douter de tout, sauf du fait que je pense : je ne peux même pas imaginer que je n'existe pas) ; 2) je pense, donc je suis bien moi (sujet), c'est moi qui pense (personne ne peut penser à ma place) ; 3) je pense, donc je suis essentiellement un être pensant (si ma pensée se trouve à ce point liée à mon existence, ma pensée doit être en même temps le principe de mon existence, c’est-à-dire mon essence).
Quelle est la première de toutes les vérités, une vérité indubitable, qui résisterait aux formes de doute les plus extrêmes voire les plus extravagantes ? C'est la certitude d'exister et d'être soi-même. Pour le démontrer Descartes procède en plusieurs étapes successives, bien que mentalement, l’expérience que nous allons décrire soit fulgurante. 1) Dubito. Descartes aligne une série de doutes successifs. D’abord il part du constat que les sens nous trompent souvent, et avec eux l’imagination. Apparemment les vérités logiques et mathématiques semblent résister au doute : que je dorme ou que je veille, 2 et 3 font toujours 5. Et pourtant si l’esprit adhère à ces évidences de façon immédiate, il ignore la source de telles vérités : qui me dit que, même en raisonnant de la sorte, je ne suis pas en train de rêver ? 2) Cogito. Or c’est en imaginant précisément que les vérités pourraient n’avoir aucun fondement, par exemple qu’un mauvais génie pourrait s’amuser à me tromper systématiquement, que j’aperçois alors la première vérité évidente. Car qu’on me trompe ou non, dès lors que je doute, au moment où je doute, une chose est sûre et certaine : c’est que je pense. Douter, c’est penser. Donc à supposer que je pense faussement chaque fois que je pense, il est certain néanmoins que je pense, et que c’est moi qui pense, autrement dit ma conscience. 3) Ego sum. Ce qui nous amène à la formule complète : cogito ergo sum. Si je ne peux pas douter que je pense, je ne peux pas douter non plus que c’est bien moi qui pense : personne ne peut penser à ma place ! Il y a un rapport immédiat, une identification entre la pensée, l’être, et le moi. « Je pense donc je suis » n’est qu’une apparente déduction (malgré le « donc »), c’est une intuition immédiate. C’est pourquoi on ne saurait dire de la même manière et dans le même sens «je marche donc je suis » : certes, pour marcher, il faut être, c’est logique, et pour penser il faut être aussi, c’est encore logique, mais le fait de marcher n’est pas une activité réfléchie comme le fait de penser ; à la limite, je puis avoir l’illusion de marcher ou bien marcher artificiellement, mais comment avoir l’illusion de penser ou de penser moi-même ! 4) Res cogitans (chose pensante). Ce n’est pas tout : si ma pensée se trouve à ce point liée à mon existence, ma pensée doit être en même temps le principe de mon existence, c’est-à-dire mon essence. Cette prise de conscience de mon existence par la pensée me conduit tout droit à une définition non moins certaine de mon essence en tant que sujet et être humain : « Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser » (Le Discours de la méthode). Descartes distingue deux substances : la matière et la pensée, plus une troisième qui combine les deux chez l’être humain, l’union de l’âme et du corps. L’homme est l’union d’une âme et d’un corps, mais le pôle essentiel de cette nature humaine est bien l’âme. Cette notion de « substance », rappelons-nous qu’elle renvoie à l’ancienne définition du « sujet » ; et il ne fait pas de doute que pour Descartes, même si le sujet se découvre lui-même en tant que conscience, il existe (pré-existe ?) quand même en tant que substance : deux conceptions du sujet se trouvent ici imbriquées… 5) Dieu existe. Ajoutons un dernier élément pour clore cette démonstration. Considérant que la pensée est immatérielle, et n’imaginant nullement qu’elle puisse être produite par des processus physico-chimiques (comment l’aurait-il su, au 17è siècle ?), Descartes rejoint logiquement la thèse chrétienne selon laquelle l’âme, cette «chose pensante », doit être immortelle et de nature divine. Donc si la première vérité est que j’existe, la seconde doit être que Dieu existe.
Avec Descartes, pour la première fois dans le cadre d’une démarche philosophique assumée, la conscience réfléchit sur son existence et se pose elle-même comme sujet. Oui de ce point de vue, indéniablement, la conscience parvient à la connaissance de soi. Mais, bien que fondamentale, cette connaissance paraît en même temps bien mince. Pour valider une quelconque connaissance de soi, il faut paradoxalement la relativiser, et pour cela il faut peut-être distinguer plusieurs formes de conscience…
-
Une distinction nécessaire : Sujet transcendantal et moi empirique
- Kant – "Le 'je pense' doit pouvoir accompagner toutes mes représentations". - Kant – " Le fait que l'homme puisse avoir le Je dans sa représentation, l'élève infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivant sur la terre. Par là, il est une personne et, grâce à l'unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui arriver, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un être entièrement différent, par le rang et la dignité, de choses telles que les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise; et ceci, même lorsqu'il ne peut pas encore dire le Je, car il l'a cependant dans sa pensée; ainsi toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser le Je, même si elles n'expriment pas cette relation au Moi par un mot particulier. Car cette faculté (de penser) est l'entendement." Avec Descartes on avait un peu l’impression que la conscience était une unité compacte, parvenant de manière non moins « absolue » à la connaissance de soi. En nous appuyant sur Kant (18è), nous allons préciser à la fois ce qui peut être appelé « conscience » et ce que celle-ci peut connaître en général. En effet, pour connaître il ne suffit pas de « se représenter » les choses, il faut pouvoir y parvenir de manière objective, c’est-à-dire il faut se donner un objet précis à connaître : or comment la conscience peut-elle se trouver en position d’« objet », pour elle-même ? Justement en distinguant deux formes de conscience.
a) Le sujet transcendantal. – « Transcendantal » désigne chez Kant ce qui fournit les conditions a priori d’une connaissance en général, ce qui permet d’unifier et de connaître les données de l’expérience. Donc ce que Kant appelle le sujet transcendantal, ce n’est pas une chose existante ou une « substance » mais une fonctionnalité supérieure de l’esprit humain, soit cette capacité qu’a celui-ci de synthétiser (et par-là de les comprendre, c'est l'"entendement") des informations, des représentations très diverses sans jamais se départir d’une unité et d’une permanence essentielles. Mais on peut distinguer par ailleurs les « contenus » de conscience, justement les "représentations", tout ce divers qui m’appartient aussi mais qui apparaît changeant.
b) Le moi empirique (ou psychologique). Est « empirique » ce qui existe et ce que l’on éprouve à travers l’expérience. Nos états de consciences s’enrichissent de sensations, d’expériences, de vécus, de relations diverses, etc., toutes choses qui ne sont pas destinées à « demeurer » sous la forme d’un « sujet » puisque par définition elles sont changeantes. Désigner ce divers par le « moi » plutôt que par le « je » revient à souligner sa nature d’« objet » à connaître, notamment par rapport au « je » sujet : il est bien vrai que « je me » connais au sens où certains traits de ma personne me sont connus – et encore très relativement ! Celui qui prétend se connaître absolument est un imposteur. Mais surtout, il faut bien comprendre que si cette relation entre « je » et « moi » est compatible avec une forme de connaissance, on doit exclure par principe que « je » puisse connaître « je » : tout simplement parce que, sous ce rapport, il n’y a rien à connaître du tout ! « Je » est une fonction de synthèse, pas un objet ou un contenu. Par ailleurs, si l’on retient avec Descartes que ce « je » « désigne » d’une certaine façon mon existence, si l’on garde comme valable la formule même du « cogito ergo sum », il est absurde de dire que je « connais » mon existence. Kant est clair sur ce point : dire « je suis conscient de mon existence » n’équivaut en aucun cas à dire (conclusion que pense pouvoir tirer Descartes) « je connais mon être » ou même mon « essence ». D’une façon générale, pour Kant, on ne connaît pas l’être, on ne connaît pas les « choses en soi » (« noumènes ») mais seulement des « phénomènes », soit des « représentations » des choses telles qu’elles apparaissent à nos sens et à notre entendement. Par quel miracle notre esprit pourrait-il se « brancher » directement sur les choses « telles qu’elles sont » ? Par quel miracle pourrait-on se connaître soi-même « tel qu’on est » puisque nul n’a accès à cet « être » qui n’est jamais objet dans sa totalité ?
Conclusion. - « Etre conscient » signifie bien dans un premier temps « être conscient de soi ». Il y a bien un sujet conscient qui unifie et qui rend possible (c’est le sens de transcendantal) la diversité de nos expériences vécues. Mais pour l’instant cette connaissance de soi reste bien théorique et abstraite. Transition. - Pour devenir réelle, elle doit s'effectuer dans le monde, se "frotter à la réalité" comme on dit. Pour se connaître, il ne faut pas seulement penser, il faut sortir de soi, il faut agir, car c'est seulement à travers ce que l'on fait que l'on peut reconnaître ce que l'on est.
3) La Conscience comme Prise de conscience et reconnaissance
b) Le moi empirique (ou psychologique). Est « empirique » ce qui existe et ce que l’on éprouve à travers l’expérience. Nos états de consciences s’enrichissent de sensations, d’expériences, de vécus, de relations diverses, etc., toutes choses qui ne sont pas destinées à « demeurer » sous la forme d’un « sujet » puisque par définition elles sont changeantes. Désigner ce divers par le « moi » plutôt que par le « je » revient à souligner sa nature d’« objet » à connaître, notamment par rapport au « je » sujet : il est bien vrai que « je me » connais au sens où certains traits de ma personne me sont connus – et encore très relativement ! Celui qui prétend se connaître absolument est un imposteur. Mais surtout, il faut bien comprendre que si cette relation entre « je » et « moi » est compatible avec une forme de connaissance, on doit exclure par principe que « je » puisse connaître « je » : tout simplement parce que, sous ce rapport, il n’y a rien à connaître du tout ! « Je » est une fonction de synthèse, pas un objet ou un contenu. Par ailleurs, si l’on retient avec Descartes que ce « je » « désigne » d’une certaine façon mon existence, si l’on garde comme valable la formule même du « cogito ergo sum », il est absurde de dire que je « connais » mon existence. Kant est clair sur ce point : dire « je suis conscient de mon existence » n’équivaut en aucun cas à dire (conclusion que pense pouvoir tirer Descartes) « je connais mon être » ou même mon « essence ». D’une façon générale, pour Kant, on ne connaît pas l’être, on ne connaît pas les « choses en soi » (« noumènes ») mais seulement des « phénomènes », soit des « représentations » des choses telles qu’elles apparaissent à nos sens et à notre entendement. Par quel miracle notre esprit pourrait-il se « brancher » directement sur les choses « telles qu’elles sont » ? Par quel miracle pourrait-on se connaître soi-même « tel qu’on est » puisque nul n’a accès à cet « être » qui n’est jamais objet dans sa totalité ?
Conclusion. - « Etre conscient » signifie bien dans un premier temps « être conscient de soi ». Il y a bien un sujet conscient qui unifie et qui rend possible (c’est le sens de transcendantal) la diversité de nos expériences vécues. Mais pour l’instant cette connaissance de soi reste bien théorique et abstraite. Transition. - Pour devenir réelle, elle doit s'effectuer dans le monde, se "frotter à la réalité" comme on dit. Pour se connaître, il ne faut pas seulement penser, il faut sortir de soi, il faut agir, car c'est seulement à travers ce que l'on fait que l'on peut reconnaître ce que l'on est.
3) La Conscience comme Prise de conscience et reconnaissance
-
La conscience "pour soi" ou la reconnaissance de soi : au-delà de la "conscience malheureuse" (aspect psychologique)
- Hegel (19è) – "Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et d'une seule façon, tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence; il existe d'une part au même titre que les choses de la nature, mais d'autre part il existe aussi pour soi, il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. Cette conscience de soi, l'homme l'acquiert de deux manières: Primo, théoriquement, parce qu'il doit se pencher sur lui-même pour prendre conscience de tous les mouvements, replis et penchants du cœur humain et d'une façon générale se contempler, se représenter ce que la pensée peut lui assigner comme essence, enfin se reconnaître exclusivement aussi bien dans ce qu'il tire de son propre fond que dans Ies données qu'il reçoit de l'extérieur. Deuxièmement, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se trouver lui-même. à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s'offre à lui extérieurement. Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu'il marque du sceau de son intériorité et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. L'homme agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger et pour ne jouir des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité." "Pour soi" s'oppose à "en soi" : les choses de la nature existent en soi seulement, mais l'homme existe aussi pour soi car, grâce à sa conscience, il a une existence automne et il est pour lui-même son propre but. "Pour" exprime la finalité. L'arbre existe pour la forêt ou pour l'insecte qu'il abrite ; l'homme existe pour lui-même, mais cela prend la forme d'un trajet, d'une aventure, c'est pourquoi il ne peut rester en lui-même ni rester le même. "L'homme pour soi est l'être qui existe consciemment pour lui-même, théoriquement et pratiquement". Pratique vient du grec praxis qui signifie l'action. Entre le théorique et le pratique, il a tout l'écart entre le possible et le réel, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire effectivement.
Une conscience vivante telle que l'être humain a besoin de se reconnaître à travers une œuvre, un travail, une action ou un projet. Comme l'artiste vérifie son talent dans l'œuvre réalisée, ou comme l'éducateur vérifie sa science dans le savoir de l'élève. D'une façon générale, l'être humain ne peut s'empêcher d'utiliser le monde et les choses comme un matériau où imprimer, comme dit Hegel, "le sceau de son intériorité", voire comme un gigantesque miroir où il finit par se contempler lui-même.
Parallèlement, une conscience a besoin d'être reconnue par les autres consciences pour ce qu'elle est, c'est-à-dire justement une conscience et non une chose ; mais pas seulement une conscience abstraite et théorique, également comme une conscience concrète et agissante. Par exemple, une belle jeune fille ne veut pas être louée uniquement pour sa beauté, pour ce qu'elle est physiquement, mais aussi pour ce qu'elle pense (elle a aussi un esprit !) et pour ce qu'elle fait dans la vie.
La "conscience malheureuse" : cette expression est employée par Hegel dans la Phénoménologie de l'Esprit pour désigner le sentiment de frustration et d'impuissance qu'éprouve une conscience lorsqu'elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, ou pour mieux dire, lorsqu'elle ne parvient pas à faire coïncider l'idée abstraite ou théorique qu'elle a d'elle-même et son efficacité dans le monde. Pour exister vraiment, la conscience doit se tourner vers les autres et vers le monde, auprès desquels elle cherche et parfois trouve la confirmation de ce qu'elle pense être.
Le problème, c'est que cela conduit parfois à affronter les autres consciences : il y a une lutte pour la reconnaissance. Il faut forcer l'autre à nous reconnaître, il faut s'imposer à lui. Que l'on songe par exemple au "monde du travail", terrain de jeu favori des consciences en quête de reconnaissance et pas seulement avides de gains financiers… La reconnaissance n'est jamais donnée d'avance car, même si le but final est de recevoir la reconnaissance d'autrui, on ne peut être reconnu comme "méritant" que si notre action a été efficace ; or pour être efficace, il ne faut pas toujours s'encombrer de scrupules. On veut être reconnu comme sujet par d'autres sujets, mais entre-temps il aura fallu dominer l'autre, il aura fallu traiter l'autre comme un objet (au moins provisoirement).
Parallèlement, une conscience a besoin d'être reconnue par les autres consciences pour ce qu'elle est, c'est-à-dire justement une conscience et non une chose ; mais pas seulement une conscience abstraite et théorique, également comme une conscience concrète et agissante. Par exemple, une belle jeune fille ne veut pas être louée uniquement pour sa beauté, pour ce qu'elle est physiquement, mais aussi pour ce qu'elle pense (elle a aussi un esprit !) et pour ce qu'elle fait dans la vie.
La "conscience malheureuse" : cette expression est employée par Hegel dans la Phénoménologie de l'Esprit pour désigner le sentiment de frustration et d'impuissance qu'éprouve une conscience lorsqu'elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, ou pour mieux dire, lorsqu'elle ne parvient pas à faire coïncider l'idée abstraite ou théorique qu'elle a d'elle-même et son efficacité dans le monde. Pour exister vraiment, la conscience doit se tourner vers les autres et vers le monde, auprès desquels elle cherche et parfois trouve la confirmation de ce qu'elle pense être.
Le problème, c'est que cela conduit parfois à affronter les autres consciences : il y a une lutte pour la reconnaissance. Il faut forcer l'autre à nous reconnaître, il faut s'imposer à lui. Que l'on songe par exemple au "monde du travail", terrain de jeu favori des consciences en quête de reconnaissance et pas seulement avides de gains financiers… La reconnaissance n'est jamais donnée d'avance car, même si le but final est de recevoir la reconnaissance d'autrui, on ne peut être reconnu comme "méritant" que si notre action a été efficace ; or pour être efficace, il ne faut pas toujours s'encombrer de scrupules. On veut être reconnu comme sujet par d'autres sujets, mais entre-temps il aura fallu dominer l'autre, il aura fallu traiter l'autre comme un objet (au moins provisoirement).
Bref, une conscience est toujours confrontée aux autres parce qu'elle vise toujours un au-delà d'elle-même. Or au-delà de la conscience individuelle, il y a ce que Hegel appelle l'Esprit, l'Esprit universel : l'Humanité, l'Histoire, la Culture, le Savoir… La reconnaissance totale ne s'effectuera qu'au sein de l'Esprit, mais, paradoxalement, il faut renoncer à son individualité… Conséquence : en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'individuelle, et accrochée à son individualité, la conscience est toujours malheureuse ! Quand elle sera reconnue vraiment elle sera devenue Esprit, elle fera partie de la Culture, mais elle ne sera plus individuellement : disons-le plus trivialement, pour être reconnu pleinement, il faut être mort ! Mais ceci est un processus nécessaire, il faut accepter l'idée que l'universel est supérieur à l'individuel, et qu'il y a "quelque chose de plus important" que sa propre individualité. C'est exactement ce qu'on appelle la "conscience morale", il s'agit pour soi-même de reconnaître autrui en tant que tel. Il faut exister "pour-autrui" et pas seulement "pour-soi"…
-
La "conscience morale" ou la reconnaissance d'autrui : au-delà de la "mauvaise conscience" (aspect moral)
La "mauvaise conscience", nous en faisons tous l'expérience : le remords est la face noire de la conscience qui s'accuse elle-même. Le fait  d'éprouver du remords, parce que l'on a fait du tort à autrui, réellement ou imaginairement, prouve au moins la présence d'une conscience. Mais de même que la "conscience malheureuse", au plan psychologique, doit être dépassée sur le chemin de la reconnaissance, la "mauvaise conscience" ne possède pas en elle-même le remède à sa propre souffrance. Celui qui s'accuse lui-même n'est guère plus avancé que celui qui ne s'accuse jamais, celui qui a "bonne conscience", comme on dit. Ce sont deux attitudes également "autistiques", deux rapports à soi (détestation de soi ou amour de soi) qui ignorent ou feignent d'ignorer que le principe de la vraie conscience morale réside dans le rapport à l'Autre.
d'éprouver du remords, parce que l'on a fait du tort à autrui, réellement ou imaginairement, prouve au moins la présence d'une conscience. Mais de même que la "conscience malheureuse", au plan psychologique, doit être dépassée sur le chemin de la reconnaissance, la "mauvaise conscience" ne possède pas en elle-même le remède à sa propre souffrance. Celui qui s'accuse lui-même n'est guère plus avancé que celui qui ne s'accuse jamais, celui qui a "bonne conscience", comme on dit. Ce sont deux attitudes également "autistiques", deux rapports à soi (détestation de soi ou amour de soi) qui ignorent ou feignent d'ignorer que le principe de la vraie conscience morale réside dans le rapport à l'Autre.
Qu'est-ce que la "conscience morale" ? C'est la connaissance de ce que l'on nomme en raccourci le "bien" et le "mal", c'est-à-dire plus précisément la conscience de ce l'on doit faire ou ne pas faire en fonction de principes qui placent le respect d'autrui et de soi-même au-dessus des seuls intérêts personnels. Il s'agit d'une conscience pratique et non seulement théorique ; ce n'est pas seulement un savoir, mais surtout une volonté. Cette volonté est par définition personnelle, autonome (personne ne peut me "forcer" à vouloir), mais elle est quand même placée sous l'autorité d'un devoir qui, lui, implique une forme d'universalité. Il existe une sorte de "cogito" moral qui pourrait se décliner ainsi : je veux (faire ceci ou cela) parce que je le dois, et je le dois parce que cela va dans le sens de l'intérêt commun.
A la notion de conscience morale est associée inévitablement celle de responsabilité. La responsabilité est ce qui fait de moi, sur le plan moral, un sujet. Cela consiste à être conscient de ses actes, à "savoir ce que l'on fait" : d'abord se reconnaître soi-même comme l'auteur de l'acte, puis être capable d'anticiper ses conséquences (pour moi comme pour autrui). La notion de responsabilité engage donc la notion d'action ou d'acte, condition pour que l'on puisse parler de conscience "pratique"). L'acte est propre à l'être humain ; on ne dit pas de l'animal qu'il agit, on parle de son "comportement", éventuellement de ses "réactions"… C'est que l'action suppose l'intention, un processus de l'esprit qu'on ne peut pas attribuer à l'animal. C'est avant tout cet élément intentionnel de l'acte qui s'avère être le siège de la conscience morale, donc qui peut être jugé. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'action sans réalisation… de sorte qu'une intention pure ne constitue pas un acte. Par exemple, l'intention de tuer n'est pas constitutive du meurtre ni même de la tentative de meurtre – sauf bien sûr si un début de réalisation est manifeste (menacer avec une arme, par ex.). Inversement, la réalisation privée d'intention ne constitue par non plus un acte également qualifié : dans notre exemple, le fait de donner la mort sans avoir l'intention de la donner ne constitue pas un meurtre, mais un homicide involontaire… Bref, l'acte est un composé d'intention et de réalisation, et il convient de ne pas attribuer à l'intention seule le caractère moral de l'acte : ce serait trop facile ! Ne dit-on pas que "l'enfer est pavé de bonnes intentions" ? D'autre part, celui qui se pose en défenseur du Bien et de la morale, celui qui critique les mauvaises actions des autres sans agir le moins du monde lui-même, celui-là a été qualifié (notamment par Hegel) de "belle âme". L'âme est "belle" parce qu'elle défend de beaux principes, et elle n'est pas souillée par l'action ; mais elle ne réalise pas que le fait de ne rien faire… constitue un acte à part entière, le plus souvent condamnable : laisser faire, c'est faire !
- Rousseau (18è) - "Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie : nous pouvons être hommes sans être savants ; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale, nous avons à moindres frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le suivre. S'il parle à tous les coeurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent ? Eh ! c'est qu'il nous parle la langue de la nature, que tout nous a fait oublier. La conscience est timide, elle aime la retraite et la paix ; le monde et le bruit l'épouvantent : les préjuges dont on la fait naître sont ses plus cruels ennemis ; elle fuit ou se tait devant eux : leur voix bruyante étouffe la sienne et l'empêche de se faire entendre ; le fanatisme ose la contrefaire, et dicter le crime en son nom. Elle se rebute enfin à force d'être éconduite ; elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus, et, après de si longs mépris pour elle, il en coûte autant de la rappeler qu'il en coûta de la bannir." D'où vient la conscience morale ? Si l'on a reconnu l'autonomie de la volonté morale, on a indiqué également que sa source, son origine (en rapport d'ailleurs avec sa finalité) devait être l'Autre, ou Autrui. Il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, l'on m'ait intimé l'ordre : "fais ceci, car c'est bien", pour que j'en sois venu à me l'ordonner moi-même. Quelle est donc l'origine de la conscience morale ? Pourquoi certains individus semblent totalement dépourvus de conscience morale ? Est-elle d'origine naturelle ou sociale ? Résumons trois thèses en la matière, pour faire vite. 1) Jean-Jacques Rousseau prétend trouver les principes de la moralité (c’est-à-dire la conscience morale) “au fond de mon cœur, écrits en caractères ineffaçables” ; c’est une “voix intérieure” qui est un “principe inné de justice et de vertu”. Elle dérive de la faculté propre à l'être humain de s'identifier à son semblable et donc de compatir à ses malheur : parce que je peux m'imaginer à sa place, et parce que j'ai une sensibilité, je ne veux pas naturellement de mal à autrui. Pour Rousseau, la conscience est à la fois la voix de Dieu et celle de la nature, et c’est la société qui nous empêche de l’entendre. 2) Pour Kant également, la conscience morale a un caractère inné ; mais elle ne résulte pas de la sensibilité et de la pitié, seulement de la Raison présente en chaque homme, qui lui indique par définition même le caractère universel des valeurs morales, après toutefois que l'éduction ait pu être menée à terme. Effectivement, on ne saurait trop souligner l'importance de l'éducation dans la genèse du sens moral chez l'individu. Seulement, comment expliquer dès que certains individus apparemment "raisonnables" et bien éduqués se transforment en délinquants ou en criminels ? 3) D'où une troisième explication qui va ajouter à ces arguments une dimension affective profonde, ainsi que la notion d'identification. Freud a assimilé la conscience morale à un aspect très particulier du psychisme qu'il a nommé "le surmoi". Il le définit comme "l'intériorisation des interdits parentaux". Se pose alors la question de savoir comment cette intériorisation a pu s'effectuer. Réponse : par une identification du sujet-enfant à un sujet-adulte, qui permet entre autres la transmission des valeurs morales. Qu'est-ce qui rend possible une telle identification ? Réponse : l'amour ou l'affection profonde liant deux êtres intimes (comme les parents et les enfants). On ne s'identifie qu'à un être aimé et qui vous aime ! Avec ce nouveau schéma explicatif, il devient plus facile de comprendre la cause d'une absence de conscience morale, par exemple chez ceux que la voix populaire nomme des "monstres". Des monstres immoraux, sans doute, qui probablement ont été des enfants privés d'affection et d'amour.
- Rousseau (18è) - "Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie : nous pouvons être hommes sans être savants ; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale, nous avons à moindres frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le suivre. S'il parle à tous les coeurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent ? Eh ! c'est qu'il nous parle la langue de la nature, que tout nous a fait oublier. La conscience est timide, elle aime la retraite et la paix ; le monde et le bruit l'épouvantent : les préjuges dont on la fait naître sont ses plus cruels ennemis ; elle fuit ou se tait devant eux : leur voix bruyante étouffe la sienne et l'empêche de se faire entendre ; le fanatisme ose la contrefaire, et dicter le crime en son nom. Elle se rebute enfin à force d'être éconduite ; elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus, et, après de si longs mépris pour elle, il en coûte autant de la rappeler qu'il en coûta de la bannir." D'où vient la conscience morale ? Si l'on a reconnu l'autonomie de la volonté morale, on a indiqué également que sa source, son origine (en rapport d'ailleurs avec sa finalité) devait être l'Autre, ou Autrui. Il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, l'on m'ait intimé l'ordre : "fais ceci, car c'est bien", pour que j'en sois venu à me l'ordonner moi-même. Quelle est donc l'origine de la conscience morale ? Pourquoi certains individus semblent totalement dépourvus de conscience morale ? Est-elle d'origine naturelle ou sociale ? Résumons trois thèses en la matière, pour faire vite. 1) Jean-Jacques Rousseau prétend trouver les principes de la moralité (c’est-à-dire la conscience morale) “au fond de mon cœur, écrits en caractères ineffaçables” ; c’est une “voix intérieure” qui est un “principe inné de justice et de vertu”. Elle dérive de la faculté propre à l'être humain de s'identifier à son semblable et donc de compatir à ses malheur : parce que je peux m'imaginer à sa place, et parce que j'ai une sensibilité, je ne veux pas naturellement de mal à autrui. Pour Rousseau, la conscience est à la fois la voix de Dieu et celle de la nature, et c’est la société qui nous empêche de l’entendre. 2) Pour Kant également, la conscience morale a un caractère inné ; mais elle ne résulte pas de la sensibilité et de la pitié, seulement de la Raison présente en chaque homme, qui lui indique par définition même le caractère universel des valeurs morales, après toutefois que l'éduction ait pu être menée à terme. Effectivement, on ne saurait trop souligner l'importance de l'éducation dans la genèse du sens moral chez l'individu. Seulement, comment expliquer dès que certains individus apparemment "raisonnables" et bien éduqués se transforment en délinquants ou en criminels ? 3) D'où une troisième explication qui va ajouter à ces arguments une dimension affective profonde, ainsi que la notion d'identification. Freud a assimilé la conscience morale à un aspect très particulier du psychisme qu'il a nommé "le surmoi". Il le définit comme "l'intériorisation des interdits parentaux". Se pose alors la question de savoir comment cette intériorisation a pu s'effectuer. Réponse : par une identification du sujet-enfant à un sujet-adulte, qui permet entre autres la transmission des valeurs morales. Qu'est-ce qui rend possible une telle identification ? Réponse : l'amour ou l'affection profonde liant deux êtres intimes (comme les parents et les enfants). On ne s'identifie qu'à un être aimé et qui vous aime ! Avec ce nouveau schéma explicatif, il devient plus facile de comprendre la cause d'une absence de conscience morale, par exemple chez ceux que la voix populaire nomme des "monstres". Des monstres immoraux, sans doute, qui probablement ont été des enfants privés d'affection et d'amour.
Mais outre la conscience "psychologique" et la "conscience morale", on distingue classiquement un troisième niveau de conscience qui fonctionne également "à la" reconnaissance : c'est la conscience intellectuelle, celle qui conçoit et manie les idées… Que peut-elle bien chercher à reconnaître si ce n'est la vérité elle-même ?
-
La "prise de conscience" ou la reconnaissance de la vérité : au-delà de l'opinion (aspect intellectuel)
L'expression "prise de conscience" a l’immense intérêt de “dé-substantialiser” presque entièrement la conscience : on n’en fait plus un état mais un processus, un mouvement, un progrès. On croit généralement qu'on est conscient comme on respire, mais c'est un tort ; on est conscient comme on marche. La conscience, c'est comme de se tenir droit, ça demande un effort. Un effort, ou plutôt une attention. A quoi ? A la réalité… - La fonction des événements :
Le problème se pose en ces termes : on peut être conscient au sens de éveillé, et en même temps avoir besoin d'être réveillé, au sens où l'on pourrait bien vivre dans l'illusion… On pourrait même être conscient de soi mais en même temps être déconnecté de la réalité. Dans ce sens, "prendre conscience" serait une reconnection avec la réalité : comme si, finalement, la conscience vraie était moins un rapport à soi (1ère partie) qu'un rapport véridique avec la réalité. En effet, prendre conscience, c'est toujours prendre conscience d'une vérité, de la vérité de quelque chose. Et c'est la réalité qui nous l'apprend. Un instant de réalité qui nous apprend quelque chose, qui nous éveille à quelque chose, cela s'appelle un événement. C'est la fonction des événements de nous faire prendre conscience de quelque nouveauté essentielle. Un événement est un changement brusque dans la réalité, qui nous fait prendre conscience d'une vérité jusque là ignorée, ou bien refoulée, oubliée. On prend toujours conscience d'une vérité par rapport à un savoir qui s'avère finalement erroné, illusoire, ou bien insuffisant ; comme la prise de conscience par opposition à la conscience, la vérité est émergente, distincte du savoir qu'elle va servir à réformer .
- L'éveillé et l'éveilleur : Bouddha et Socrate
 Bouddha : il se présente lui-même comme une éveillé, celui qui est parvenu à s'affranchir de la Grande Illusion. Quelle est-elle ? La croyance en l'individualité du moi, de la conscience ! L'aliénation aux désirs changeants et vains. Il faut prendre conscience du "Soi" universel que nous sommes réellement, et "lâcher prise" (principe zen).
Bouddha : il se présente lui-même comme une éveillé, celui qui est parvenu à s'affranchir de la Grande Illusion. Quelle est-elle ? La croyance en l'individualité du moi, de la conscience ! L'aliénation aux désirs changeants et vains. Il faut prendre conscience du "Soi" universel que nous sommes réellement, et "lâcher prise" (principe zen).
Le problème se pose en ces termes : on peut être conscient au sens de éveillé, et en même temps avoir besoin d'être réveillé, au sens où l'on pourrait bien vivre dans l'illusion… On pourrait même être conscient de soi mais en même temps être déconnecté de la réalité. Dans ce sens, "prendre conscience" serait une reconnection avec la réalité : comme si, finalement, la conscience vraie était moins un rapport à soi (1ère partie) qu'un rapport véridique avec la réalité. En effet, prendre conscience, c'est toujours prendre conscience d'une vérité, de la vérité de quelque chose. Et c'est la réalité qui nous l'apprend. Un instant de réalité qui nous apprend quelque chose, qui nous éveille à quelque chose, cela s'appelle un événement. C'est la fonction des événements de nous faire prendre conscience de quelque nouveauté essentielle. Un événement est un changement brusque dans la réalité, qui nous fait prendre conscience d'une vérité jusque là ignorée, ou bien refoulée, oubliée. On prend toujours conscience d'une vérité par rapport à un savoir qui s'avère finalement erroné, illusoire, ou bien insuffisant ; comme la prise de conscience par opposition à la conscience, la vérité est émergente, distincte du savoir qu'elle va servir à réformer .
- L'éveillé et l'éveilleur : Bouddha et Socrate
Socrate : - Platon (Socrate dit :) : "Voyons, que signifie la parole du dieu ? quel sens y est caché ? j'ai conscience, moi, que je ne suis ni savant ni peu ni beaucoup. Que veut-il donc dire, quand il affirme que je suis le plus savant ?" “Accoucher les autres est contrainte que le dieu m’impose ; procréer est puissance dont il m’a écarté.” Pour Socrate, la Grande Illusion est constituée par le règne de l'Opinion, le "grands n'importe quoi" des idées, la démission de la raison et de la conscience. Démarche très différente de celle du Bouddha ! D'autre part Socrate ne se présente pas comme un éveillé ou comme un savant, mais comme un éveilleur et un ignorant. La formule "connais-toi toi-même" signifie bien, en un sens : réveille-toi ! C'est-à-dire "prend conscience", de tes illusions, de tes fausses opinions. Socrate démonte ainsi le faux savoir des pédants, des sophistes et des rhéteurs. Sa technique : démasquer le faux savoir en amenant ses interlocuteurs jusqu'à l'auto-contradiction, et leur faire prendre conscience qu’ils ne savent pas. Savoir qu'on ne sait pas : voilà un premier savoir très solide !
- On pourtant on sait... (la théorie platonicienne de la "réminiscence") : Et pourtant on sait des choses ! Mais on les a oubliées… C'est la théorie platonicienne de la "réminiscence". C'est bien en ce sens que la philosophe n'est pas seulement un critique, ou même un simple raisonneur, mais aussi un éveilleur, et même un accoucheur. Un accoucheur de vérité. Certes cette vérité c’est d’abord que l’on ne sait pas. Que la vérité est toujours au-delà de l'opinion personnelle. Mais c’est aussi que l’on a su, ou que l’on sait sans le savoir ; d’un savoir éternel qui était celui de l'âme contemplatrice des essences quand elle n'était pas corrompue avec le corps. L'éveil ou la prise de conscience véritable se présente comme une réminiscence de ce savoir éternel. Mais la réminiscence n’est pas le souvenir. Elle constitue un effort intellectuel complexe (c'est la philosophie !) qui peut mener à la contemplation des Idées (c'est la sagesse !).
Transition - Si la "prise conscience" est le mouvement par lequel la vérité advient à la conscience, on en déduira que la conscience est moins un état statique qu'un mouvement vers le monde, voire une rencontre avec la réalité. Finalement c'est le mouvement même du "pour soi", mouvement de reconnaissance, qui d'une certaine façon fait "sortir" la conscience du moi individuel et l'amène vers d'autres horizons, comme hors-de-soi…
3) La Conscience hors-de-soi et les formes objectives de la Conscience
- On pourtant on sait... (la théorie platonicienne de la "réminiscence") : Et pourtant on sait des choses ! Mais on les a oubliées… C'est la théorie platonicienne de la "réminiscence". C'est bien en ce sens que la philosophe n'est pas seulement un critique, ou même un simple raisonneur, mais aussi un éveilleur, et même un accoucheur. Un accoucheur de vérité. Certes cette vérité c’est d’abord que l’on ne sait pas. Que la vérité est toujours au-delà de l'opinion personnelle. Mais c’est aussi que l’on a su, ou que l’on sait sans le savoir ; d’un savoir éternel qui était celui de l'âme contemplatrice des essences quand elle n'était pas corrompue avec le corps. L'éveil ou la prise de conscience véritable se présente comme une réminiscence de ce savoir éternel. Mais la réminiscence n’est pas le souvenir. Elle constitue un effort intellectuel complexe (c'est la philosophie !) qui peut mener à la contemplation des Idées (c'est la sagesse !).
Transition - Si la "prise conscience" est le mouvement par lequel la vérité advient à la conscience, on en déduira que la conscience est moins un état statique qu'un mouvement vers le monde, voire une rencontre avec la réalité. Finalement c'est le mouvement même du "pour soi", mouvement de reconnaissance, qui d'une certaine façon fait "sortir" la conscience du moi individuel et l'amène vers d'autres horizons, comme hors-de-soi…
3) La Conscience hors-de-soi et les formes objectives de la Conscience
-
L’intentionnalité
- Sartre (20è) – "Connaître, c'est « s'éclater vers», s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par delà soi, vers ce qui n'est pas soi, là-bas, près de l'arbre et cependant hors de lui, car il m'échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en lui qu'il ne se peut diluer en moi: hors de lui, hors de moi. (…) Du même coup, la conscience s'est purifiée, elle est claire comme un grand vent, il n'y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi; si, par impossible, vous entriez « dans» une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au dehors, près de l'arbre, en pleine poussière, car la conscience n'a pas de « dedans» ; elle n'est rien que le dehors d'elle-même et c'est cette fuite absolue, ce refus d'être substance qui la constituent comme une conscience."
Pour  le philosophe Husserl, et plus tard Sartre, la conscience se définit comme un "vécu", mais pas seulement en terme d'intériorité. c'est avant tout une relation, une direction vers-. Le “soi” de la conscience doit être paradoxalement pensé comme “hors-de-soi”, ou plus exactement comme un rapport avec un objet. La conscience n’est même pas “en rapport”, elle “est” ce rapport. Ce rapport dit de “transcendance”, c’est-à-dire cet écart obligé entre le sujet et l’objet, sans absorption possible de l’un par l’autre, c’est ce qu’on nomme l’intentionnalité. On a beaucoup exagéré l'aspect "réflexif" de la conscience, comme si le fait de "se penser" avait un sens. Non, il faut se souvenir que l'on pense toujours à quelque chose d'autre. La conscience est toujours conscience de quelque chose, elle "vise" ou elle "pose" un objet : comme le dit Jean-Paul Sartre "la conscience est positionnelle d'objet", mais "elle est non-positionnelle de soi". Elle est intentionnelle au sens où elle se tourne vers quelque chose, elle est ce mouvement, cette ouverture vers le monde. En conséquence, la conscience n’est pas un intérieur clos et ne peut l’être.
le philosophe Husserl, et plus tard Sartre, la conscience se définit comme un "vécu", mais pas seulement en terme d'intériorité. c'est avant tout une relation, une direction vers-. Le “soi” de la conscience doit être paradoxalement pensé comme “hors-de-soi”, ou plus exactement comme un rapport avec un objet. La conscience n’est même pas “en rapport”, elle “est” ce rapport. Ce rapport dit de “transcendance”, c’est-à-dire cet écart obligé entre le sujet et l’objet, sans absorption possible de l’un par l’autre, c’est ce qu’on nomme l’intentionnalité. On a beaucoup exagéré l'aspect "réflexif" de la conscience, comme si le fait de "se penser" avait un sens. Non, il faut se souvenir que l'on pense toujours à quelque chose d'autre. La conscience est toujours conscience de quelque chose, elle "vise" ou elle "pose" un objet : comme le dit Jean-Paul Sartre "la conscience est positionnelle d'objet", mais "elle est non-positionnelle de soi". Elle est intentionnelle au sens où elle se tourne vers quelque chose, elle est ce mouvement, cette ouverture vers le monde. En conséquence, la conscience n’est pas un intérieur clos et ne peut l’être.
-
Conscience et existence
- Sartre - “Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c’est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes.” La conscience est donc une projection dans le monde, un “éclatement”. Or cela définit aussi bien l'"existence" selon les philosophes existentialistes : l’existence humaine (ek-sistence) est une extériorisation, elle s’oppose à l’être inerte des choses. Les choses se contentent d'être "ce qu'elles sont" ; un être humain existe c'est-à-dire qu'il tend aussi vers ce qu'il n'est pas encore, avec cette particularité de pouvoir nier ce qu'il est ; en ce sens, la conscience produit du néant, elle est un pouvoir néantisateur et libérateur. Vivre dans le monde, s’extirper hors de soi n'est pas seulement le fait de la conscience, la condition propre de l'homme, cela devient même un devoir, une règle de vie. C’est ainsi qu’apparaît dans la philosophie de Sartre le thème de l’"engagement". Engagement dans l’histoire, la politique (une cause, un parti), l'écriture, une relation amoureuse, etc. La conscience est plus que jamais activité et non passivité, exigence envers soi et non jouissance de soi, résistance et non soumission, fidélité et autres et aux événements vécus en commun. Il est temps d'explorer une dimension capitale de cette relation avec le monde et avec autrui qui semble définir la conscience. Il s'agit du langage, avec une question-limite : ce qu'on appelle conscience ne serait-il pas finalement un mode intériorisé de la fonction du langage ? Il faudrait alors commencer à relativiser le rôle et l'importance de la conscience…
-
Conscience et langage
Il faut mettre en évidence le rapport étroit entre la conscience et le langage, avec la "fonction symbolique" en général. Serions-nous conscients si nous ne pouvions nous parler à nous-mêmes "intérieurement" ? Que signifie "se représenter quelque chose" si ce n'est à l'aide des mots ? Bien des philosophes ont souligné ce lien, mais c'était souvent pour faire du langage une simple conséquence de la conscience. La question de savoir "comment penser sans les mots" était simplement évacuée ! D'autres, comme Hegel, ont clairement établi qu'il n'était pas question de concevoir des idées sans être capable de les exprimer clairement : une idée qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas exprimer n'est tout simplement pas une idée. Nietzsche a développé une théorie beaucoup plus radicale, qui a pour conséquence de remettre en question le statut privilégié de la conscience – ouvrant par conséquent la voie aux conceptions de Freud sur l'Inconscient.
- Nietzsche (19è) - "La conscience n'est en somme qu'un réseau de communications d'homme à homme, ce n'est que comme telle qu'elle a été forcée de se développer : l'homme solitaire et bête de proie aurait pu s'en passer. Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos mouvements parviennent à notre conscience du moins en partie est la conséquence d'une terrible nécessité qui a longtemps dominé l'homme : étant l'animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d'aide et de protection, il avait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible et pour tout la il lui fallait d'abord la « conscience », pour « savoir » lui-même ce qui lui manquait, « savoir » quelle était sa disposition d'esprit, « savoir » ce qu'il pensait. Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus médiocre et la plus superficielle ; car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication par quoi l'origine même de la conscience se révèle. (…) Mon idée est, on le voit, que la conscience ne fait pas proprement partie de l'existence individuelle de l'homme, mais plutôt de ce qui appartient chez lui à la nature de la communauté et du troupeau ; que, par conséquent, la conscience n'est développée d'une façon subtile que par rapport à son utilité pour la communauté et le troupeau, donc que chacun de nous, malgré son désir de se comprendre soi-même aussi individuellement que possible, malgré son désir « de se connaître soi-même », ne prendra toujours conscience que de ce qu'il y a de non-individuel chez lui, de ce qui est « moyen » en lui, que notre pensée elle-même est sans cesse en quelque sorte écrasée par le caractère propre de la conscience, par le « génie de l'espèce » qui la commande et retraduite dans la perspective du troupeau. Tous nos actes sont au fond incomparablement personnels, uniques, immensément individuels, il n'y a à la aucun doute ; mais dès que nous les transcrivons dans la conscience, il ne parait plus qu'il en soit ainsi..." Nietzsche affirme que la conscience n'a pu se développer chez l'homme qu'avec le besoin de communiquer, donc avec le langage. A l'origine, l'homme a dû compenser la perte de ses instincts et une relative faiblesse physique par un accroissement démesuré de la fonction du langage : la pensée existe aussi sous une forme inconsciente et quasiment physique, pulsionnelles, mais pour communiquer il faut que la pensée devienne consciente, commune, simplifiée, assagie, "arrangeante" et menteuse… D'abord il nous faut nous persuader nous-mêmes que "nous" existons en-dehors de nos actes, que nous sommes des "sujets" séparés et auteurs de nos actes. Mais nous ne somme sujets que lorsque nous agissons, lorsque nous assumons ce que Nietzsche appelle notre "volonté de puissance". Au fond celui-ci remet en cause la notion même de sujet. Il ne faut pas dire "je pense" mais "ça pense". Et il remet en cause le primat de la conscience, celle-ci étant tout simplement une ennemie de la Vie. Lorsque la conscience émerge, lorsque la communication remplace l'action, la pensée faiblit, devient veule et hypocrite. La conscience a quelque chose d'artificiel, de négatif, de "réactif" : c’est au fond un réflexe de défense, un repli sur soi, qui profite à l'espèce (le "troupeau") beaucoup plus qu'à l'individu. Car pendant que nous parlons, l'individu en nous ne s'exprime pas.
La philosophie contemporaine et les sciences sociales sont repris cette hypothèse. N'y a t-il pas en effet une sorte de conscience "collective" faite de langage qui aurait finalement plus d'impact sur moi-même que ma propre conscience, que mes propres pensées personnelles ? Ce que j'appelle "ma" conscience n'est-il pas avant tout un phénomène social, ou au moins d'origine sociale ?
- Nietzsche (19è) - "La conscience n'est en somme qu'un réseau de communications d'homme à homme, ce n'est que comme telle qu'elle a été forcée de se développer : l'homme solitaire et bête de proie aurait pu s'en passer. Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos mouvements parviennent à notre conscience du moins en partie est la conséquence d'une terrible nécessité qui a longtemps dominé l'homme : étant l'animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d'aide et de protection, il avait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible et pour tout la il lui fallait d'abord la « conscience », pour « savoir » lui-même ce qui lui manquait, « savoir » quelle était sa disposition d'esprit, « savoir » ce qu'il pensait. Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus médiocre et la plus superficielle ; car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication par quoi l'origine même de la conscience se révèle. (…) Mon idée est, on le voit, que la conscience ne fait pas proprement partie de l'existence individuelle de l'homme, mais plutôt de ce qui appartient chez lui à la nature de la communauté et du troupeau ; que, par conséquent, la conscience n'est développée d'une façon subtile que par rapport à son utilité pour la communauté et le troupeau, donc que chacun de nous, malgré son désir de se comprendre soi-même aussi individuellement que possible, malgré son désir « de se connaître soi-même », ne prendra toujours conscience que de ce qu'il y a de non-individuel chez lui, de ce qui est « moyen » en lui, que notre pensée elle-même est sans cesse en quelque sorte écrasée par le caractère propre de la conscience, par le « génie de l'espèce » qui la commande et retraduite dans la perspective du troupeau. Tous nos actes sont au fond incomparablement personnels, uniques, immensément individuels, il n'y a à la aucun doute ; mais dès que nous les transcrivons dans la conscience, il ne parait plus qu'il en soit ainsi..." Nietzsche affirme que la conscience n'a pu se développer chez l'homme qu'avec le besoin de communiquer, donc avec le langage. A l'origine, l'homme a dû compenser la perte de ses instincts et une relative faiblesse physique par un accroissement démesuré de la fonction du langage : la pensée existe aussi sous une forme inconsciente et quasiment physique, pulsionnelles, mais pour communiquer il faut que la pensée devienne consciente, commune, simplifiée, assagie, "arrangeante" et menteuse… D'abord il nous faut nous persuader nous-mêmes que "nous" existons en-dehors de nos actes, que nous sommes des "sujets" séparés et auteurs de nos actes. Mais nous ne somme sujets que lorsque nous agissons, lorsque nous assumons ce que Nietzsche appelle notre "volonté de puissance". Au fond celui-ci remet en cause la notion même de sujet. Il ne faut pas dire "je pense" mais "ça pense". Et il remet en cause le primat de la conscience, celle-ci étant tout simplement une ennemie de la Vie. Lorsque la conscience émerge, lorsque la communication remplace l'action, la pensée faiblit, devient veule et hypocrite. La conscience a quelque chose d'artificiel, de négatif, de "réactif" : c’est au fond un réflexe de défense, un repli sur soi, qui profite à l'espèce (le "troupeau") beaucoup plus qu'à l'individu. Car pendant que nous parlons, l'individu en nous ne s'exprime pas.
La philosophie contemporaine et les sciences sociales sont repris cette hypothèse. N'y a t-il pas en effet une sorte de conscience "collective" faite de langage qui aurait finalement plus d'impact sur moi-même que ma propre conscience, que mes propres pensées personnelles ? Ce que j'appelle "ma" conscience n'est-il pas avant tout un phénomène social, ou au moins d'origine sociale ?
-
Conscience de classe et conscience collective
- Marx (19è) – "Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience." Marx, avec Nietzsche et Freud, est le troisième penseur à avoir sérieusement mis en doute le statut central de la conscience chez l'homme. Pour Marx c'est la société qui fabrique et détermine jusqu'à notre propre conscience personnelle, et c'est l'économie, les forces productives matérielles qui sont à l'origine des idées…
 On avait cru jusqu'à présent que la conscience, en tant qu'individuelle, était notre propriété, à l'abri de toutes les influences extérieures. Or non seulement notre conscience est déterminée par notre existence sociale, mais encore elle est le reflet (pour une part au moins) de la classe sociale à laquelle on appartient. Par exemple, le fait de penser que notre conscience est notre propriété sacrée est justement une illusion de bourgeois ! Comme Nietzsche et Freud, Marx est frappé par la formidable impuissance de la conscience lorsqu'il s'agit de changer effectivement la réalité. On ne change la réalité (Marx veut changer la réalité sociale de son temps, la domination politique et sociale de la bourgeoisie) qu'en s'en donnant les moyens matériels (il faut confisquer les biens matériels des bourgeois) et en agissant réellement sans s'embarrasser de scrupules moraux (il faut faire la Révolution). Bref ce qu'on appelle la "conscience" n'est finalement qu'un symptôme déterminé d'une réalité sociale et historique complexe.
On avait cru jusqu'à présent que la conscience, en tant qu'individuelle, était notre propriété, à l'abri de toutes les influences extérieures. Or non seulement notre conscience est déterminée par notre existence sociale, mais encore elle est le reflet (pour une part au moins) de la classe sociale à laquelle on appartient. Par exemple, le fait de penser que notre conscience est notre propriété sacrée est justement une illusion de bourgeois ! Comme Nietzsche et Freud, Marx est frappé par la formidable impuissance de la conscience lorsqu'il s'agit de changer effectivement la réalité. On ne change la réalité (Marx veut changer la réalité sociale de son temps, la domination politique et sociale de la bourgeoisie) qu'en s'en donnant les moyens matériels (il faut confisquer les biens matériels des bourgeois) et en agissant réellement sans s'embarrasser de scrupules moraux (il faut faire la Révolution). Bref ce qu'on appelle la "conscience" n'est finalement qu'un symptôme déterminé d'une réalité sociale et historique complexe.
- Durkheim (19è) - “La conscience collective est ’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une société.” L’expression de "conscience collective" a été forgée par le sociologue Emile Durkheim. Elle traduit aussi la prise en compte de l'élément social, mais elle est dépourvue de signification politique militante. Elle s’applique aux micro- comme aux macro-sociétés, aux groupes sociaux-professionnels comme aux peuples. Il y a (peut-être) une conscience collective européenne, des consciences collectives nationales, professionnelles, socio-culturelles, ethniques, etc. En tant que telle la conscience collective est un phénomène objectif, c'est-à-dire observable et quantifiable. On se persuadera du bien-fondé de cette notion si l'on s'avise qu'une bonne partie des "affaires", du commerce, de la publicité, etc. repose sur une analyse scrupuleuse et en temps réel de telles consciences collectives (pratique des "sondages"). Nous savons que les médias nous "manipulent" plus ou moins volontairement ; nous savons bien par exemple que, faute d'étudier une question d'actualité à fond, nous n'avons pas d'opinion personnelle, nous ne sommes qu'une caisse de résonance de l'opinion générale fabriquée par les médias. Notre vie privée, intime ? Est-elle épargnée ? Hélas, nous savons bien également nos conduites les plus privées (familiales, alimentaires, sexuelles, etc.) sont également conditionnées par un discours commun, la mode, des fantasmes collectifs…
Conclusion : la connaissance de soi ?
- Durkheim (19è) - “La conscience collective est ’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une société.” L’expression de "conscience collective" a été forgée par le sociologue Emile Durkheim. Elle traduit aussi la prise en compte de l'élément social, mais elle est dépourvue de signification politique militante. Elle s’applique aux micro- comme aux macro-sociétés, aux groupes sociaux-professionnels comme aux peuples. Il y a (peut-être) une conscience collective européenne, des consciences collectives nationales, professionnelles, socio-culturelles, ethniques, etc. En tant que telle la conscience collective est un phénomène objectif, c'est-à-dire observable et quantifiable. On se persuadera du bien-fondé de cette notion si l'on s'avise qu'une bonne partie des "affaires", du commerce, de la publicité, etc. repose sur une analyse scrupuleuse et en temps réel de telles consciences collectives (pratique des "sondages"). Nous savons que les médias nous "manipulent" plus ou moins volontairement ; nous savons bien par exemple que, faute d'étudier une question d'actualité à fond, nous n'avons pas d'opinion personnelle, nous ne sommes qu'une caisse de résonance de l'opinion générale fabriquée par les médias. Notre vie privée, intime ? Est-elle épargnée ? Hélas, nous savons bien également nos conduites les plus privées (familiales, alimentaires, sexuelles, etc.) sont également conditionnées par un discours commun, la mode, des fantasmes collectifs…
Conclusion : la connaissance de soi ?
Finalement, nous avons le sentiment de ne plus nous connaître, parce que le doute s'est installé concernant l'origine et la transparence même de notre conscience. Si l'on en croit ces "maîtres du soupçon" que sont Nietzsche, Marx et Freud, on finirait par croire que la conscience n'est pas synonyme de connaissance mais au contraire d'illusion ! Un comble ! Mais au fond, qu'enseignent les philosophes depuis Socrate ? Nous conseillent-ils autre chose que de mener la lutte contre la "grande illusion", à laquelle participe bien sûr la croyance naïve en notre propre autonomie de pensée ? Ce n'est pas parce que le mensonge et l'illusion dominent le monde (c'est normal, c'est leur but même, leur raison d'être !), qu'il ne faut pas résister et tenter de se libérer. Si le terme de conscience signifie quelque chose de réel, il s'accorde avec celui de connaissance au moins dans le processus de prise de conscience. Encore ne s'agit-il pas, à proprement parler, d'une connaissance de soi, mais plutôt de la réalité. C'est en effet la notion de "moi" qui pose le plus de problème : il faudrait être naïf pour croire que l'individualité forme une unité à la fois saisissable et en paix avec elle-même. Freud a proposé la théorie de l'Inconscient psychique pour rendre compte justement des divisions du moi. Curieusement, il continue de préconiser la "connaissance de soi", à condition d'accepter justement l'existence d'une part inconnue et insaisissable du sujet, l'Inconscient. Sans la prise en compte de cet aspect, toute tentative de connaissance de soi serait irrémédiablement vouée à l'échec. (> cours sur l'Inconscient)
Document de Didier Moulinier








 ème visiteur
ème visiteur