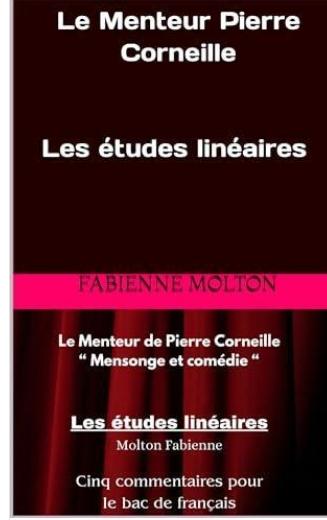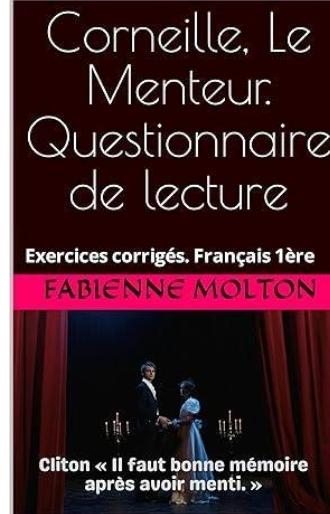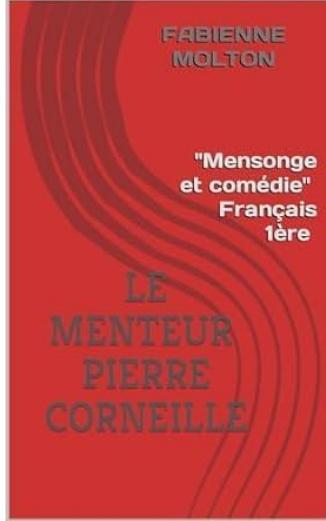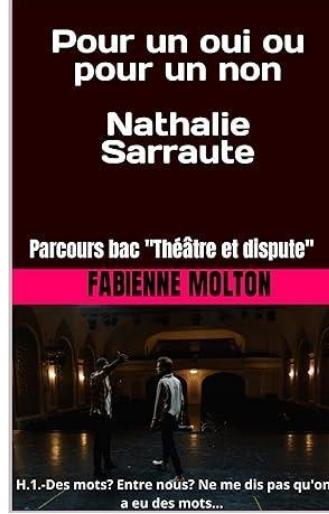Le philosophe doit-il perdre la tête? Conférence de Jean Maurel
Le philosophe doit-il perdre la tête?
- Conférence
- Jean Maurel
- Penser à tête perdue
-
Le problème du philosophe, une affaire de tête?
Question comique et légère à la Gaudissart, ce commis voyageur dont la partie était le chapeau et, reconnaissant envers la chapellerie, disait que c’était en travaillant l’extérieur de la tête qu’il en avait compris l’intérieur;
Mais aussi bien question grave, à la Hamlet devant le crâne de Yorick.
Que faire d’une tête? Que peut une tête?
On demande bien : que peut un corps?
Question du port de tête :comment bien la porter? Mais qu’est-ce que porter une tête? Il y a tant de façon de porter. Au moins trois:
- porter, comme on dit porter bien ou beau.
- emporter : mais alors porter une tête c’est supposer qu’elle a quitté les épaules à moins qu’elle s’emporte?
- enfin porter comme on porte un enfant.
Le problème alors s’aggrave et la tête s’alourdit, devient pesante.
Le philosophe, homme de tête, mélancolique, se creuse et se prend la tête, à deux mains, au point que, souvent, il en vient à se dire : comment s‘en débarrasser?
Prise de tête, mal de tête, crise de tête.
Trop de tête tue la pensée.
Le penseur alors se demande comment il pourrait alléger sa pesanteur entêtée.
Ainsi lui vient l’idée vraiment précipitée et capitale de penser à tête perdue, comme on dit corps perdu. mais aussi cire perdue, pain perdu.
A vrai dire il entrevoit tout simplement qu’à porter trop haut sa tête il risque bien de la perdre totalement dans le délire, la bêtise ou la mort.
Il s’avise qu’on ne pense qu’à pencher la tête, l’incliner, faisant décliner sa hauteur éblouissante et impérative.
Si le numen divin commande au monde d’un signe de tête, ce signe n’est-il pas déjà une concession à la déclinaison des choses et des êtres comme en connivence avec elle?
Le paradoxe d’une tête pensive est dans l’inclination d’une pesée juste qui joue de la lourdeur pour l’alléger dans l’estimation la soupeser, la soulever pour mieux la porter et l’emporter. Comment ce geste n’engagerait-il pas le mouvement même du crâne qui se dispose à s’y livrer?
Penser à tête perdue, chercher à perdre la tête à penser, ne serait-ce pas alors comme bien perdre son temps?
A la recherche de la tête perdue :ce serait apprendre à risquer sa tête pour mieux penser, non la perdre pour mieux la retrouver et la redresser, mais plutôt trouver le bon usage de sa tête et de sa pensée dans la perdition comme on dit à perte de vue, ou encore, comme Nietzsche un jour l’avouera, deviner le secret du devenir de la pensée et de la vie quand elles acceptent de se perdre, à cœur perdu, après avoir enfin trouvé leur bonne tenue.
N’est-ce pas ainsi se creuser la tête, se délivrer de cette forteresse qu’elle semble dessiner autour de la pensée et mettre à nu le crâne?
Étrange et paradoxale entreprise, s’il s’agit d’entrer sous le creux d’une boîte crânienne pour ouvrir la tête, enfin, au dehors lui permettre décidément d’être mise au monde, d’être exposée à ce qui peut vraiment la rendre féconde lui donner du corps.
Je voudrais avec vous, avec la multitude de vos têtes, tenter donc de soulever ou soupeser ce grave problème et le porter au jour :
en trois transports, aidé de trois porteurs, comme ceux qui emportent précisément la tête de Jean-Baptiste à la fin d’Hérodiade:
Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement.
Voici donc trois têtes :coupées et non coupées : comme on coupe des têtes et les cartes, chez Lewis Carroll, pour mieux les distribuer.
Portées alternativement, au double et triple sens de l’expression, par Platon puis Kant formant à deux une tête de Janus, une face vers le passé une face vers l’avenir, puis une multitude de crânes par la porte ainsi ouverte :
Ainsi surgissent :
- en tête, tête première - une tête solaire et solitaire
- puis une tête lunaire et étoilée
- Enfin une tête à tue-tête, tout à fait perdue comme celle du Neveu à l’entrée des Enfers. Sans tête, c’est cent têtes - la femme 100 têtes de Max Ernst selon un détournement de mot et de tête qui libère.
Une tête gigogne, ventriloque, qui porte et emporte avec elle toutes les autres : comme la verrue de Quasimodo, une tête voyante extralucide, une tête de mort, grotte de fou dans laquelle se retrouvent pour se perdre en échos infinis, en diffractions spectrales lumineuses, Shakespeare, Diderot, Hugo, Flaubert, Rimbaud, Nietzsche, Bataille, Sartre, Foucault, mais aussi Cézanne, Giacometti, Bonnard, Picasso etc.... et tête sera.
Disons qu’à porter ainsi sa tête et l’emporter, la faire rouler en tous sens de l’un à l’autre on ne peut que la donner à couper si c’est le mot de l’énigme, la trouvaille en attente impatiente de la perdition qui l’exige.
Toute pensée émet un coup de dé: mais cela ne dépend-t-il pas du coup de tête qui l’a lancé?
Perdre la tête? Ne pouvoir garder la mesure, devenir fou, perdre sa maîtrise pensante, l’autorité que donne l’exercice de la réflexion jusqu’à la faculté de penser l’image, la figure de rhétorique touche, frappe nécessairement à la tête qui s’affiche comme métonymie première de l’esprit, si le contenant, le réceptacle se donne pour le contenu.
Qu’un philosophe puisse, au cours de l’histoire, ou même de son histoire, succomber à une telle échéance, c’est un risque inévitable. Mais que le philosophe, en tant que tel, soit exposé à ce qui, alors ne peut être qu’une déchéance catastrophique, on hésitera à l’admettre : que dans son concept ou, plus littéralement encore, dans son idée, la philosophie perde la face et abîme le visage de celui qui prétend la représenter et en garder la vérité capitale, n’est-ce pas inadmissible et contradictoire? Pire encore cette déchéance pourrait-elle être le devoir, la destination et la chance de la pensée?
La philosophie n’est-elle pas l’affaire même de la tête, si celle-ci apparaît comme le sommet du corps où a lieu l’élévation de la pensée qui définit l’homme, si elle est comme son siège même, le lieu de sa visibilité, son visage qui tout à la fois fait voir et peut être vu, si elle se pense, dans la sphéricité de son apparence comme le site corporel où ça pense?
La tête exhibe montre, porte à l’évidence en avant et très haut le signe sensible de l’identité spéculative, métaphore entêtée, retenant tout mouvement qui la mettrait en porte-à-faux,
la ferait défaillir, récipient de la propriété du concept, amphore retournée sur son contenu
-gare à la fêlure! -n’est-elle pas la véritable anaphore de la pensée si elle est cette répétition de l’entête qui marque et remarque l’élévation ? N’ y a-t-il pas quelque chose d’étrangement impossible dans cet extérieur, dirait Gaudissart qui prétend manifester l’intérieur? La tête, tout à la fois, semble s’imposer comme le plus élevé et le plus intense du corps, donc comme une insistance instante, imposante mais aussi comme ce qui désigne aux yeux ce qu’ils ne peuvent
saisir, ce qui leur échappe : portrait en retrait absolu sur le point inassignable de l’intimité de l’esprit.
La glande pinéale, que Descartes situait sous le cerveau et dans laquelle il pensait voir la rencontre du dehors du corps de la multitude des esprits animaux et de l’unité de l’âme
n’est-elle pas comme l’inévitable jeu de ponctuation qui tente de signaler cette impossibilité?
Comment ne pas être fasciné par la présence superlative de cette cime corporelle, de ce comble, qui semble mimer la hauteur centripète et identifiante, se pose et s’impose, dans sa superposition, comme la boîte close sur soi de l’intériorité pensante et dont la bouche est porte-voix, les yeux, lumineuses fenêtres? Stupéfiante présence qui dit et manifeste une absence essentielle?
Le corps a-t-il à porter, supporter sa tête comme ce qui le porte et l’élève, lui donne sens contradictoirement, en s’imposant à lui, l’ « animant » à partir de ce qui le soumet et le domine?
Homo sapiens, c’est homo erectus, l’homme debout, ce qui distingue l’animal humain de tous les autres qui rampent, courent, tête baissée vers la terre: cette hauteur, cette position dominante et redressée pour voir, parler, diriger, commander, vouloir et ouvrir le monde devant elle sous elle, à sa main: au doigt et à l’oeil. La tête tient la terre et l’organise par la maîtrise du corps, la disposition de ce qu’il faut bien définir comme son corps.
La tête n’est-elle pas cette extrémité du corps qui possède celui-ci, qui l’ « a »?
Il y va bien de l’attitude même, de la position de la pensée, de sa tenue : de ce qui la tient, la retient, la contient, dans tous les sens stricts, rigoureux, de la formule et détermine, définit, informe et forme sa belle, vraie et juste Forme même, actualisation et fin, sens même de la matière corporelle qui s achève et s’accomplit en elle. Si l’âme est “quelque chose du corps” (sômatos ti) comme le pense Aristote, la tête qui porte la vue et la parole ne serait-elle pas ce corps du corps, cette entéléchie du corps qui l’accomplit en unifiant et orientant sa dispersion, son ouverture, sa “puissance”de mouvement et jouant le point de repos qui reprend le moteur immobile?
La tête, n’ est-ce pas le haut de l’armure qui dirige, organise et dresse, de pied en cap, la statue défensive, la déesse guerrière de la Sagesse, née par la tête, justement?
Cet impérieux, divin et royal port de tête n’a-t-il pas été, en Occident, comme le signe de reconnaissance, sinon de ralliement, des grands esprits jusqu’à ce dernier coup de tête, de menton, cet effet de cou, un peu de trop, au bord de l’abîme, cette Selbstbehauptung, (Discours de Rectorat de Heidegger) qui aura voulu, a défaillance des grandeurs humaines (République 497 d)?
La position dominante et princière de la pensée et de la tête qui la porte et la symbolise ne présuppose-t-elle pas une définition du discours dialectique qui veut en finir avec l’échange des opinions et la vitalité des débats, le corps ouvert et mobile du jeu des vérités au moment même où il prétend l’initier pédagogiquement et l’élever? Élever le débat en redressant la tête n’est-ce pas subrepticement vouloir imposer sa vérité sous prétexte de résoudre les problèmes et répondre aux questions?
Ouvrir la voie royale de la vérité en la présentant comme orientée et désignée par l’ordre organique de la vie, cela ne peut-il pas reposer sur un geste de fermeture qui coupe la parole?
Une tête peut-elle assurer son pouvoir, se dresser comme principe, sans implicitement supposer la décapitation des autres, sans chercher à faire de son autorité une supériorité exclusive? L’idée qu’ une tête doive dominer nécessairement un corps, c’est présupposer qu’il y a toujours finalement une fin qui est aussi un commencement, une fin dernière-première une idée des idées et un corps un élément du corps au-dessus des autres comme un sommet.
Comment pourrait-on oser effrontément discuter le principe aussi solidement assuré et installé de la Tête première, sinon par une contestation qui fait violence à cette installation anatomique qui sépare, élève et met à distance pour mieux retenir et replier, organiser, finaliser, rassembler dans une structure centripète et unifiée la puissance explosive, excentrique, centrifuge du corps?
Ne serait-ce pas un geste criminel étrangement parricide, que celui de mettre en question, à la question cette prééminence rare et insaisissable?
Un jour Victor Hugo eut l’étrange et cruelle idée de retrouver le sens littéral de la discussion et sa violence originaire: ainsi dessina-t-il une stupéfiante discutio: le duel au couteau, qui prend la langue au mot, (discutio, acte de fracasser, de fendre), terrible corps à corps sanglant d’une tête détachée d’un tronc dialoguant monstrueusement avec son corps décapité, d’une “tronche”en conversation avec un tronc, selon l’argot dès Misérables (Figure 1).
Lorsque Nietzsche dans les derniers temps de son exubérance turinoise, semble vraiment perdre la tête au point de s’identifier à des criminels dont les journaux annoncent l’exécution par décapitation – Prado, Chambige - ne serait-il pas lui aussi atteint de cette stupéfiante et tranchante folie justicière à l’égard du siège symbolique de la pensée et de l’autorité, de la pensée comme pouvoir?
L’horreur que peut inspirer - à Hugo comme à Nietzsche - la violence de la décapitation, celle d’une tête couronnée comme celle du dernier des criminels, ne fait pas faiblir le geste métaphorique: Il vaut mieux décapiter des idées que des hommes, avoue Hugo. Mieux, ne faudrait-il pas penser que la radicalité rageusement décapitante de la société qui réclame des têtes, témoigne encore, paradoxalement, de la sacralisation du chef du maître, du dieu, même chez celui qui se veut son exécuteur, son meurtrier? Si le corps du roi est sacralisé comme l’aura montré Kantorowitz, le parricide n’est-il pas condamné au délire vertigineux du substitut jaloux?
Si la scène qu’invente Hugo échappe à ce jeu abyssal du redoublement de l’horreur tyrannique, c’est qu’elle ouvre décidément béant l’espace d’un problème: elle exhibe franchement, tranchant à vif, la ligne de coupure, le bord critique, le double trait qui relie et sépare, qui tout à la fois révèle la division exclusive sur laquelle repose l’unité organique du tout finalisé de la vie, du corps, de la société, de la vérité dialectique et l’expose, la met décidément à nu, dans une mise en question - à la question - reprise humoristique qui l’ouvre décidément à la discussion. N’est-ce pas à la cuisine du dialecticien qui sait découper selon les articulations
pour mieux marquer la dépendance hiérarchisée des organes dans l’architecture métaphysique impérative de la vie, que riposte, que répond, avec humour, cette expérimentation monstrueuse?
La force de ce dépeçage violent, de cette opération artiste, selon le double trait de son découpage, est de montrer à la fois la coupure tranchante cachée sous la continuité naturelle qui institue la finalité de l’en-tête, et le paradoxe indécidable sur lequel s’ouvre la possibilité de toute discussion digne de ce nom: la décapitation détermine et définit aussi bien le corps que la tête: tout échange tête-à-tête ne rassemble que des décapités, s’il faut transgresser la position dominante de la tête sur le corps, pour retrouver l’égalité dans l’échange, le dialogue, le débat et l’affrontement loyal des opinions.
À vrai dire, si nous ne sommes pas encore prêts à accepter ce que la fulgurance elliptique de ce dessin suggère, c’est pourtant vers ce règlement de compte cruel, cet insupportable tête-à-tête, corps à corps, corps à tête, tête à corps que je voudrais faire pencher, de connivence, vos têtes, avec cette arrière-pensée qu’il y va là du juste destin critique de la pensée, si penser n’est pas l’exercice naturel d’une faculté mais la rencontre avec ce qui donne violemment à penser, comme le répète Deleuze et si, avec Foucault, le philosophe n’écrit que pour n’avoir plus de visage (Archéologie du savoir, Préface).
Qu’appelle-t-on penser? Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée? On sait que la langue allemande, mieux encore que la française, confond cette orientation avec un appel, une interpellation qui conduit, avec Kant, à l’aveugle, dans la nuit.
Ce qui donne à penser, ce qui donne signe de penser, ne serait-ce pas ainsi un signe de tête qui étrangement mêle dans le même mouvement mystérieux, le même instant défaillant, l’élévation et le déclin? Un imperceptible mais intense battement, le temps d’un d’œil, s’en prend à l’élévation de la tête et l’incline.
La pensée? Une insaisissable pesée - comme le disait Hugo avant Jean-Luc Nancy - qui met en déséquilibre l’assurance verticale d’une tête. Comme une insituable et inassignable pesanteur qui inquiète et incline l’élévation légère et flottante d’une tête quand elle s’offre à l’inconnu d’une rencontre, de l’altération contestatrice d’une autre tête.
Cela ne concerne pas seulement l’ouverture extérieure du dialogue et de l’échange mais bien ce qu’on pense être l’intériorité la plus intime de la réflexion.
Ne s’agit-il pas en effet, littéralement, de ce qui s’agite obscurément, et agite, au fond de la bouche, au creux de la tête qui énonce le cogito, cette façon étrange de s’agiter avec
soi-même, cet agôn intérieur dont Socrate voudrait nous convaincre qu’il est un dialogue silencieux de l’âme avec elle-même (Sophiste 263 e), formule trop conciliante, qui désigne une conversation finalement pacifiée et neutralisée, parce que décidant de la vérité, décidant d’en finir avec toute contestation, tout combat ouvert des idées qui n’est plus conçu que comme une agitation ventriloque (252 c): ce silence n’est-il pas imposé à la tension vive d’une explication, d’un polemos héroïque qui n’aura jamais pu, sinon par une violence supérieure, être contenu dans le retrait, la demeure d’une intériorité, se protègerait-elle dans les fastes des Palais de la Mémoire ou des cercles de cercles de l’Esprit chez soi auprès de soi?
Comment plus longtemps cacher que l’ effronterie de la question que je pose devant vous, ou plutôt, à laquelle je m’expose, au risque de me perdre et de perdre la face, voudrait tenter de rejoindre le mouvement élémentaire que recèle mais semble vouloir dénier, l’impassibilité imposante d’une tête pensante qui semble ne devoir accepter comme signes favorables que les signes d’acquiescement?
Comment faire comprendre, par quelles mimiques faire entendre, voir et sentir cette déclinaison, cette inclinaison, cette inclination qui rend pensif, cette pente
de la pensée comme il y a une pente de la rêverie, mais qui se distingue autant de la somnolence flottante que de la vigilance spéculative assurée d’elle-même, et expose sur la limite, sur les rivages très incertains de la perte de sens, au bord de la défaillance innommable qui a noms bêtise, folie, mort, faiblesse, mais qui aussi, très paradoxalement, est riche des secrets inouïs d’une intelligence animale, d’une sagesse folle, d’une vitalité résistante, d’une force dans la fragilité même?
Comment le philosophe pourrait-il non seulement être exposé à cette perdition qui est le lot malheureux de tout humain, mais encore penser devoir s’y exposer, voir en cette exposition la bonne destination de sa pensée? Donner un sens autre que complaisamment rhétorique et dérisoirement provocateur à cette invitation à perdre la tête comme juste engagement de philosophe, c’est ce geste déconcertant et fou, cette déchéance voulue et affirmée, que Nietzsche, peut-être, a tenté d’esquisser en invitant à inventer une nouvelle scène et un nouveau théâtre pour la chance de la pensée.
En fait, il vient heureusement et immédiatement à l’esprit que cette redoutable échéance avait déjà été répétée depuis longtemps, si l’on s’avise de prendre cette perdition comme le dernier acte d’un hiératisme tragique qui, très tôt, n’a pu dissiper l’ombre comique de la vérité renversante de son double : Socrate n’a pas seulement chez les cyniques sa réplique folle (Diogène est Sôcratès mainomenos) qui abîme sa grosse tête laide en museau canin au lieu de la transfigurer en icône divine, mais Aristophane, dans Les Oiseaux, n’hésite pas à le perdre chez les Sciapodes qui se font de l’ombre avec leurs pieds.
Ne suis-je pas, en ce jour, lunaire, dans l’inconfortable situation de ce condamné à mort du lundi, dont parle Freud, et qui ne peut s’en sortir, se montrer "crâne" comme on dit, et tenir tête, que grâce au défi de l’humour - très noir - de gibet ou de guillotine: « Voilà une semaine qui commence bien! » (Le mot d’esprit)?
Comment cacher en effet qu’à proposer un tel sujet on expose sa tête, à la sanction décapitante - mais décapante - du ridicule?
Peut-être doit-on, en défense, paradoxalement aggraver son cas d’un casque et d’une casquette tout à la fois protectrice et désarmante, qui puisse bien marquer décidément l’enjeu capital de cette question casse-tête, apparemment folle, en forme d’énigme d’autant plus dense qu’elle semble tout livrer dans la précipitation et exposer celui qui la risque et s’y risque au rôle de victime expiatoire.
Mais pour l’étude et dans l’intérêt supérieur de la Science qui exige peut-être cette avancée aventureuse au-delà de ce qui constitue la supériorité et l’autorité même: au-delà des rires. Non pour en triompher par quelque détour ironique, un sursaut de sérieux vengeur qui s’arme du rire de son ennemi pour mieux le faire taire mais, tout au contraire, pour assurer la légitimité profonde d’une contestation riante ou rieuse comme l’une des exigences critiques les plus essentielles de la pensée et de l’interrogation philosophique.
Si Socrate ose dire dans La République que l’archonte, le gardien de la vérité, n’est pas ami du rire et ne doit pas se livrer à un rire violent, car cela provoque en lui un déplacement, un déménagement aussi perturbant, à le mettre hors de lui-même (388 e), est-on sûr que l’accoucheur de Théétète réussisse vraiment à exorciser et désamorcer la machine infernale, très naïve apparemment, du rire d’une simple servante qui se paie la tête d’un philosophe - Thalès en l’occurrence- tête en l’air, dans les étoiles?
Si l’on s’affuble d’un couvre-chef pour mieux découvrir la vérité, Socrate aurait-il à redire, lui qui n’hésite pas, dans le Phèdre, (237a,243b) à cacher sa tête et jouer d’un étrange capuchon apocalyptique pour mieux dissiper les ombres?
Une casquette, pour ouvrir et découvrir la question désespérée de l’espérance d’une tête, dirait Blanchot à propos de Lautréamont.
C’est dans une étude, justement, que cette stupéfiante entrée d’une casquette gagne son titre de véhicule du nouveau dans la pensée.
Ce fameux casque de la bêtise, cette fameuse casquette de Charles, à l’entrée de Madame Bovary, qui n’en finit pas de cascader comme la vertu selon Offenbach, sous les rires inextinguibles des élèves dans le charivari où sombre à tue-tête le nom, la tête de Charbovari, sera le masque dont je ferai parade au double sens du mot, exhibition défensive, exposition retranchée, explicitement problématique, si le problème est ce qu’on jette en avant comme ce qui, tout à la fois, ouvre l’écart critique, la crise, et affirme en son cœur la force transgressive, transmutante d’un déplacement, mais sans dépassement prétendument dialectique.
Si la tête est l’enveloppe de la pensée, son récipient et si le contenu invisible déborde toujours son contenant, ne faut-il pas commencer par “se payer sa tête”dans le dérisoire d’un
couvre-chef, si l’on s’entête à penser par-delà tous les effets de tête?
Et précisément, l’ornement imposant et lourd destiné à chuter de façon catastrophique,
ne serait-il pas comme le visage bête de la Science trop sûre d’elle-même dont l’art sait, très paradoxalement montrer la présomption dérisoire? La trop grave profondeur ne se
renverse-t-elle pas en dérisoire apparence?
L’entrée à l’étude artiste, en littérature, cette prétendue dissipation poétique depuis Platon, pourrait bien être alors, pour le philosophe, la bonne manière de perdre la tête pour renouveler sa matière, son contenu, comprendre que la force critique de transformation suppose transgression de l’opposition exclusive de la forme et du contenu, des façons de dire et de ce que l’on veut dire, de la langue et de la chose même. La métaphore emporte l’euphorie cérébrale.
Perdre la tête ne serait-ce pas inquiéter le partage asymétrique de la vérité et de l’illusion et se demander si celui qui prend les mots pour les choses en le déniant au nom de la vérité à tout prix aurait pas à apprendre/désapprendre de celui qui, apparemment, s’abandonne au jeu de la fiction?
Jouer c’est aussi savoir déjouer l’excès jamais avoué du Sérieux.
1- Platon tête première: une tête solaire
Tout commence, avec Platon, par la tête. La pensée naît par la tête. La maïeutique est cet art incroyable de faire surgir les idées et la sagesse de la tête. C’est incroyable, mais non pour les athéniens qui savent qu’Athéna la pure fille est née de son père, par Parthénogenèse paternelle, si Zeus a avalé Métis, sa femme, de peur d’avoir un enfant indigne qui le détrônât. Ainsi surgit toute armée, du crâne de son père, une grande fille toute simple, la simplicité même-, à la sagesse toute de tête, loin des complications intestinales du ventre féminin.
En un mot, l’unité, l’identité en elle-même, la fille de tête, la tête même.
Pallas Athéna la guerrière garde la vérité : son égide, son bouclier tête de Méduse, de Gorgone qui pétrifie, n’est-elle pas comme sa propre face monumentale et défensive dans laquelle on ne peut que s’abîmer comme une pierre dans un temple, un citoyen pris, compris dans une acropole?
Le Timée pose et impose la tête en haut du corps comme une sphère (44d) analogue du globe divin du monde, l’image corporelle d’une forme centripète parfaite, fermée sur elle-même et son identité concentrée, concentrique.
La tête porte les yeux qui regardent vers l’avant et portent la lumière, s’ouvrent aux idées par la face idéelle même qu’est le visage. L’isthme du cou a pour fin de séparer et préserver cette perfection suffisante close des tentations du corps (69e). La tête est au sommet (acrô) (90 a) du corps comme l’acropole en haut de la cité.
La tête est une maison (oikésis) (44e) sacrée, une citadelle (akropolis, 70b). Le cœur est poste des sentinelles (doruphoriké oikésis).
Hegel, philosophe de l’Idée, fasciné par le profil grec, reprendra fidèlement à Platon l’image architecturale pour définir la “figure humaine”(Esthétique vol.I1 La sculpture).
La tête est principe architectural de la hiérarchie du corps, analogique de l’architecture de la cité géographique et politique : Bataille saura le reconnaître. Le corps est édifié, élevé comme un ordre monumental. Ainsi s’installe pour longtemps la pensée modèle, l’idée visage de la vérité qui donne à contempler le principe organique de la finalité vitale, politique, psychique, théologique, le système de la subordination économique qui assujettit le multiple à l’un, l’autre au même, le bas à la hauteur, le corps à l’âme, les sens à l’intelligible.
La station debout dresse l’homme vers le ciel :l’homme n’est-il pas une plante céleste, dont les cheveux seraient alors les racines (90a)?
La République n’en finit pas d’organiser et d’approfondir, en l’élevant, l’analogie du corps et
de la cité. Les philosophes-rois sages sont la tête d’un cœur de guerriers qui commandent
eux-mêmes à un ventre d’ouvriers.
S’il y a plusieurs philosophes, ils sont ministres de l’un comme principe des principes, idée des idées, tête des têtes. Ils ne veulent voir qu’une tête, très militaires gardiens de la vérité, archontes qui commandent à ceux qui sont commandés (archein/archeisthai). Dès l’entrée du chemin qui conduit à la Ville, Polémarque, celui qui commande au combat, nécessairement fils
de Céphale, la tête, donne ses ordres à son esclave pour marquer et orienter, ordonner le parcours, ouvrir la voie royale de la pensée.
La tête est pour ainsi dire comme le premier corps de l’âme, principe de l’auto- mouvement retourne sur soi.
L’ animal (katoblepas) en général, a la tête et les yeux tournés vers la terre, il ne peut obéir à cette pédagogie architectonique édifiante : son corps résiste à l’organisation orientée: il restera dans la confusion de la multitude du troupeau soumis au pasteur. Il y a pourtant des animaux plus harmonieusement domestiques, comme le cheval, des animaux nobles à la tête obéissante, au corps bien dressé et redressé, avec commencement et fin, tête et queue, capables de porter le cavalier, le chevalier, comme un corps sa tête.
Le bon discours est à l’image de cette monture organisée et architecturale : équestre.
Le laid Socrate, à la grosse tête camuse, comme son nom le suggère à demi, n’est jamais sûr
de ne pas se confondre avec son double, son ombre inquiétante, qui ne cesse de le hanter : une grosse tête sauvagement entêtée et résistante, comme la parodie d’une “vraie”: une fausse tête défaillante, pleine de fausseté, au mauvais port et porteuse d’ombres mystifiantes. C’est à la campagne, un jour exceptionnel d’égarement hors de la cité domestique que l’homme du connais-toi toi-même va rencontrer le plus menaçant de ses compagnons: quatre fois au moins, la bête des bêtes à quatre pattes, l’âne, dans le Phèdre aura montré sa queue et le bout de ses oreilles, la monstruosité indomptable de son corps rebelle qui part en tous sens.
Dans la confusion sauvage des arbres apparaît quatre fois au moins l’âne (230a, 246a.254.260c, 264 cd).
Qu’est-il, cet entêté, sinon l’antitête?
- C’est Typhon ou Seth le fumeux monstre égyptien qui rassemble et disperse en nuage et brouillard toutes les bêtes.
- C’est le mauvais cheval noir, inharmonieux de l’attelage, à trop de tête et de queue qui précipite vers les Enfers.
- Les grandes oreilles se trahissent, ombre double qui trahit le vendeur de mensonges et de fantasmagorie (skia onoû).
- Enfin voici Midas et l’inscription de sa tombe en palindrome, insensée, lisible en tous sens.
Socrate couvert de son capuchon (237a,243b) ne cherchait-il pas à conjurer le risque du vertige des ombres et des doubles grotesques qui se moquent du chef philosophique?
N’oublions pas qu’il fait de la sortie de la caverne, où les ombres jouent à nous perdre, le chemin ascensionnel vers la face solaire, l’icône du Père comme Bien économique de l’idée? Voir le visage de la Lumière ne serait-ce pas quitter le creux d’un lourd crâne mort et noir comme celui d’une bête ignorante?
Tout se passe comme si le philosophe était menacé du mal de tête comme on parle du mal de mer. Et pourtant, ce n’est jamais vraiment cet animal de Socrate, ce maître inavoué des animaux (Zoocrate...) qui a la tête lourde. Il se contente d’opérer et d’accoucher de sa mauvaise tête-ventre, pleine de vent sophistique, quelqu’un d’aussi laid que lui, Théétète, qui ne peut que mourir de la dysenterie sur le champ de bataille comme l’entrée du dialogue l’aura annoncé.
Ce n’est pas Socrate mais un jeune homme charmant, beau comme une statue, qui un jour va se plaindre devant le maître d’avoir au réveil la tête lourde (barunesthai ti ten kephalen)
(155 b).
Charmide recevra de l’homme du Connais-toi le pharmakon, le poison-remède qui guérit le mal de tête : Socrate n’est pas à une ironie paradoxale près en révélant, très hippocratiquement, que la guérison de la tête suppose la santé de tout le corps. Et d’où vient la santé du corps, sinon de la sagesse et donc de l’âme? murmure finement l’homme laid. La tête est l’âme de l’âme et le corps du corps, le corps de l’âme est le corps animé.
Sur la fresque du Musée d’Athènes qui attira l’attention de Heidegger en 1967, Athéna songe, pensive, comme défaillante, fatiguée de sa garde vigilante à la limite du monde et du vrai. Sous le poids de son casque, sa tête penche, comme perdue, près de sa main qui veut la soutenir tout en retenant son arme, sa lance renversée, la pointe, tête en bas, à terre, désignant, comme la chute orientée d’une flèche, la borne, la limite des formes, du sens (Figure 4).
La déesse cérébrale et trop sage, n’est-elle pas en déséquilibre au bord de l’infini, du non sens, du dehors, n’est-elle pas atteinte d’un doute inquiétant qui lui fait perdre contenance? Mais cette instabilité précipitée, cet écart ne serait-il comme l’esquisse d’un départ. d’un déménagement de la pensée par-delà sa fin, sa détermination installée, son idée fixe?
2. Kant : crise de tète lunaire.
Comme on le sait, un Kant lunaire ou lunatique, c’est une méchante idée de Nietzsche dans
Le Crépuscule des idoles. Cela semble une dénonciation: c’est peut-être la très juste observation astronomique d’un décours, d’une déclinaison, désastreuse de La vérité-Histoire d’une erreur-Comment le monde vrai devint une fable - qui montre et fait voir son vrai devenir.
Socrate, dans le Théétète, n’a peut-être pas compris que la servante, dans son rire naïf, trahissait une complicité « astronomique » avec Thalès, qui dans le puits trouve la vérité, le principe du télescope, et ridiculise ainsi les aspirations célestes métaphysiques.
La révolution kantienne est autant galiléenne que copernicienne: ne serait-ce pas comme Galilée l’imperfection du visage vérolé et changeant de la lune errante dans le ciel
étoilé - lumière d’ailleurs, comme dit Parménide - qui l’attire, lui qui incline sa tête critique mélancolique vers tout ce qui éclaire au cœur même de la nuit ?
Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée sinon explorer une route non déjà divinement orientée, comme tâtonner dans une chambre sans lumière? Avec Kant, le philosophe s’annonce le Petit Poucet rêveur de Rimbaud, dont l’Auberge est à la Grande Ourse, un petit guide insurgé de péninsules et de constellations démarrées.
Faire la lumière avec des intuitions aveugles, c’est reprendre la méthode de Diderot pour faire surgir les lumières des réflexions sur les aveugles, aller au fond de la nuit de l’obscurantisme visionnaire inséparable de l’éblouissement solaire royal et divin (Blendwerk) de la métaphysique, pour découvrir le clignotement des lumières irréductiblement multiples des phénomènes, des objets, mais aussi des libertés, dont le ciel étoilé est comme l’allégorie sublime.
C’est bien contre l’idéalisme contemplatif mystique renouvelé de Platon, contre le délire des têtes qui s’exaltent que Kant va diriger sa critique du Ton grand seigneur en philosophie.
Tout en semblant ménager encore l’auteur de la République, Kant nous invite à opérer une déclinaison diffractante de la lumière installée et fixe du vrai dans le mouvement d’une raison désormais en marche, au pas de la critique et de la pratique.
C’est ainsi d’abord à une Isis voilée qu’est comparée une vérité spéculative pétrifiée. Cette tête noire est le négatif révélateur d’une apparence, d’une chimère, d’une Rêverie visionnaire. Ce qui passe pour l’éclat de la Lumière absolue dissout toute forme objective comme toute singularité raisonnable dans la confusion, d’un monde de spectres dans lequel se perd et s’abîme une tête malade. Le focus imaginarius où semblent se rejoindre toutes les perspectives du monde visible n’est-il pas transfiguré en faciès imaginarius de l’absolu, en hallucination iconique qui prétend réaliser l’idéal alors qu’il n’est que la projection présomptueuse du Moi?
Toute la critique Kantienne guidée par le souci de révéler l’intérêt pratique de la raison comme sa destination foncière, se fait ainsi critique de tout ce qui s’identifie comme égoïsme non seulement logique comme dit l’Anthropologie, mais bien ontologique. Le moi, le monde et Dieu: voilà la trinité de cette clôture égocentrique qui se retrouve dans la substance de l’âme, l’unité cosmique, l’idée divine principe du syllogisme disjonctif. Comment ne pas comprendre que les paralogismes, les antinomies et la critique de l’idéal théologique suivent le même mouvement de dénonciation de l’identité fondée sur la disjonction exclusive de l’autosuffisance spéculative, de cette présomption à vouloir se situer au centre fondateur, créateur, illuminant de la vérité?
Le geste libérateur de l’astronomie transcendantale critique ne laisse-t-il pas deviner sa force de déclinaison et de déplacement dans le dédoublement qu’il fait subir sans hésitation à cette figure d’Isis, que le XVIII° ésotérique semble imposer en passant?
En effet cette face lunaire de la vérité voilée va revenir et faire retour dans la Critique du Jugement dans une simple note (§49), pour se montrer cette fois dans une toute autre phase: le voilement n’est plus l’occultation qui préserve la révélation d’une vérité absolue, l’aveuglement d’un éblouissement, mais le jeu de voile désigne une vérité sublime. Que veut
dire sublime? Non une élévation verticale vers l’au-delà mais ce mouvement oblique, cette pente de la lumière (sub-limis), ou du regard qui aussi bien touche la limite (limes), s’avance au plus près sans pourtant la dépasser, la suit selon sa ligne de fuite, de transgression? Le sublime auquel ouvre le génie expose les idées esthétiques comme éclatement diffracté, décidément critique, de la lumière, de la “face”de l’idée métaphysique. Sublime est le ciel étoilé s’il expose le diagramme allégorique d’une dispersion affirmative du firmament des libertés. Le sublime est “sous” le crâne étoilé de l’être fini, comme Hugo et Bataille le comprendront. Qu’est-ce que l’univers de l’universalité sinon le versement en diversion, divergence éclatée, en lumières multiples, de la source lumineuse qui ne prend sens qu’à se perdre et se donner et s’abandonner
aux bonnes volontés toujours plurielles, à la multitude des êtres raisonnables que la Volonté métaphysique ne peut spéculativement, économiquement, syllogistiquement, ontologiquement prétendre unifier qu’au prix de leur liberté.
Les trois énoncés qui définissent le sens commun, le Miteillung de l’ Urteilung, le partage du jugement (§40) ne sont-ils pas en résonance avec la trinité profane liberté, égalité,...?
À l’instant crépusculaire de définir le génie (§49) comme puissance du sublime, disposition à donner à penser, c’est-à-dire à distribuer étoiler, faire éclater un lumineux désastre - comme dit Hugo du Progrès-, un champ ouvert d’intensités différentes, divergentes de lumières qui s’éclairent de la rivalité, de l’émulation réfléchie de leurs scintillements, Kant cède à l’étrange faiblesse apparemment courtisane de citer les vers du roi de Prusse Frédéric le Grand: or ces vers disent le déclin et la dépense sans retour d’un soleil qui se couche, au bout de sa carrière et répand ses derniers soupirs annonçant la nouvelle aurore du crépuscule infini et sans retour.
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige (Baudelaire)
Le soleil cou coupé. (Apollinaire)
Le philosophe kantien cède à l’inclination mélancolique sans pourtant s’abîmer dans le délire de l’hypocondrie. Sa force vitale est de trouver, sans perversité, le plaisir dans ce qui résiste au déplaisir, ou plutôt dans un plaisir qui se méfie de la complaisance de l’attente de la satisfaction, de la plénitude de la suffisance: mensonge même de la tautologie ontothéologique qui veut tout réunir, unifier et identifier, voir partout une seule fin, comme une seule cause ou origine analytique, une seule tête. Le règne des fins sonne la fin de tout règne, de toute souveraineté idéelle, identifiée, «idiote », de la pensée et de la vie, de l’avoir comme du
pouvoir. Voici monter à l’horizon le ciel terrestre de la multitude affirmative qui est ouverture transversale des êtres raisonnables lesuns aux autres, dans le jeu partagé de leurs volontés et de leurs puissances souveraines, libérées de toute raison impériale.
La loi morale est la nouvelle Isis dit Un ton grand seigneur: elle énonce la forme ouverte de cette diffraction de l’ordre du cosmos en univers, de cette déchéance de toute idée, de toute face iconique du monde, de toute tête retenue dans le secret de son intériorité centripète pour la surface entêtée, polycéphale et décapitée tout à la fois, crépusculaire et étoilée, d’un ciel, non de l’inconnu absolu mais des constellations et des configurations infinies et en abyme, des inconnus: du problématique même comme distribution différentielle de singularités, comme dit Deleuze.
Si la raison est originellement et finalement pratique, cela veut dire qu’elle s’ouvre transversalement au milieu même des rapports des hommes, de leur lieu de rencontre, qu’elle est catégorique: impératif catégorique ce n’est pas l’impérieux commandement d’une tête divine, mais l’injonction de descendre sur l’agora (katagoreuein) pour partager ses idées et ses opinions, pour mêler les têtes, les libertés selon le jeu de l’échange polémique qui ouvre la multiplicité excentrée qu’aucune totalisation ne saurait unifier;qui vit de différences affirmées.
Faire un pas dans le champ d’une philosophie pratique, selon les Fondements, c’est refuser la dialectique raisonneuse et spéculative: la bonne volonté n’est pas un savoir, mais cet élan et ce pas critique du simple progrès vers l’autre. Si le penseur est assis et prostré, l‘homme qui marche de Rodin est acéphale (Figure 2). C’est cela ouvrir la marche.
Le croissant, l’angle lunaire d’Isis, la déesse des métamorphoses, des étoiles et fragments vifs de la vie, du diasparagmos d’Osiris, se lève et décline, pour annoncer le retour de Dionysos dispersé et errant dont Nietzsche verra arriver, par la poste, une tête (Ecce Homo, Pourquoi je suis si sage).
3. Crânes à tue-tête, à cœur perdu.
Déconcertant humour de la clarté lunaire: elle ne semble éclairer de sa lumière indirecte et oblique que des crânes de spectres engagés dans une interminable agonie.
Et pourtant, cette déchéance du jour est la chance d’aurores qui n’ont jamais lui si elles inquiètent l’assurance traditionnelle du Jour. N’est-ce pas ce que Nietzsche voulait dire en parlant du commencement qu’est la tragédie ? Incipit tragoedia (GS, § 342). Zarathoustra, le prêtre du soleil, sait qu il doit décliner avec le désastre de son astre et descendre vers l’enfer des villes pour découvrir et voir monter les signes de l’avenir.
Si Apollon doit composer avec Dionysos, cela veut dire que la Lumière doit jouer avec ce qu’elle éclaire, qu’ elle s’y perd pour trouver son sens.
La clarté qui baigne le déclin de Zarathoustra est décidément lunaire. La lune, comme déjà Epicure et Lucrèce le savaient, est l’astre des métamorphoses et de la vraie transformation.
Il y a lune et lune, vieille lune et nouvelle lune. Nietzsche n’aura cessé de le découvrir. Sans doute les “poètes” et les métaphysiciens sont-ils comme des astres morts lointains, mais le grand Silence de la transmutation est aussi sous la protection de la Lune.
Il faut que la lumière et l’énergie de l’astre du jour éclatent, décline et se dépense, s’abandonne dans ce qu’il éclaire pour accomplir sa destination et s’achever, nous indiquant ainsi le chemin du passage par-delà qui conduit au grand Midi.
Le grand Midi n’est surtout pas cette grande pensée, éblouissante et paralysante face de Méduse, danger permanent que Zarathoustra veut éviter à tout prix.
La pyramide de Surlej peut très bien trahir le message annoncé du changement des choses, du devenir comme avenir.
Deviens qui tu es: formule piège ; Pindare n’a-t-il pas voulu dire : transmute en devenir ce que tu crois être, fais devenir ton être?
Comment suggérer que la vérité, comme dit la préface du Gai savoir n’est rien sans ses voiles, mais qu’elle ne cache pourtant rien sous ses voiles? qu’elle est superficielle, par profondeur, comme les Grecs, que sa profondeur est dans les plis de sa surface?
Voici revenir le voile de Maïa pour une nouvelle maïeutique très peu socratique.
Mais, subtilement. cette façon de préférer les Grecs aux jeunes Égyptiens et à leur impatience de soulever le voile pour connaître la vérité à tout prix, ne retrouve-t-elle pas, malgré tout, l’Egypte vivante de la déesse voilée, qu’il faut peut-être alors nommer diony...isiaque?
Le grand Midi, très paradoxalement, est nimbé de crépuscule shakespearien: la grosse lune ronde éclaire de son silence étrange, de sa face humoristique, la venue du signe de l’avenir qui termine le Zarathoustra.
Comment se fait-il que le crâne d’un Yorick Colomb, qu’une tête de mort devienne, dans les poèmes de Nietzsche, comme la nef exploratoire du pays des enfants, loin de tout retour au pays du Père, de ces rivages bariolés en arc-en-ciel qui font éclater une vérité multiple, une lumière diffractée selon toutes les couleurs vives et divergentes, joyeusement en lutte? Pour éclairer le visage éclaté, éclatant, scintillant de l’inconnu qu’annonce Dionysos venu du cœur
de la nuit pour dire les nouveaux jours d’un univers plus profond que le Jour ne l’imagine?
Il faudrait peut-être revenir à la chambre noire de Newton, et à la découverte du spectre lumineux pour comprendre que la grotte des ombres platoniciennes est devenue lentement, au cours de siècles, la salle obscure où la vérité cinématographique des couleurs de la vie se révélait.
Hamlet, dans le crâne de Yorick le saltimbanque, le fou du roi, déchiffre le lieu mystérieusement caché d’une vérité ouverte, publique, partagée, de la vie vive des vivants, de ce partage multiple impossible des solitudes mortelles, possible dans son impossibilité même, sublime, comme les lumières, les têtes, les visages perdus au cœur de la nuit. Solitaire multitude, multiple solitude.
Le tragique n’ouvre-t-il pas la scène de cette rencontre des spectres, des formes qui expose la destination éclatée des hommes? La représentation théâtrale offre et donne aux yeux de la multitude, le spectacle du jeu des rôles: sous le crâne du petit théâtre de Yorick, tous les acteurs impossibles du Songe se donnent rendez-vous.
Le Neveu de Rameau ouvre de son rameau d’or neuf la bouche d’enfer d’une tête tout à fait perdue parce que désormais ventriloque, vengeant Euryclée, ventriloque du Sophiste (252 c), le complice des sophistes polycéphales (240 c) faisant remonter du ventre la vérité vivante que la pensée de l’articulation dialectique a elle-même refoulée et étouffée, cette vérité du labyrinthe sans centre, du jeu des rôles et des voix qui rumine et digère, agite le mélange vivant qu’est le vrai, ce kukéon dont parlait Héraclite. C’est le combat, le polémos inépuisable de la diversité colorée des êtres et des valeurs qui joue au fond de cette caverne, de cette grotte sublime parce que grotesque, où l’on rit au milieu des pleurs, grotte féconde, ventre d’une maïeutique
<
Pour aller plus loin
Date de dernière mise à jour : 31/10/2018