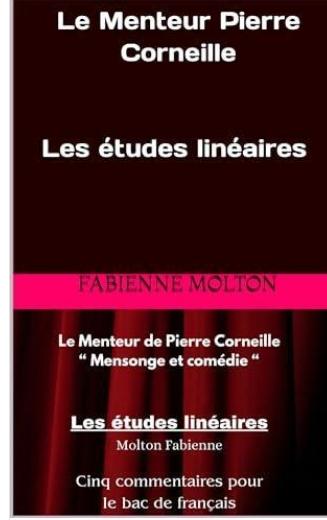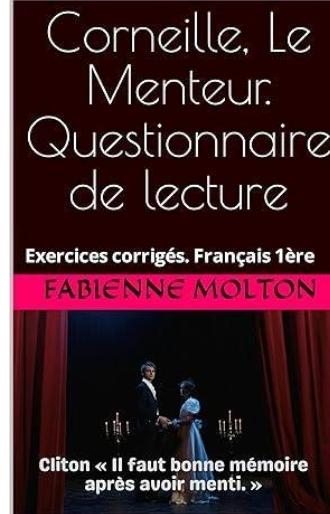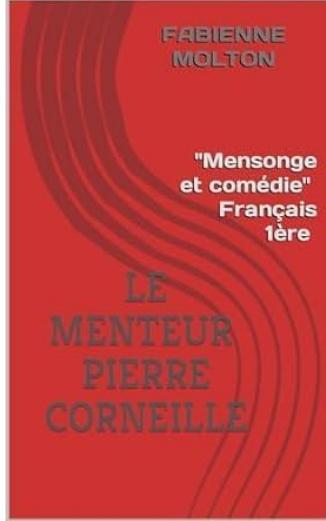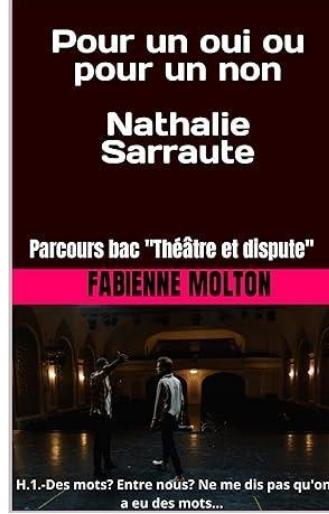Inauguration de la statue d'E. Renan par Anatole France
Discours prononcé à l'inauguration de la statue d'Ernest Renan à Tréguier le 13 septembre 1903
par Anatole France

Pallas Athènè & Renan
Mesdames et Messieurs,
Je sens vivement l'honneur qui m'est échu de porter à la mémoire d'Ernest Renan l'hommage des Bleus de Bretagne et de parler, dans ces fêtes de l'intelligence, après l'homme illustre que vous venez d'applaudir. Berthelot, Renan ! J'unis vos deux noms, pour les honorer l'un par l'autre. Hommes admirables qui, situés sur les deux extrémités des sciences, en avez reculé les frontières. Tandis que Renan, avec une perspicacité sans égale et un rare courage intellectuel, appliquait au langage et aux religions la critique historique, vous, Berthelot, par des expériences innombrables, toujours délicates et souvent périlleuses, vous établissiez l'unité des lois qui régis sent la matière, et vous rameniez les énergies chimiques aux conditions de la mécanique rationnelle. Ainsi tous deux, portant la lumière dans des régions inconnues, vous avez gagné à la raison humaine, sur les larves et les fantômes, un immense territoire.
Cette réflexion, Messieurs, m'a mis au cœur de mon sujet. Renan avait l'esprit fait pour sentir très vite la difficulté de croire. Tout jeune, au séminaire, il esquissa dans son esprit une philosophie des sciences. Il n'avait pas entendu parler de Lamarck, ni de Geoffroy Saint-Hilaire. Darwin n'avait pas encore publié son livre sur l'Origine des espèces. Ecartant, comme enfantine et fabuleuse, l'idée de la création telle qu'elle est exposée dans les vieilles cosmogonies, sans initiateur et sans guide, il conçut une théorie de transformisme universel, une doctrine de la perpétuelle évolution des êtres et des métamorphoses de la nature. Ses croyances fondamentales étaient dès lors établies. En réalité, Renan, dans le cours de sa vie, changea peu. Ceux qui le croyaient flottant et mobile n'avaient pas pris la peine d'observer son monde de pensées. Il ressemblait à sa terre natale, les nuées y couraient dans un ciel agité, mais le sol en était de granit, et des chênes y plongeaient leurs racines. A vingt-six ans, après cette révolution de Février, source pour lui de grandes espérances, de grandes illusions, il exposa toute sa philosophie dans ce livre de L'Avenir de la science, que plus tard il appelait son vieux Pourâna, entendant par là que c'était le recueil de ses jeunes et chères croyances, les premières incarnations de ses dieux bons. A cela près que le livre est un peu plus optimiste que de raison et n'a pas cette douceur de la maturité, on y trouve Renan tout entier, Renan dévoué à la science, attendant le règne de la science et le salut du monde par la science.
Ses premières contributions à la linguistique et à la critique furent un Essai sur l'origine du langage, une étude sur Averroès et la philosophie arabe au Moyen Âge, et l'Histoire générale des langues sémitiques, dont l'esquisse date de 1847. Messieurs, je n'étalerai pas devant vous les titres des nombreux ouvrages de Renan comme les enseignes et les tablettes d'un cortège triomphal. Si je rappelle ses œuvres de jeunesse, c'est pour montrer qu'à vingt-cinq ans, il est en pleine possession de sa méthode et de sa philosophie. L'histoire est pour lui la science unique des choses mou vantes ; et toutes les choses, à ses yeux, se meuvent et se transforment. « Les langues, dit-il, étant le produit immédiat de la conscience humaine et se modifiant sans cesse avec elle, la vraie théorie des langues n'est, en un sens, que leur histoire », et il dit ailleurs : « La science des littératures et des philosophies, c'est l'histoire des littératures et des philosophies ; la science de l'esprit humain, c'est l'histoire de l'esprit humain. » Dès ses débuts, il est détaché de tout dogmatisme scientifique.
Vous savez, Messieurs, comment ses études de linguistique et d'histoire l'amenèrent à rechercher les origines du christianisme. Il entreprit cette grande tâche avec la sérénité du savant. Il se disait : « Les religions sont des faits, elles doivent être discutées comme des faits et soumises aux lois de la critique historique. » Toutes les qualités nécessaires pour écrire l'histoire religieuse, il les réunissait : une science vaste et profonde, une philosophie bienveillante, le culte de la vérité, cette connaissance des hommes que le savoir ne donne guère et qui avait chez lui la sûreté d'un instinct, le respect des illusions consolantes, une disposition naturelle à comprendre, à aimer les erreurs et les faiblesses des simples.
De plus, il avait gardé de sa première éducation une très haute idée de la valeur morale du christianisme. La disposition favorable de son esprit paraît dès l'examen des sources. Avec quelles précautions il manie ces documents fragiles et comme on voit qu'il veut en sauver pour l'histoire autant et plus même qu'il n'est possible !
Dans ces textes où Strauss ne voyait que des mythes, Renan, avec autant de bon vouloir que de sincérité, s'efforça de déchiffrer une histoire vraie. Il fit mieu x: il en tira des récits animés et des tableaux d'une fraîcheur délicieuse. Il traça du Nazaréen une image charmante et fit flotter autour d'elle le parfum qui lui restait d'une croyance desséchée. Tout le ravissait dans l'idylle galiléenne, même l'esprit communiste, qu'ailleurs il goûtait peu. Il sut peindre avec suavité les saintes femmes, les bateliers, les publicains, les pauvres gens qui suivaient le Maître. Il eut des trésors de tendresse pour les premiers hommes apostoliques.
La critique voltairienne faisait une grande part à la fraude dans la fondation des religions. Les philosophes du XVIIIe siècle, trop disposés à croire que l'homme est partout et toujours le même, se figuraient volontiers les apôtres comme des capucins fripons. La critique renanienne, habile à saisir les états obscurs de la conscience, la mène volontiers la fraude aux illusions d'un cerveau malade et pieux Renan qui avait voyagé en Syrie, concevait que ces juifs enthousiastes et tendres eussent vécu dans un mirage perpétuel. Sans doute, la thaumaturgie la glossolalie, tout le merveilleux de la primitive Eglise, qui paraissait si ridicule à un lettré comme Lucien ne lui plaisait guère. Il laisse percer le malaise qu'il en éprouve. Il ne s'arrête à ces pratiques affligeantes qu'autant que sa probité d'historien l'y oblige ; et, s'il en tient quelque compte dans ses jugements sur les mœurs d'une société, il n'en fait, ce semble, un grief à nul homme isolément.
Messieurs, il y a peu de temps, j'ai eu le rare plaisir de causer avec un prince oriental d'une belle intelligence, qui a vécu sa jeunesse dans une contrée où la puissance créatrice de l'esprit religieux n'est pas épuisée, et qui produit encore des prophètes, des apôtres et des martyrs.
Il me demandait avec une surprise à peine feinte et un orgueil asiatique, comment il se faisait que l'Occident n'eût point de prophètes, lorsque d'Orient il s'en levait sans cesse des milliers.
« Aujourd'hui comme autrefois, me disait-il, par tout l on trouve des prophètes, au bazar, dans la boutique du barbier, au coin de la rue ou hurlent les chiens errants. Et les Européens n'en découvrent pas un seul, alors qu'ils en auraient le plus besoin. Voyez les Français, par exemple. Quel avantage il y aurait pour eux à ce que M. Combes rut prophète. »
Nous parlâmes des dieux morts et des dieux vivants, J'écoutai avec une attention singulière cet Oriental qui sait comment se font les religions, qui en a vu faire, qui peut-être en a fait un Il ne me confia pas sans doute toute sa pensée, mais j'appris de lui qu'il faut trois choses pour faire une religion. D'abord une idée générale d'une extrême simplicité, une idée sociale. En second lieu, une liturgie ancienne, depuis longtemps en usage, dans laquelle on introduit cette idée. Car il est à noter qu'un culte naissant emprunte toujours son mobilier sacré au culte régnant et que les nouvelles religions ne sont guère que des hérésies. Troisièmement (et j'obtins cet aveu sans trop de difficultés), il y faut un tour de main, il y faut cet art des prestiges qu'on appelle dans notre vieille Europe la physique amusante. Et je ne sais, après avoir entendu ce prince intelligent et religieux, si parfois la nouvelle école n'a pas noyé trop complaisamment le miracle dans le demi- jour de la pathologie nerveuse, s'il ne faut pas admettre de temps en temps l'hypothèse de la fraude consciente, s'il n'y aurait pas lieu, enfin, sur ce point, comme sur plusieurs autres, de concilier Voltaire avec Renan.
La Vie de Jésus parut le 24 juin 1863. Elle déchaîna sur la tête de son auteur une effroyable tempête d'invectives et d'injures. Toute l'Eglise tonna, Il avait prévu l'orage ; il n'avait cherché ni à l'attirer, ni à le détourner. Il se faisait une obligation de dire tout ce qu'il croyait être la vérité. Sa maxime invariable était qu' » il n'est pas permis au savant de s'occuper des conséquences qui peuvent sortir de ses recherches ».
Fière revendication des droits de la Science, juste sentiment du devoir intellectuel ! Combien nous en avons vu de philosophes et de savants, faute de suivre cette règle, devenir complices de l'erreur et du mensonge, du préjugé barbare, trahir la vérité ! « Je voudrais parler, disait l'un, mais je ne puis, ce serait ébranler les fondements des sociétés humaines et creuser un abîme. » Et l'autre déclarait avec l'énergie de la faiblesse que, connût-il le secret de l'univers il n'en révélerait rien, de peur d'inquiéter dans sa conscience un berger sur la montagne, un matelot sur la mer. Nous avons vu mieux encore, 1 avons vu des hommes graves, affranchis de toutes croyances, des athées, professer un sombre catholicisme pour le salut de nos institutions.
Renan, sans entendre les menaces des superbes et les plaintes des humbles, accomplit sa tâche. Dans un des plus beaux et des plus grands livres qu'on ait jamais écrits, monument de la probité la plus sévère et du plus vaste génie, il mit aux jours de l'histoire les origines obscures du christianisme, Il fit voir la première Eglise de Jésus persécutée par l'orthodoxie de Jérusalem, les missions de saint Paul, qui n'eurent d'effet que sur quelques petites associations juives établies dans le monde hellénique ; l'entrée inaperçue du christianisme à Rome où il eut bientôt la fortune in comparable de souffrir par Néron de trouver en Néron l'ennemi de Jésus, l'Antéchrist de paraître d'un coup et pour les siècles le bien opposé au mal ; puis la destruction de Jérusalem qui périt en donnant à l'univers un Dieu qu'elle reniait et qui, par sa mort, délivra l'Eglise d'une mère ennemie. Il montra ensuite la seconde génération chrétienne fixant la légende et substituant à la communauté primitive la hiérarchie sacerdotale. Il conduisit son histoire jusqu'aux temps où l'Eglise eut ses livres sacrés, le germe de ses dogmes les premières formes de sa liturgie, et il la termina à la mort de Marc-Aurèle qui fut la mort du monde antique.
Ce livre nous découvre dans l'humilité même du christianisme la cause de son triomphe. […]
Quand il eut achevé cette grande œuvre, composé ces sept volumes des Origines, Renan, déjà vieux et atteint des troubles qui lui annonçaient sa fin, se donna une autre tâche assez vaste pour remplir une existence entière mais à laquelle il était préparé par les études et les réflexions de toute sa vie. Il entreprit d'écrire l'histoire du peuple d'Israël et de relier ainsi les développements du christianisme à ceux du judaïsme. La destinée historique et religieuse d'Israël, quel sujet pour ce grand observateur des transformations des peuples et des métamorphoses des idées ! […]
Ces pages, où Renan montre les prophètes construisant pièce à pièce le dieu qui va conquérir le monde, sont parmi les plus belles qu'il ait écrites. Il termina le cinquième et dernier volume de l'histoire d'Israël le 24 octobre 1891. Son œuvre s'achevait avec sa vie. Il exprima le contentement de la tâche accomplie dans des termes que je veux rapporter parce qu'on y voit que ni l'âge ni la maladie n'avaient altéré en lui ce sentiment exact du devoir qui était le mobile de toute sa conduite.
« Si je venais à mourir demain, l'ouvrage, avec l'aide d'un bon correcteur, pourrait paraître. L'arche du pont qui me restait à jeter entre le judaïsme et le christianisme est établie. Dans la Vie de Jésus, j 'ai essayé de montrer la majestueuse croissance de l'arbre galiléen depuis le sol de ses racines jus qu'à son sommet où chantent les oiseaux du ciel. Dans le volume que j'ai fini l'été dernier, je pense avoir réussi à faire connaître le sous-sol où poussèrent les racines de Jésus. Ainsi mon principal devoir est accompli. A l'Académie des inscriptions et belles- lettres, le travail sur les rabbins touche aussi à son terme et le Corpus inscriptionum semiticarum est en excellentes mains. Tout cela me cause une grande satisfaction intérieure et voilà ce qui me fait croire qu'après avoir ainsi payé toutes mes dettes, je pourrais bien m'amuser un peu. »
Quel dévouement dans cette grande âme ! Quel bon ordre dans cette admirable vie ! Son histoire d'Israël est ter minée, sa contribution à l'histoire littéraire de la France est fournie, le Corpus est en de bonnes mains, Renan meurt en souriant.
Le Corpus était l'objet de sa plus vive sollicitude. Déjà vieux, il disait à sa fille : « Je voudrais avoir deux tables l'une pour mes travaux historiques, l'autre pour le Corpus. » J'ignore si ce vœu fut comblé. Mais on sait à l'Académie des inscriptions que Renan suivait assidûment les séances consacrées à ce grand recueil épigraphique dont il était l'âme. Notre ami Armand Dayot rapporte que l'auteur des Origines du christianisme et de tant de beaux livres disait parfois : « De tout ce que j'ai fait, c'est le Corpus que j'aime le mieux. »
« Je pourrais bien m'amuser un peu », écrivait-il dans la joie de sa tâche accomplie. Les amusements du beau soir de sa vie, ce furent ces livres profonds et charmants, ces dialogues, ces discours familiers, ces drames philosophiques, dans lesquels il exprimait avec grâce de fortes pensées, confiait à ses amis inconnus les craintes, les espérances, les doutes qui l'agitaient, exposait sa philosophie et confessait sa foi. En 1891, comme en 1848, il croyait fermement que l'avenir appartenait à la science et à la raison.
Sa philosophie morale était celle du parfait savant. Il considérait que le plus noble emploi qu'on pût faire d'une vie humaine était de pénétrer les secrets de l'univers. Comme le mystique aspire à s'abîmer en Dieu, il aspirait à s'abîmer dans la science. L'humanité lui était précieuse parce qu'elle produit la science. Il tenait absolument à la moralité parce que des races honnêtes peuvent seules être des races scientifiques. Sa politique procédait de sa morale. Pour lui, le gouvernement le plus favorable aux intérêts de la science était le meilleur. Mais là commençait la difficulté, et comme il était très honnête, la politique l'embarrassait beaucoup. C'est une science in certaine qui n'a pas fait de progrès depuis Aristote. Renan a expose ses doutes et ses contradictions à ce sujet dans deux drames philosophiques : Caliban et L 'Eau de Jouvence.
Le gouvernement qui lui plait le mieux n'est pas, à vrai dire, une démocratie. C'est un gouvernement aristocratique d'un caractère très particulier, puisque le prince y prend un savant pour Premier ministre et qu'il est lui- même un savant. Ce prince se nomme Prospero, et Renan, après Shakespeare, le tient pour habile et vertueux. Au contraire, Renan, comme Shakespeare, se défie de Caliban. Caliban, fils de Sycorax, a les oreilles pointues et un crâne de gorille. Il est informe et velu. C'est le peuple ignorant. Renan voulait que Caliban attendît, pour s'emparer du gouvernement, que ses oreilles s'accourcissent et que son cerveau s'enrichît de circonvolutions nouvelles. Mais Caliban n'attendit pas. Il renversa Prospero dont il prit la place. Renan s'en consola et il ne souhaita pas que Prospero fût restauré.
« J'aime Prospero, dit-il, mais je n'aime guère les gens qui le rétabli raient sur son trône. Caliban, au fond, nous rend plus de services que ne le ferait Prospero restauré par les jésuites et les zouaves pontificaux. Loin d'être une renaissance, le gouvernement de Prospero, dans les circonstances ac tuelles, serait un écrasement. » Et il conclut : « Gardons Caliban. »
Plutôt que de sacrifier la science à la démocratie, Renan eût sacrifié la démocratie à la science. Mais dès qu'il s'aperçut que la science avait moins à perdre avec Caliban qu'avec Prospero, il préféra Caliban.
Ces drames, dans lesquels il montre en souriant les difficultés de la politique, sont des chefs-d'œuvre de grâce, d'ironie et de finesse.
On ne trouvera jamais d'expressions assez simples pour louer l'art de Renan, qui est la simplicité parfaite. Il se défiait de l'éloquence et avait la rhétorique en aversion. Son discours fluide est moins dans la manière des Latins que dans celle des Grecs, qui est de beaucoup la plus fine et ne se laisse guère imiter. Comme les Grecs, il évita toujours l'emphase et la déclamation. Il a mis de l'art dans tous ses livres, puisque dans tous il a mis de l'ordre, et qu'il a toujours approprie la manière d'écrire au sujet et toujours subordonné le détail à l'ensemble. Mais où son art se montre avec le plus de channe, facile à tous et précieux aux connaisseurs, c'est dans ces Souvenirs d'enfance qui brillent en son œuvre comme la fleur d'or sur les rochers de sa Bretagne. De tous ses livres, c'est le plus aimable parce que c'est celui où il a mis le plus de lui-même. On l'y voit tel qu'il était, très grand et très bon. Il aimait les siens et il était aimé d'eux.
Je célébrerais mal sa mémoire si je n'appelais pas autour de ce monument les âmes qui lui furent les plus proches et les plus douces : Henriette, « si haute et si pure » (j'emprunte au frère les louanges de la sœur), Henriette qui, lorsqu'il avait vingt ans, « lui tendit la main pour franchir un pas difficile » et qui, dans les nuits de Ghasir, renouvelait avec lui, d'une pensée plus forte, les entretiens d'Augustin et de Monique, au rivage d'Ostie ; Cornélie Scheffer, la compagne de sa vie, belle, simple, de l'esprit le plus vif, nourrie de vertus aimables et fortes ; Ary, son fils, qui vécut peu de temps, penché sur la mort dans une langueur qui se répandit en délices et en grâce sur sa peinture et sa poésie. Auprès de ces ombres chères, j'appellerai celle qui reçut de lui le nom de Noémi comme un souvenir touchant et comme un heureux présage, la femme accomplie qui charme et pénètre de respect tous ceux qu'elle reçoit à cette table de fa mille, couronnée d'enfants, où l'image de Renan flotte encore, comme celle du Maître à la table des pèlerins d'Emmaüs.
J'appellerai les professeurs et les élèves de ce Collège de France, qui fut la demeure de son intelligence et la maison de sa pensée. J'appellerai ses amis, ses disciples, et tous ceux qui l'ont connu. Ils témoigneront tous de sa bonté, de sa tendresse, de sa douceur et de son courage.
Renan se fit toujours du devoir une idée précise et rigoureuse. Pour satisfaire à ses obligations de linguiste, d'épigraphiste, d'exégète, d'archéologue, je ne dirai pas qu'il se priva de tout plaisir. Si nous en croyons d'excellents philosophes, c'eût été commettre le plus gros des péchés. Mais il mit tout son plaisir dans l'accomplissement de ses devoirs, et prit aux moindres un intérêt fidèle. Il se garda même des amusements de l'intelligence et des joies de l'art qui ne s'accordaient pas avec la régularité professionnelle.
Que cette entente des obligations, cette ponctualité se soit trouvée dans un si vaste esprit, il ne faut pas s'en étonner. De sa nature, le génie est plus ponctuel, plus exact, que la médiocrité. Et ce n'est pas certes une connaissance étendue de la nature qui peut affaiblir en nous le sentiment du relatif et du nécessaire.
Renan était vertueux de la façon la plus rare : il l'était avec grâce. Il avait des vertus fortes et des vertus char mantes, Il était bienveillant et serviable. Il mettait tout son soin à ne désobliger personne. Il s'efforçait de se faire pardonner sa supériorité à force de simplicité, de déférence pour autrui, et en se donnant, autant que possible, les dehors d'un homme ordinaire. Dans des souffrances longues et parfois cruelles, il gardait sa douceur ; et sa joie restait abondante : il la composait de la joie des autres. Il conservait du bien qu'on lui voulait une mémoire toujours fraîche, et le mal qu'on lui faisait, il l'ignorait toujours. On pourrait lui appliquer ce vers de Sophocle : « Je naquis pour partager l'amour et non la haine. »
Voilà l'homme sur lequel l'Église a, pendant un demi-siècle, versé l'injure et l'outrage. Il les souffrit avec une tranquillité souriante. Il disait, dans l'une de ses préfaces de la Vie de Jésus :
« J'écris pour proposer mes idées à ceux qui cherchent la vérité. Quant aux personnes qui ont besoin, dans l'intérêt de leurs croyances, que je sois un ignorant, un esprit faux ou un homme de mauvaise foi, je n'ai pas la prétention de modifier leur avis. Si cette opinion est nécessaire au repos de quelques personnes pieuses, je me ferais un véritable scrupule de les désabuser. »
Il s'attendait à ce que sa mort fût contée dans des légendes pieuses avec une grande abondance de détails horribles, comme l'Eglise a fait pour les derniers moments d'Arius et de Voltaire. « Mon Dieu que je serai noir », s'écriait-il avec un effroi plein de bonhomie.
Il ne se trompait pas. Vous avez vu ce matin encore les éternels ennemis de la science et de la raison obstinés à le noircir. Ce serait trahir sa mémoire que d'opposer pour la défendre l'in jure à l'injure. Nous n'attaquerons pas l'Eglise. Bien mieux, nous ne voulons pas la juger aussi sévèrement qu'elle se juge elle-même quand elle se proclame immuable. Nous voulons croire qu'elle s'adoucit avec l'âge. Ne l'écoutons pas, elle est plus accommodante qu'elle ne dit, elle est plus humaine qu'elle ne voudrait le faire croire. De ses vieilles habitudes, il lui reste, il est vrai, la manie importune de fulminer sans cesse ; mais songez que c'est un progrès moral et qu'elle faisait bien pis autrefois. On peut, sans trop d'inconvénients, lui laisser la liberté de ses anathèmes et de ses excommunications. Que ses foudres éclatent, mais qu'elles soient spirituelles et
que l'Etat n'en fasse plus les frais !
Messieurs, le sculpteur dont l'œuvre vient d'être dévoilée devant vous n'a pas sans raison représenté Pallas Athènè au côté de Renan. Homère nous l'apprend : Athènè a coutume de descendre du vaste ciel pour s'entretenir avec les hommes qui lui sont chers.
Elle visita plusieurs fois cet Ulysse, qui avait beaucoup enduré et qu'elle aimait parce qu'il était subtil. Mais le héros ne Savait pas tout de suite que ce fut elle et manquait de confiance. Un jour, sur le rivage d'Ithaque, elle le lui reprocha doucement :
— N'as-tu donc point reconnu Pallas Athènè qui t'assiste dans tes travaux et te protège ?
Et le héros fit cette réponse, à la quelle nous trouvons plus de sens que le fils de Laërte n'en a mis :
— Il est difficile à un homme de te reconnaître, même au plus sage.
Comme autrefois sur le rivage de la mer bleue qui vit naître la science et la beauté, maintenant au bord du sombre océan dont la voix berça les rêves d'une race patiente, Pallas Athènè converse avec un ami terrestre.
Elle dit :
— Je suis la Sagesse. Il est difficile aux hommes les meilleurs de me reconnaître dès l'abord, à cause de mes voiles et des nuées qui m'enveloppent, et parce que, semblable au ciel, je suis orageuse et sereine. Mais toi, mon doux Celte, tu m'as toujours cherchée, et chaque fois que tu m'as rencontrée, tu as mis ton esprit et tout ton cœur à me reconnaître. Tout ce que tu as écrit de moi, poète, est véritable. Le génie grec me fit descendre sur la terre, et je la quittai quand il expira. Les barbares, qui envahirent le monde ordonne par les lois, ignoraient la mesure et l'harmonie. La beauté leur faisait peur et leur semblait un mal. En voyant que j'étais belle, ils ne crurent pas que j'étais la Sagesse. ils me chassèrent. Lorsque, dissipant une nuit de dix siècles, se leva l'aurore de la Renaissance, je suis redescendue sur la terre. J'ai visité les humanistes et les philosophes dans leurs cellules, ou ils gardaient précieusement quelques livres au fond d'un coffre, les peintres et les sculpteurs dans leurs ateliers qui n'étaient que de pauvres boutiques d'artisans. Quelques uns se firent brûler vifs plutôt que de me désavouer. D'autres, à l'exemple d'Erasme, échappaient par l'ironie à leurs stupides adversaires. L'un d'eux, qui était moine, riait parfois d'un rire si gros en contant des histoires de géants, que mes oreilles s'en seraient offensées, si je n'avais pas su que parfois la folie est sagesse. Peu à peu, mes fidèles grandirent en force et en nombre. Les Français, les premiers, m'élevèrent des autels. Et tout un siècle de leur histoire m'est dédié.
« Depuis lors, depuis que la pensée, dans ses hautes régions, est libre, je reçois sans cesse l'hommage des savants, des artistes et des philosophes. Mais c'est par toi, peut-être, que me fut voué le culte le plus austère et le plus tendre ; c'est de toi que j'ai reçu les plus pures et les plus ferventes prières. Sur ma sainte Acropole, devant mon Parthénon dévasté, tu m'as saluée dans le plus beau langage qu'on ait parlé en ce monde, depuis les jours où mes abeilles déposaient leur miel sur les lèvres de Sophocle et de Platon.
« Les immortels doivent plus qu'on ne croit à leurs adorateurs. Ils leur doivent la vie. C'est un mystère auquel tu fus initié. Les dieux reçoivent leur aliment des hommes. Ils se nourrissent de la vapeur qui monte du sang des victimes. Tu sais qu'il faut entendre par là que leur substance se compose de toutes les pensées et de tous les sentiments des hommes. Les offrandes des hommes bons nourrissent les dieux bons. Les noirs sacrifices de l'ignorance et de la haine engraissent les dieux féroces. Tu l'as dit : les dieux ne sont pas plus immortels que les hommes. Il y en a qui vivent deux mille ans, courte durée si on la compare à celle de la terre, ou seulement à celle de l'humanité, moment imperceptible de la vie des mondes. En deux mille ans, les soleils ardemment lancés dans l'espace n'ont pas seulement eu l'air de bouger.
« Moi, Pallas Athènè, la déesse aux yeux clairs, je te dois de vivre encore. Mais c'était peu de prolonger ma vie : je plains les dieux qui traînent dans les fades vapeurs d'un reste d'encens leur pâle et morne déclin. Tu m'as rendue plus belle que je n'étais et plus grande. Tu m'as nourrie de ta force et de ta doctrine, et par toi, par ceux qui te ressemblent, mon esprit s'est élargi jus qu'à pouvoir contenir l'univers de Képler et de Newton.
« Je suis née intelligente chez les Grecs heureux. Déjà, dans ma jeunesse, j'avais pénétré bien des lois de la vie, que le Dieu nouveau, qui m'as chassée, ne soupçonna jamais. Mais le monde alors était petit. Le soleil n'était pas plus grand que le Péloponnèse et le ciel ne dépassait pas la pointe de ma lance. Je ne savais pas plus de géométrie qu'Euclide, ni plus de médecine qu'Hippocrate, ni plus d'astronomie qu'Aristarque de Samos. O savants modernes, vous m'avez fait voir au-delà du neigeux Olympe l'in fini des univers, et dans chacune des poussières que foule ma sandale, l'in fini des atomes, astres eux-mêmes soumis aux lois qui régissent les astres.
« Mes regards n'embrassaient que l'Attique et ses montagnes violettes où croît l'olivier. Je ne connaissais de barbares que les Perses et les Scythes. Les navires phéniciens mouillés au Pirée renfermaient pour moi tout le commerce du monde. J'étais législatrice. Du haut de ma roche sacrée, je gouvernais quelques milliers d'hommes libres, habiles à la parole. Sur les tables des lois, on sculptait mon image dans une attitude simple et pensive, d'une telle beauté, que les hommes d'aujourd'hui ne peuvent la voir sans être émus. O Renan ! J'ai mérité les noms que tu m'as donnés de Salutaire, Pacifique, Protectrice du travail, Archégète, Démocratie et Victoire. Mais qu'est-ce que la cité antique auprès des grands peuples modernes ? O sages ! Vous m'avez découvert un horizon plus vaste que l'Empire romain.
Vous m'avez montré, sur un sol trépidant du souffle de la vapeur et des chocs de l'électricité, les nations immenses naguère ennemies, rivales encore, prises toutes à la fois, irritées et en armes dans le réseau d'acier dont la science et l'industrie ont enveloppé le globe cités, peuples, races, un milliard six cents millions d'hommes, travaillant les uns pour les autres et les uns contre les autres, s'ignorant et se haïssant dans les liens qui déjà les unissent.
« Comment se réglera ce conflit de toutes les énergies et de toutes les passions ? Qui vaincra ? La haine ou l'amour, l'ignorance ou la science, la guerre ou la paix, la barbarie ou la civilisation, la force de ceux que tu as appelés « les rois issus d'un sang lourd », ou la puissance de la démocratie ? Ne le demande pas. L'avenir est caché même à ceux qui le font. Ne demande pas quelle sera la cité future. Mais sache que c'est moi qui la construirai. Car seule je suis architecte et géomètre, et ce n'est pas en vain que les savants et les philosophes m'ont rappelée sur la terre.
« Pendant que les Titans ennemis des dieux justes entassent les rochers et que les géants impies forgent leurs armes, je fonde la Ville sainte. A voir mes ouvriers creuser la terre et transporter les matériaux, parfois les sages eux-mêmes ont peine à discerner mes plans ingénieux. Dans les chantiers où l'on taillait, au lendemain de Salamine, les marbres de mes propylées, il était difficile de découvrir, parmi les blocs épars, la pensée harmonieuse de Mnésiclès. C'était là pourtant qu'elle prenait sa forme et naissait à la lumière. L'avenir ne s'y trompera pas : on reconnaîtra mes œuvres à leur stabilité. Les édifices de l'ignorance et de l'erreur s'écroulent misérablement. Tu l'as dit : Rien ne résiste, rien ne dure, que ce qui a été mesuré et calcule par moi, car je suis la prévoyance, l'ordre et la mesure, car je suis la pensée de tous les hommes qui pensent, la science de tous les hommes qui savent, ta science et ta pensée, Ô Renan !
« Reçois de mes mains le rameau d'or que tes soins ont fait croître ; vis dans la gloire, vis en moi, ô le meilleur de mes amis. Tu as obtenu l'immortalité à laquelle tu aspirais. Tout ce que tu as conçu de beau et de bien demeure et rien n'en sera perdu. Lentement, mais toujours, l'humanité réalise les rêves des sages. »
Anatole France

Anatole France, à Stockholm, en 1921 il reçoit le Prix Nobel de littérature il est accompagné de sa dernière épouse et de son petit-fils,
Lucien Psichari, né en 1905, qui est aussi l'arrière petit-fils d'Ernest Renan sa mère est la fille d'Anatole France et sa grand-mère paternelle, la fille d'Ernest Renan
Pour aller plus loin
Date de dernière mise à jour : 07/10/2018







 ème visiteur
ème visiteur