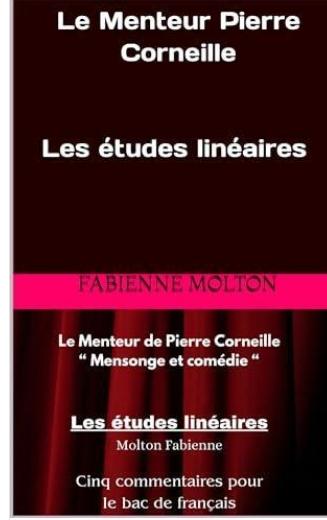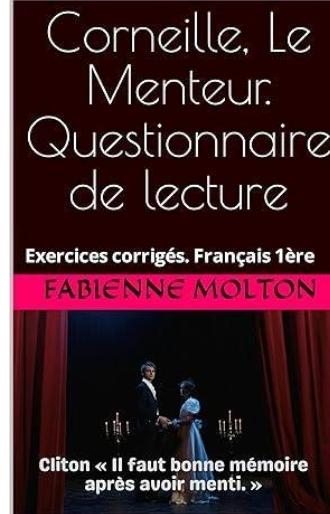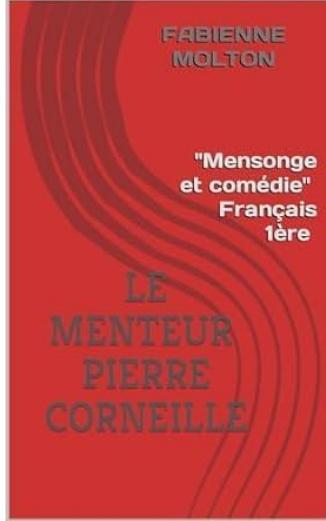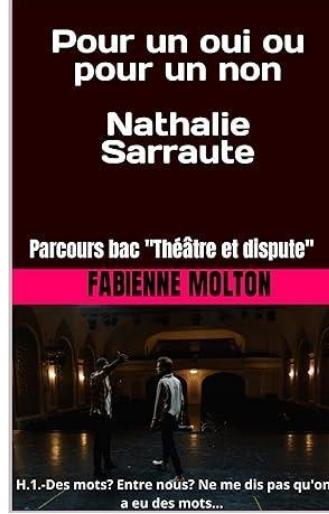Anthologie de textes sur la perception


Anthologie de textes : la perception
Platon (427-348 avant J.C.), allégorie de la caverne
— Maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière; ces hommes sont là de-puis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ail-leurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête; la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux; entre le feu et les prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.
— Je vois cela, dit-il.
— Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, et en toute espèce de matière ; naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent.
— Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers.
— Ils nous ressemblent, répondis-je; et d'abord, penses-tu que dans une telle situation ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face?
— Et comment ? observa-t-il, s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie ?
— Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même ?
— Sans contredit.
— Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient ?
— Il y a nécessité.
— Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croiraient-ils entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux ?
— Non, par Zeus, dit-il.
— Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fa-briqués.
— C'est de toute nécessité.
— Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur ignorance. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière : en faisant tous ces mouvements il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ? Si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est ? Ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant ?
— Beaucoup plus vraies, reconnut-il.
— Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés ? N'en fuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder, et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre ?
— Assurément.
— Et si, repris-je, on l'arrache de sa caverne par force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusque la lumière du soleil, ne souffri-ra-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas de ces violences ? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies ?
— Il ne le pourra pas, répondit-il; du moins dès l'abord.
— Il aura, je pense, besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord ce se-ront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra, af-frontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, que pendant le jour le soleil et sa lumière.
— Sans doute.
— &Aecute; la fin, j'imagine, ce sera le soleil - non ses vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit - mais le soleil lui-même à sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est.
— Nécessairement, dit-il
— Après cela il en viendra à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui fait les saisons et les an-nées, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne .".
— Évidemment, c'est à cette conclusion qu'il arrivera.
— Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la sagesse que l'on y professe, et de ceux qui y furent ses compagnons de captivité ne crois-tu pas qu'il se réjouira du changement et plaindra ces derniers ?
— Si, certes.
— Et s'ils se décernaient alors entre eux honneurs et louanges, s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de l'oil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là était le plus habile à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme fût jaloux de ces distinctions, et qu'il portât envie à ceux qui, parmi les prisonniers, sont honorés et puissants ? Ou bien, comme le héros d'Homère, ne préférera-t-il pas mille fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un pauvre laboureur, et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ?
— Je suis de ton avis, dit-il; il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là.
— Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place : n'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil ?
— Assurément si, dit-il.
— Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition, pour juger ces ombres, avec les prisonniers qui n'ont point quitté leurs chaînes, dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis (or l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long), n'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens, et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut il en est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter ? Et si quel-qu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne le tueront-ils pas ?
— Sans aucun doute, répondit-il.
— Maintenant, mon cher Glaucon, repris-je, il faut appliquer point par point cette image a ce que nous avons dit plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison, et la lumière du feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région su-périeure et à la contemplation de ses objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque aussi bien tu désires la connaître, Dieu sait si elle est vraie. Pour moi, telle est mon opinion : dans le monde intelligible l'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toutes choses; qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain de la lumière ; que, dans le monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence; et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique.
— Je partage ton opinion, dit-il, autant que je le puis.
— Eh bien ! partage-la encore sur ce point, et ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. Cela est bien naturel si notre allégorie est exacte.
— C'est, en effet, bien naturel, dit-il.
— Mais quoi ? penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait ridicule, lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environ-nantes, il est obligé d'entrer en dispute, devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même ?
— Il n'y a là rien d'étonnant.
— En effet, repris-je, un homme sensé se rappellera que les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux causes opposées : par le passage de la lumière à l'obscurité, et par celui de l'obscurité à la lumière; et, ayant réfléchi qu'il en est de même pour l'âme, quand il en verra une troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'en rira pas sottement, mais examinera plutôt si, venant d'une vie plus lumineuse, elle est, faute d'habitude, offusquée par les ténèbres, ou si passant de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat; dans le premier cas il l'estimera heureuse en raison de ce qu'elle éprouve et de la vie qu'elle mène; dans le second, il la plaindra, et s'il voulait rire à ses dépens, ses moqueries seraient moins ridicules que si elles s'adressaient à l'âme qui redescend du séjour de la lumière.
— C'est parler, dit-il, avec beaucoup de sagesse.
— Il nous faut donc, si tout cela est vrai, en conclure ceci : l'éducation n'est point ce que certains proclament qu'elle est : car ils prétendent l'introduire dans l'âme, où elle n'est point, comme on donnerait la vue à des yeux aveugles.
— Ils le prétendent, en effet.
— Or, repris-je, le présent discours montre que chacun possède la faculté d'apprendre et l'organe destiné à cet usage, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner qu'avec le corps tout entier des ténèbres vers la lumière, cet organe doit aussi se détourner avec l'âme tout en-tière de ce qui naît, jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vue de l'être et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être; et cela nous l'appelons le bien, n'est-ce pas ?
— Oui.
— L'éducation est donc l'art qui se propose ce but, la conversion de l'âme, et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l'opérer; elle ne consiste pas à donner la vue à l'organe de l'âme, puisqu'il l'a déjà; mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il fau-drait, elle s'efforce de l'amener dans la bonne direction.
— Il le semble, dit-il.
Platon (427-348 avant J.C.), la République, VII, 515a-519b, tr. Robert Baccou, ? Paris Garnier Flammarion 1966 pages 273 à 277
Aristote (384-322 avant J.C.), tout ce qui apparaît n'est pas vrai
Et pareillement encore, c'est la considération du monde sensible qui a conduit certains1 à croire à la vérité des apparences. Ils pensent, en effet, que la vérité ne doit pas se décider d'après le plus ou moins grand nombre de voix ; or la même chose paraît, à ceux qui en goûtent, douce aux uns et amère aux autres ; il en résulterait que si tout le monde était malade, ou si tout le monde avait perdu l'esprit, à l'exception de deux ou trois personnes seulement qui eussent conservé la santé ou la raison, ce serait ces dernières qui passeraient pour malades ou folles, et non pas les autres ! Ces philosophes ajoutent que beaucoup d'animaux reçoivent, pour les mêmes choses, des impressions contraires aux nôtres, et que, même pour chaque individu, ses propres impressions sensibles ne lui semblent pas toujours les mêmes. Lesquelles d'entre elles sont vraies, lesquelles sont fausses, on ne le voit donc pas bien : telles choses ne sont en rien plus vraies que telles autres, mais les unes et les autres le sont à égal degré. C'est pourquoi Démocrite assure que, de toute façon, il n'y a rien de vrai, ou que la vérité, du moins, ne nous est pas accessible. — Et, en général, c'est parce que ces philosophes identifient la pensée avec la sensation, et celle-ci avec une simple altération physique2, que ce qui apparaît au sens est nécessairement, selon eux, la vérité. C'est, en effet, pour ces raisons, qu'Empédocle et Démocrite, et, pour ainsi dire, tous les autres philosophes, sont tombés dans de pareilles opinions3. Pour Empédocle, changer notre état physique, c'est changer notre pensée :
D'après ce qui se présente aux sens, l'intelligence croît, en effet, chez les hommes,
et, dans un autre passage, il dit que :
Autant les hommes deviennent autres, autant à leurs esprits, toujours,
Des pensées différentes se présentent.
Parménide s'exprime aussi de la même manière :
Car, de même que, en tout temps, le mélange forme les membres souples,
Ainsi se présente la pensée chez les hommes ; car c'est la même chose
Que l'intelligence et que la nature des membres des hommes,
En tous les hommes et pour tout homme, car ce qui prédomine dans le corps fait la pensée.
On rapporte encore cette sentence d'Anaxagore à certains de ses amis : à savoir que les êtres seront tels qu'on les conçoit. Homère aussi4, dit-on, a manifestement partagé cette opinion, puisqu'il a représenté Hector, délirant par l'effet de sa blessure, étendu pensant d'autres pensées, ce qui suppose que ceux qui pensent de travers ont encore des pensées, bien que ce ne soit plus les mêmes. Évidemment, donc, s'il y a deux sortes de raison, les êtres réels aussi sont à la fois ainsi et non ainsi. Et c'est là où les conséquences d'une pareille doctrine sont le plus difficilement admissibles. Si, en effet, ceux qui ont le plus nettement aperçu toute la vérité possible pour nous (et ces hommes sont ceux qui la cherchent et l'aiment avec le plus d'ardeur), si ces hommes ont de pareilles opinions et professent ces doctrines sur la vérité, comment n'est-il pas naturel qu'on aborde avec découragement les problèmes de la Philosophie ? Poursuivre des oiseaux au vol : voilà ce que serait la recherche de la vérité.
La raison de l'opinion de ces philosophes, c'est que, considérant la vérité dans les êtres, ils ont entendu par êtres les seules choses sensibles. Or il y a dans les choses sensibles beaucoup d'indétermination et de cette sorte d'être que nous avons reconnu plus haut5. C'est ce qui explique pourquoi l'opinion en question, tout en n'étant pas l'expression de la vérité, n'est cependant pas sans vraisemblance (appréciation d'une plus grande justesse que celle d'Épicharme6 sur Xénophane). De plus, ces philosophes, voyant que toute cette nature sensible était en mouvement, et qu'on ne peut juger de la vérité de ce qui change, pensèrent qu'on ne pouvait énoncer aucune vérité, du moins sur ce qui change partout et en tout sens7. Cette manière de voir s'épanouit dans la plus radicale de toutes les doctrines que nous avons mentionnées, qui est celle des philosophes se disant disciples d'Héraclite, et telle que l'a soutenue Cratyle ; ce dernier en venait finalement à penser qu'il ne faut rien dire, et il se contentait de remuer le doigt ; il reprochait à Héraclite d'avoir dit qu'on ne descend pas deux fois dans le même fleuve, car il estimait, lui, qu'on ne peut même pas le faire une fois ! — Nous répondrons à cet argument que l'objet qui change, quand il change, donne assurément à ces philosophes quelque raison de ne pas croire à son existence. Encore cela est-il douteux, car, enfin, ce qui est en train de perdre une qualité possède encore quelque chose de ce qui est en train de se perdre, et, de ce qui devient, quelque chose doit déjà être. En général, un être qui périt renfermera encore de l'Être, et, s'il devient, il est nécessaire que ce d'où il vient, et ce par quoi il est engendré8, existe, et aussi que ce processus n'aille pas à l'infini. Mais passons sur ces considérations ; disons seulement qu'il n'y a pas identité entre changement quantitatif et changement qualitatif. Que selon la quantité, les êtres ne persistent pas, soit ; mais c'est d'après la forme9 que nous connaissons toutes choses. Il y a encore un autre reproche encouru par ceux qui pensent ainsi : c'est d'étendre à l'Univers tout entier des observations qui ne portent que sur les objets sensibles, et même que sur un petit nombre d'entre eux. En effet, la région du sensible qui nous environne est la seule où règnent la génération et la corruption, mais elle n'est même pas, si l'on peut dire, une partie du tout ; de sorte qu'il eût été plus juste d'absoudre le monde sensible en faveur du monde céleste, que de condamner le monde céleste à cause du monde sensible. Enfin, il est clair que nous pouvons reprendre, à l'égard de ces philosophes, la réponse que nous avons faite précédemment : nous devons leur montrer qu'il existe une réalité immobile10, et les en persuader. Ajoutons que, de toute façon, ceux qui professent l'existence simultanée de l'Être et du Non-Être sont cependant conduits à admettre que toutes choses sont plutôt en repos qu'en mouvement : il n'y a rien, en effet, en quoi elles puissent se transformer, puisque tout est dans tout11.
Au sujet de la vérité, nous devons soutenir que tout ce qui apparaît n'est pas vrai12. D'abord, en admettant même que la sensation ne nous trompe pas, du moins sur son objet propre, on ne peut cependant identifier l'image et la sensation. Ensuite, on est en droit de s'étonner de difficultés comme : les grandeurs et les couleurs sont-elles réellement telles qu'elles apparaissent de loin, ou telles qu'elles apparaissent de près ? sont-elles réellement telles qu'elles apparaissent aux malades ou aux hommes bien portants ? La pesanteur est-elle ce qui paraît pesant aux faibles ou bien aux forts ? La vérité est-elle ce qu'on voit en dormant ou dans l'état de veille ? Sur tous ces points, en effet, il est clair que nos adversaires ne croient pas ce qu'ils disent13. Il n'y a personne, du moins, qui, rêvant une nuit qu'il est à Athènes, alors qu'il est en Libye, se mette en marche vers l'Odéon14. De plus, en ce qui concerne le futur, selon la remarque de Platon15, l'opinion du médecin et celle de l'ignorant n'ont certainement pas une égale autorité, quand il s'agit de savoir, par exemple, si le malade recouvrera, ou non, la santé. Enfin, parmi les sensations considérées en elles-mêmes16, le témoignage d'un sens n'offre pas la même valeur quand il s'agit de l'objet d'un autre sens que lorsqu'il s'agit de son objet propre, ou même quand il s'agit de l'objet d'un sens voisin que lorsqu'il s'agit de l'objet du sens lui-même17 : c'est la vue qui juge de la couleur, et non le goût ; c'est le goût qui juge de la saveur, et non la vue. Aucun de ces sens, dans le même temps, appliqué au même objet, ne nous dit jamais que cet objet soit simultanément ainsi et non ainsi. Bien plus, même en des temps différents, un sens ne peut pas être en désaccord avec lui-même, du moins au sujet de la qualité ; le désaccord peut seulement porter sur le substrat auquel la qualité appartient. Je prends un exemple : le même vin, soit parce qu'il aura lui-même changé, soit parce que notre corps18 aura changé, pourra paraître doux à tel moment, et, à tel autre moment, non-doux. Mais ce n'est, du moins, pas le doux, tel qu'il est quand il existe, qui jamais encore ait changé ; on a toujours la vérité à son sujet, et ce qui sera doux est nécessairement tel. Et pourtant, c'est cette nécessité que ruinent tous les systèmes en question ; de même qu'ils nient toute substance, ils nient aussi qu'il y ait rien de nécessaire, puisque le nécessaire ne peut être à la fois d'une manière et d'une autre ; et, par conséquent, si quelque chose est nécessaire, elle ne sera pas à la fois ainsi et non ainsi. — En général, si vraiment le sensible existait seul19, rien n'existerait si les êtres animés n'existaient pas, puisque alors il n'y aurait pas de sensation20. Et sans doute est-il vrai de dire qu'il n'y aurait ni sensible, ni sensations (car ce sont des modifications du sujet sentant) ; mais que les substrats, qui produisent la sensation, n'existassent pas aussi indépendamment de la sensation, c'est ce qui est inadmissible. En effet, la sensation n'est assurément pas sensation d'elle-même, mais il y a quelque chose d'autre encore en dehors de la sensation, et dont l'existence est nécessairement antérieure à la sensation, car le moteur a sur le mobile une antériorité naturelle21. En admettant même que le sensible et la sensation soient des termes corrélatifs, cette antériorité n'en existe pas moins.
Aristote (384-322 avant J.C.), Métaphysique, Γ, 5, tr. J. Tricot, © Paris Vrin 1991, pages 219 à 229.
--------------------------------------------------------------------------------
1. L'école de Protagoras.
2. Aristote va montrer, dans les pages qui suivent, que la cause de l'erreur réside dans l'identification des choses sensibles, où le changement a une large part, avec l'ensemble de la réalité.
3. Ils sont responsables de ces opinions, et on est en droit de leur en demander compte (avec une nuance de blâme).
4. Comme tous les auteurs anciens, Aristote cite abondamment Homère. Le texte d'Homère est Iliade, XXIII 698 (qui ne s'applique d'ailleurs pas à Hector). Aristote fait dire à Démocrite (inexactement) que la raison égarée de l'homme malade vaut celle de l'homme sain. Les pensées d'Hector dans son délire sont des pensées différentes de celles de l'homme bien portant, et non pas des pensées fausses. En somme, tout le monde, quel que soit l'objet de sa pensée, pense vrai.
5. Il s'agit de l'Être en puissance, qui, étant à la fois Être et non-Être, paraît ruiner le principe de contradiction.
6. Épicharme, poète comique, disciple d'Héraclite et contemporain de Xénophane, né à Cos, vers 565, mort à Syracuse, vers 450. Dans le Théétète, 152 e, il s'oppose aux Éléates.
7. Ce qui a lieu pour les choses sensibles et matérielles.
8. Respectivement un sujet et une cause.
9. Laquelle est immuable. — Ainsi se terminent les considérations sur les choses sensibles.
10. Principe et cause des êtres mobiles et changeants.
11. Ou, si l'on veut, « tous les attributs appartiennent déjà à tous les sujets ». Si un sujet est à la fois chaud et non-chaud, le passage du chaud au non-chaud, ou du non-chaud au chaud, est inutile et inintelligible.
12. Aristote va réfuter spécialement Protagoras.
13. Les grandeurs et les couleurs sont réellement telles qu'elles apparaissent de près et non de loin, telles qu'elles apparaissent aux hommes bien portants ; la pesanteur, c'est ce qui apparaît pesant aux forts, et la vérité, ce qui paraît dans l'état de veille. Donc toute phantasia (φαντασια) n'est pas vraie. Aristote montre dans cette discussion un robuste bon sens, et il n'aperçoit aucune difficulté à distinguer, en pratique, la vérité de l'erreur.
14. Les actions de ces philosophes contredisent donc leurs paroles.
15. Théétète, 178b-179a.
16. Et non plus par comparaison avec les φαντασιαι.
17. Passage difficile, où Aristote établit la distinction, devenue classique, entre les perceptions naturelles et les perceptions acquises. Aristote veut dire que l'autorité d'un sens est plus grande quand il s'applique à son objet propre (la couleur pour la vue), que quand il s'applique à l'objet d'un autre sens, cet autre sens fût-il voisin. Les erreurs des sens ne sont ainsi, conformément à la psychologie classique, que des erreurs d'interprétation et de jugement.
18. Plus précisément l'organe sensoriel.
19. Ainsi que le veut Protagoras.
20. Mais c'est là une conséquence absurde et contraire à l'évidence. Si rien n'existait que dans la pensée, l'esse de l'homme lui-même consisterait dans le percipi (le fait qu'il est pensé) et non dans le percipere (le fait de penser), comme tout le monde le reconnaît. Dans tout ce passage, Aristote résume sa célèbre théorie de la connaissance, plus amplement exposée de Anima, III, 2, 425b26 et Catégories, 7, 7b15. La sensation est définie l'acte commun du sensible et du sentant, l'un n'allant pas sans l'autre : « L'acte du sensible et celui du sens sont un seul et même acte », mais leur concept n'est pas le même. J'entends, par exemple, le son en acte et l'ouïe en acte. Cette identité de l'acte du sensible et du sentant n'entraîne d'ailleurs pas la relativité du sujet et de l'objet, au sens où l'entendent les relativistes modernes.
21. C'est-à-dire qu'il peut exister sans le mouvement qu'il détermine, tandis que la réciproque n'est pas vraie. Sur le genre de relation du sensible au sentant, visée par les dernières lignes du chapitre, cf Métaphysique, Δ, 15, 1021a31, où l'on trouvera les développements nécessaires : le mesurable, le connaissable, le sensible, sont des τρος τι, mais en ce sens seulement que quelque autre chose est relative à eux ; par conséquent, ils sont logiquement antérieurs à leurs corrélatifs.
Descartes (1596-1650), le morceau de cire
Commençons par la considération des choses les plus communes, et que nous croyons comprendre le plus distinctement, à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Je n'entends pas parler des corps en général, car ces notions générales sont d'ordinaire plus confuses, mais de quelqu'un en particulier. Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche : il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli1, sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelque son. Enfin toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps, se rencontrent en celui-ci.
Mais voici que, cependant que je parle, on l'approche du feu2 : ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on toucher, et quoiqu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement ? Il faut avouer qu'elle demeure ; et personne ne le peut nier3. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ? Certes ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, ou l'odorat, ou la vue, ou l'attouchement, ou l'ouïe, se trouvent changées, et cependant la même cire demeure4. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que la cire5 n'était pas ni cette douceur du miel, ni cette agréable odeur des fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui un peu auparavant me paraissait sous ces formes, et qui maintenant se fait remarquer sous d'autres. Mais qu'est-ce, précisément parlant, que j'imagine, lorsque je la conçois en cette sorte ? Considérons-le attentivement, et éloignant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or qu'est-ce que cela : flexible et muable ? N'est-ce pas que j'imagine que cette cire étant ronde est capable de devenir carrée, et de passer du carré en une figure triangulaire ? Non certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination, et par conséquent cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer6.
Qu'est-ce maintenant que cette extension ? N'est-elle pas aussi inconnue, puisque dans la cire qui se fond elle augmente7, et se trouve encore plus grande quand elle est entièrement fondue, et beaucoup plus encore quand la chaleur augmente davantage ? Et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce que c'est que la cire, si je ne pensais qu'elle est capable de recevoir plus de variétés selon l'extension, que je n'en ai jamais imaginé. Il faut donc que je tombe d'accord, que je ne saurais pas même concevoir par l'imagination ce que c'est que cette cire, et qu'il n'y a que mon entendement seul8 qui le conçoive ; je dis ce morceau de cire en particulier, car pour la cire en général, il est encore plus évident. Or quelle est cette cire, qui ne peut être conçue que par l'entendement ou l'esprit9 ? Certes c'est la même que je vois, que je touche, que j'imagine, et la même que je connaissais dès le commencement. Mais ce qui est à remarquer, sa perception, ou bien l'action par laquelle on l'aperçoit10, n'est point une vision, ni un attouchement, ni une imagination, et ne l'a jamais été, quoiqu'il le semblât ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l'esprit11, laquelle peut être imparfaite et confuse, comme elle était auparavant, ou bien claire et distincte, comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée12.
Cependant je ne me saurais trop étonner, quand je considère combien mon esprit a de faiblesse, et de pente qui le porte insensiblement dans l'erreur. Car encore que sans parler je considère tout cela en moi-même, les paroles toutefois m'arrêtent, et je suis presque trompé par les termes du langage ordinaire ; car nous disons que nous voyons la même cire, si on nous la présente, et non pas que nous jugeons que c'est la même, de ce qu'elle a même couleur et même figure ; d'où je voudrais presque conclure, que l'on connaît la cire par la vision des yeux, et non par la seule inspection de l'esprit, si par hasard je ne regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire ; et cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts13 ? Mais je juge que ce sont de vrais hommes, et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui réside en mon esprit, ce que je croyais voir de mes yeux.
Un homme qui tâche d'élever sa connaissance au delà du commun, doit avoir honte de tirer des occasions de douter des formes et des termes de parler du vulgaire ; j'aime mieux passer outre, et considérer, si je concevais avec plus d'évidence et de perfection ce qu'était la cire, lorsque je l'ai d'abord aperçue, et que j'ai cru la connaître par le moyen des sens extérieurs, ou à tout le moins du sens commun, ainsi qu'ils appellent, c'est-à-dire de la puissance imaginative, que je ne la conçois à présent, après avoir plus exactement examiné ce qu'elle est, et de quelle façon elle peut être connue. Certes il serait ridicule de mettre cela en doute. Car qu'y avait-il dans cette première perception qui fût distinct et évident, et qui ne pourrait pas tomber en même sorte dans le sens du moindre des animaux ? Mais quand je distingue la cire d'avec ses formes extérieures, et que, tout de même que si je lui avais ôté ses vêtements, je la considère toute nue14, certes, quoi qu'il se puisse encore rencontrer quelque erreur dans mon jugement, je ne la puis concevoir de cette sorte sans un esprit humain.
Mais enfin que dirai-je de cet esprit, c'est-à-dire de moi-même15 ? Car jusques ici je n'admets en moi autre chose qu'un esprit. Que prononcerai-je, dis-je, de moi qui semble concevoir avec tant de netteté et de distinction ce morceau de cire ? Ne me connais-je pas moi- même, non seulement avec bien plus de vérité et de certitude, mais encore avec beaucoup plus de distinction et de netteté ? Car si je juge que la cire est, ou existe, de ce que je la vois, certes il suit bien plus évidemment que je suis, ou que j'existe moi-même, de ce que je la vois16. Car il se peut faire que ce que je vois ne soit pas, en effet, de la cire ; il peut aussi arriver que je n'aie pas même des yeux pour voir aucune chose ; mais il ne se peut pas faire que lorsque je vois, ou (ce que je ne distingue plus) lorsque je pense voir, que moi qui pense ne sois quelque chose. De même, si je juge que la cire existe, de ce que je la touche, il s'ensuivra encore la même chose, à savoir que je suis ; et si je le juge de ce que mon imagination me le persuade, ou de quelque autre cause que ce soit, je conclurai toujours la même chose. Et ce que j'ai remarqué ici de la cire, se peut appliquer à toutes les autres choses qui me sont extérieures, et qui se rencontrent hors de moi.
Or si la notion ou la connaissance de la cire semble être plus nette et plus distincte, après qu'elle a été découverte non seulement par la vue ou par l'attouchement, mais encore par beaucoup d'autres causes, avec combien plus d'évidence, de distinction et de netteté, me dois-je connaître moi-même, puisque toutes les raisons qui servent à connaître et concevoir la nature de la cire, ou de quelque autre corps, prouvent beaucoup plus facilement et plus évidemment la nature de mon esprit ? Et il se rencontre encore tant d'autres choses en l'esprit même, qui peuvent contribuer à l'éclaircissement de sa nature, que celles qui dépendent du corps, comme celles-ci, ne méritent quasi pas d'être nombrées.
Mais enfin me voici insensiblement revenu où je voulais ; car, puisque c'est une chose qui m'est à présent connue, qu'à proprement parler nous ne concevons les corps que par la faculté d'entendre qui est en nous, et non point par l'imagination ni par les sens, et que nous ne les connaissons pas de ce que nous les voyons, ou que nous les touchons, mais seulement de ce que nous les concevons par la pensée, je connais évidemment qu'il n'y a rien qui me soit plus facile à connaître que mon esprit. Mais, parce qu'il est presque impossible de se défaire si promptement d'une ancienne opinion, il sera bon que je m'arrête un peu en cet endroit, afin que, par la longueur de ma méditation, j'imprime plus profondément en ma mémoire cette nouvelle connaissance.
René Descartes (1596-1650), Les Méditations (1641), méditation seconde, © Paris classiques Garnier 1996, vol II pages 423 à 429.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Cette ferveur réaliste pourrait surprendre dans un texte ayant pour but de séparer l'esprit des sens, si l'on ne se souvenait, précisément, que « la bride » a été relâchée.
2. Il est à noter qu'en ceci l'exigence réaliste de Descartes n'est pas déçue par suite d'une entreprise volontaire ou d'un raisonnement, comme c'était le cas dans le doute, mais par un événement extérieur, qui va faire apparaître les qualités sensibles comme évanouissantes. On songe aussi bien, en lisant ce texte, à la critique platonicienne qu'à celle de Hegel, au début de la Phénoménologie de l'esprit, où la « maintenant » qui était nuit devient jour.
3. Prise à la lettre, cette phrase serait incompréhensible, puisque le doute concernant les corps n'est pas levé. Mais Descartes n'affirme en rien l'existence ou la permanence de la cire : ce qu'il analyse, c'est la conviction universelle, le jugement selon lequel la cire demeure alors que changent ses qualités. Le latin est beaucoup plus clair : il ne dit pas : personne ne le peut nier, mais : personne ne le nie, personne ne pense autrement (nemo negat, nemo aliter putat).
4. Ma croyance en la réalité de la cire, qui, d'abord, semblait se fonder sur sa perception spontanée, doit avoir une autre source puisque, une fois disparues toutes les qualités qu'appréhendait ma perception spontanée, je crois que la même cire demeure. La sensation ne peut donc fonder ma croyance en la réalité de la cire. (Dans une seconde hypothèse, Descartes va tenter de fonder cette croyance sur l'imagination.)
5. Ceram ipsam, la cire elle-même, dit plus clairement le latin.
6. Nec igitur comprehensio haec ab imaginandi facultate perficitur. Il faut remarquer que le mot latin est comprehensio. Je ne puis imaginer qu'un nombre fini de formes en la cire. Mais je comprends qu'elle peut en revêtir une infinité. L'imagination, qui avait dépassé la sensation, se trouve ici dépassée à son tour par l'entendement, et apparaît, en conséquence, comme fondée sur lui, et par lui.
7. Selon la physique de Descartes, l'extension propre d'un corps n'est pas susceptible d'augmenter (lorsqu'un corps se dilate, d'autres corps pénètrent en lui). Mais, une fois encore, l'analyse n'est pas ici physicienne : elle ne porte pas sur la cire, mais sur le jugement qui affirme son existence et sa permanence. Or il est clair que, quand un corps paraît se dilater, nous jugeons pourtant (à tort ou à raison) qu'il demeure le même corps. Voilà ce dont il faut rendre compte. (De toute façon, l'affirmation cartésienne selon laquelle l'extension qui constitue la cire demeure inconnue, ignota, son extension apparente variant sans cesse, suffit à réfuter l'interprétation classique selon laquelle l'analyse aurait ici pour but de distinguer dans la cire les qualités sensibles, qui ne lui appartiennent pas, et l'étendue, qui constitue sa vraie nature.)
8. Ici le latin est moins clair, et dit : sola mente percipere. Il n'est pas douteux qu'une des fonctions de l'analyse dite du morceau de cire soit de hiérarchiser les éléments du cogito, et de découvrir l'entendement à la racine de l'imagination et de la sensation. Il faut pourtant avouer que le mot intellectus, qui sera repris à la fin de la Méditation, ne figure pas une seule fois dans le texte latin consacré à cette analyse. Le mot que le français traduit par entendement est mens, qui veut dire esprit.
9. Ici encore, le latin dit seulement : non nisi mente percipitur.
10. Ou bien l'action par laquelle on l'aperçoit est ajouté dans la traduction.
11. Mentis inspectio.
12. Cf. dans les Sixièmes Réponses, la réponse de Descartes au point 9. Même dans la perception spontanée, la faculté qui pose l'existence des objets extérieurs est le jugement, et la condition nécessaire du jugement (on serait tenté de dire, avec Kant, la condition a priori de l'objectivité) est l'entendement. Ainsi « l'action par laquelle on l'aperçoit » (la cire) est, même dans la perception sensible, inspection de l'esprit. Mais, confuse quand elle est spontanée et immédiate, cette inspection de l'esprit devient elle-même l'objet d'une idée claire et distincte quand elle est analysée et parvient à la conscience de soi.
13. Sub qui but latere passent automata, dit le latin. Il y a peu de chances, en vérité, pour qu'il en soit ainsi. Mais il suffit d'une chance d''erreur pour qu'il soit établi que ma perception est jugement. Ici, l'analyse est donc d'ordre logique, et fort différente de l'analyse phénoménologique de Merleau-Ponty qui, on le sait, s'est opposé à ce texte de Descartes (Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945, pp. 41 et sq.)
14. Ce texte peut donner à penser que, cette fois, Descartes se demande bien ce qu'est la cire, et la réduit à son attribut essentiel, en la séparant de ses accidents. Dans les Cinquièmes Réponses (sur la Seconde Méditation, VIII), Descartes déclarera au contraire qu'il n'a « point fait abstraction du concept de la cire d'avec celui de ses accidents ». La cire toute nue, c'est donc simplement la cire comme objet de mon entendement, ce pourquoi il est dit qu'elle ne peut se concevoir de la sorte « sans un esprit humain ».
15. Descartes revient non seulement à l'esprit (mens), mais au moi qui est son sujet, et qu'il n'en a jamais séparé.
16. On notera qu'il n'est pas question ici de l'essence étendue de la cire, mais de sa seule existence. Le problème est toujours : de quelle existence suis-je certain ? Et l'analyse a montré que toute affirmation d'une existence extérieure à moi renvoie, d'abord, à mon existence.
--------------------------------------------------------------------------------
Objections de Pierre Gassendi à la méditation seconde.
VIII. Vous apportez ensuite l'exemple de la cire, et touchant cela vous dites plusieurs choses pour faire voir « que ce qu'on appelle les accidents de la cire est autre chose que la cire même ou sa substance, et que c'est le propre de l'esprit ou de l'entendement seul, et non point du sens ou de l'imagination, de concevoir distinctement la cire ou la substance de la cire ». Mais premièrement, c'est une chose dont tout le monde tombe d'accord, qu'on peut faire abstraction du concept de la cire ou de sa substance de celui de ses accidents ? Mais pour cela pouvez-vous dire que vous concevez distinctement la substance ou la nature de la cire ? Il est bien vrai qu'outre la couleur, la figure, la fusibilité, etc., nous concevons qu'il y a quelque chose qui est le sujet des accidents et des changements que nous avons observés ; mais de savoir quelle est cette chose ou ce que ce peut être, certainement nous ne le savons point ; car elle demeure toujours cachée, et ce n'est quasi que par conjecture que nous jugeons qu'il doit y avoir quelque sujet qui serve de soutien et de fondement à toutes les variations dont la cire est capable. C'est pourquoi je m'étonne que vous disiez qu'après avoir ainsi dépouillé la cire de toutes ses formes, ni plus ni moins que de ses vêtements, vous concevez plus clairement et plus parfaitement ce qu'elle est. Car je veux bien que vous conceviez que la cire ou plutôt la substance de la cire doit être quelque chose de différent de toutes ses formes ; toutefois vous ne pouvez pas dire que vous conceviez ce que c'est, si vous n'avez dessein de nous tromper. Car cela ne vous est pas rendu manifeste, comme un homme le peut être de qui nous avions seulement aperçu la robe et le chapeau, quand nous venons à les lui ôter pour savoir ce que c'est ou quel il est. En après, puisque vous pensez comprendre en quelque façon quelle est cette chose, dites-nous, je vous prie, comment vous la concevez ? N'est-ce pas comme quelque chose d'étendu et de spatial ? Car je ne pense pas que vous la conceviez comme un point, quoiqu'elle soit telle qu'elle s'étende tantôt plus et tantôt moins. Maintenant cette sorte d'étendue ne pouvant pas être infinie, mais ayant ses bornes et ses limites, ne la concevez-vous pas aussi en quelque façon figurée ? Puis, la concevant de telle sorte qu'il vous semble que vous la voyez, ne lui attribuez-vous pas quelque sorte de couleur, quoique très obscure et confuse1 ? Certainement, comme elle vous parait avoir plus de corps et de matière que le pur vide, aussi vous semble-t-elle plus visible ; et partant, votre intellection est une espèce d'imagination. Si vous dites que vous la concevez sans étendue, sans figure et sans couleur, dites-nous donc naïvement ce que c'est.
Ce que vous dites des hommes que nous avons vus et conçus par l'esprit, de qui néanmoins nous n'avons aperçu que les chapeaux ou les habits, ne nous montre pas que ce soit plutôt l'entendement que la faculté imaginative qui juge. Et de fait, un chien, en qui vous n'admettez pas un esprit semblable au vôtre, ne juge-t-il pas de même façon lorsque, sans voir autre chose que la robe ou le chapeau de son maître, il ne laisse pas de le reconnaître ? Bien davantage, encore que son maître soit debout, qu'il se couche, qu'il se courbe, qu'il se raccourcisse ou qu'il s'étende, il connaît toujours son maître, qui peut être sous toutes ces formes, mais non pas plutôt sous l'une que sous l'autre, tout de même que la cire ? Et lorsqu'il court après un lièvre, et qu'après l'avoir vu vivant et tout entier il le voit mort, écorché et dépecé en plusieurs morceaux, pensez- vous qu'il n'estime pas que ce soit toujours le même lièvre ? Et partant ce que vous dites que « la perception de la couleur, de la dureté, de la figure, etc., n'est point une vision ni un tact, etc., mais seulement une inspection de l'esprit », je le veux bien pourvu que l'esprit ne soit point distingué réellement de la faculté imaginative. Et lorsque vous ajoutez que « cette inspection peut être imparfaite et confuse, ou bien parfaite et distincte, selon que plus ou moins on examine les choses dont la cire est composée », cela ne nous montre pas que l'inspection que l'esprit a faite de ce je ne sais quoi qui se retrouve dans la cire outre ses formes extérieures soit une claire et distincte connaissance de la cire, mais bien seulement une recherche ou inspection faite par les sens de tous les accidents qu'ils ont pu remarquer en la cire et de tous les changements dont elle est capable. Et de là nous pouvons bien, à la vérité, comprendre et expliquer ce que nous entendons par le nom de cire, mais de pouvoir comprendre et même de pouvoir aussi faire concevoir aux autres ce que c'est que cette substance, qui est d'autant plus occulte qu'elle est considérée toute nue, c'est une chose qui nous est entièrement impossible.
René Descartes (1596-1650), Œuvres philosophiques II, © Paris classiques Garnier 1996, vol II pages 718 à 721.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Un des arguments les plus constants de l'empirisme consiste à montrer que l'étendue ne peut être pensée sans quelque couleur : on ne saurait donc séparer tout à fait concevoir, imaginer et sentir.
--------------------------------------------------------------------------------
Réponses de Descartes
VIII. Ici, comme souvent ailleurs, vous faites voir seulement que vous n'entendez pas ce que vous tâchez de reprendre ; car je n'ai point fait abstraction du concept de la cire d'avec celui de ses accidents, mais plutôt j'ai voulu montrer comment sa substance est manifestée par les accidents, et combien sa perception, quand elle est claire et distincte, et qu'une exacte réflexion nous l'a rendue manifeste1 diffère de la vulgaire et confuse. Et je ne vois pas, ô chair, sur quel argument vous vous fondez pour assurer avec tant de certitude que le chien discerne et juge de la même façon que nous, sinon parce que, voyant qu'il est aussi composé de chair, vous vous persuadez que les mêmes choses qui sont en vous se (rencontrent) aussi en lui. Pour moi, qui ne reconnais dans le chien aucun esprit, je ne pense pas qu'il y ait rien en lui de semblable aux choses qui appartiennent à l'esprit2.
IX. Je m'étonne que vous avouiez que toutes les choses que je considère en la cire prouvent bien que je connais distinctement que je suis, mais non pas quel je suis ou quelle est ma nature, vu que l'un ne se démontre point sans l'autre. Et je ne vois pas ce que vous pouvez désirer de plus, touchant cela, sinon qu'on vous dise de quelle couleur, de quelle odeur et de quelle saveur est l'esprit humain, ou de quel sel, soufre et mercure il est composé3, car vous voulez que, comme par une espèce d'opération chimique, à l'exemple du vin nous le passions par l'alambic4, pour savoir ce qui entre en la composition de son essence. Ce qui certes est digne de vous, ô chair, et de tous ceux qui, ne concevant rien que fort confusément, ne savent pas ce que l'on doit rechercher de chaque chose. Mais, quant à moi, je n'ai jamais pensé que pour rendre une substance manifeste il fût besoin d'autre chose que de découvrir ses divers attributs ; en sorte que plus nous connaissons d'attributs de quelque substance, plus parfaitement aussi nous en connaissons la nature ; et tout ainsi que nous pouvons distinguer plusieurs divers attributs dans la cire : l'un qu'elle est blanche, l'autre qu'elle est dure, l'autre que de dure elle devient liquide, etc. ; de même y en a-t-il autant en l'esprit : l'un qu'il a la vertu de connaître la blancheur de la cire, l'autre qu'il a la vertu d'en connaître la dureté, l'autre qu'il peut connaître le changement de cette dureté ou la liquéfaction, etc., car tel peut connaître la dureté qui pour cela ne connaîtra pas la blancheur, comme un aveugle-né, et ainsi du reste5. D'où l'on voit clairement qu'il n'y a point de chose dont on connaisse tant d'attributs que de notre esprit, parce qu'autant qu'on en connaît dans les autres choses, on en peut autant compter dans l'esprit de ce qu'il les connaît ; et partant sa nature est plus connue que celle d'aucune autre chose.
Enfin, vous m'arguez ici en passant de ce que, n'ayant rien admis en moi que l'esprit, je parle néanmoins de la cire que je vois et que je touche, ce qui toutefois ne se peut faire sans yeux ni sans mains ; mais vous avez dû remarquer que j'ai expressément averti qu'il ne s'agissait pas ici de la vue ou du toucher, qui se font par l'entremise des organes corporels, mais de la seule pensée de voir et de toucher, qui n'a pas besoin de ces organes, comme nous expérimentons toutes les nuits dans nos songes ; et certes vous l'avez fort bien remarqué, mais vous avez seulement voulu faire voir combien d'absurdités et d'injustes cavillations6 sont capables d'inventer ceux qui ne travaillent pas tant à bien concevoir une chose qu'à l'impugner et contredire.
René Descartes (1596-1650), Œuvres philosophiques II, © Paris classiques Garnier 1996, vol II pages 800 à 803.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Le latin dit : quomodo ejus perceptio reflexa et distincta, qualem nullam, o caro, videris unquam habuisse (comment sa perception réfléchie et distincte, telle que vous semblez, ô chair, ne l'avoir jamais eue).
2. Sur ce point, Descartes répond un peu vite. Et l'on ne peut prétendre que Gassendi n'ait fourni aucun argument (cf. son texte, relatif au chien reconnaissant son maître comme nous-mêmes reconnaissons des hommes sous des manteaux et des chapeaux). Car l'argument de Gassendi est le suivant : dans l'exemple des hommes aperçus de la fenêtre, Descartes estime que reconnaître un homme alors qu'on ne voit qu'un manteau ou un chapeau prouve qu'au fondement de toute perception il y a un jugement, une inspection de l'esprit. Et cet argument lui permet d'établir le primat de l'esprit sur le corps, de la conscience sur l'objet. Or l'animal reconnaît, de même, son maître. Ne faut-il pas alors, ou accorder un esprit à l'animal, ou avouer qu'une imagination de type animal suffit à expliquer la perception ?
3. L'objection de Gassendi appelait bien cette réponse. Car il demandait une analyse matérielle et objective de l'esprit, analogue à celle que le chimiste opère du vin. Pour Descartes, l'esprit est conscience et sujet. Pourtant, nous allons voir sa réponse s'orienter de telle sorte que l'esprit y soit aussi maintenu comme substance, et comme substance ayant plus de réalité que celle du corps. En fait, nous sommes encore éloignés des théories modernes de la conscience.
4. Gassendi a, en effet, parlé du vin en termes de distillation (le flegme, etc.).
5. Pour répondre à Gassendi, Descartes insiste moins sur l'unité de l'esprit (qu'il affirme par ailleurs) que sur la multiplicité de ses attributs. À chaque qualité connue, ou connaissable, il fait donc répondre, dans l'esprit, un pouvoir de la connaître. Par là, il affirme que l'esprit a plus de réalité que ses objets, et qu'il est mieux connu qu'eux.
6. cavillation : terme de barreau, signifie : mauvaise chicane.
Merleau-Ponty (1908-1961), corps propre et acte perceptif
Au niveau de l'opinion, le corps propre est à la fois objet constitué et constituant à l'égard des autres objets. Mais si l'on veut savoir de quoi l'on parle, il faut choisir, et, en dernière analyse, le replacer du côté de l'objet constitué. De deux choses l'une, en effet : ou bien je me considère au milieu du monde, inséré en lui par mon corps qui se laisse investir par les relations de causalité, et alors « les sens » et « le corps » sont des appareils matériels et ne connaissent rien du tout ; l'objet forme sur les rétines une image, et l'image rétinienne se redouble au centre optique d'une autre image, mais il n'y a là que des choses à voir et personne qui voie, nous sommes renvoyés indéfiniment d'une étape corporelle à l'autre, dans l'homme nous supposons un « petit homme » et dans celui-ci un autre sans jamais arriver à la vision ; ou bien je veux vraiment comprendre comment il y a vision, mais alors il me faut sortir du constitué de ce qui est en soi, et saisir par réflexion un être pour qui l'objet puisse exister. Or, pour que l'objet puisse exister au regard du sujet, il ne suffit pas que ce « sujet » l'embrasse du regard ou le saisisse comme ma main saisit ce morceau de bois, il faut encore qu'il sache qu'il le saisit ou le regarde qu'il se connaisse saisissant ou regardant, que son acte soit entièrement donné à soi-même et qu'enfin ce sujet ne soit rien que ce qu'il a conscience d'être, sans quoi nous aurions bien une saisie de l'objet ou un regard sur l'objet pour un tiers témoin, mais le prétendu sujet, faute d'avoir conscience de soi, se disperserait dans son acte et n'aurait conscience de rien. Pour qu'il y ait vision de l'objet ou perception tactile de l'objet, il manquera toujours aux sens cette dimension d'absence, cette irréalité par laquelle le sujet peut être savoir de soi et l'objet exister pour lui. La conscience du lié présuppose la conscience du liant et de son acte de liaison, la conscience d'objet présuppose la conscience de soi ou plutôt elles sont synonymes. S'il y a donc conscience de quelque chose, c'est que le sujet n'est absolument rien et les « sensations », la « matière » de la connaissance ne sont pas des moments ou des habitants de la conscience, elles sont du côté du constitué. Que peuvent nos descriptions contre ces évidences et comment échapperaient-elles à cette alternative ? Revenons à l'expérience perceptive. Je perçois cette table sur laquelle j'écris. Cela signifie, entre autres choses, que mon acte de perception m'occupe, et m'occupe assez pour que je ne puisse pas, pendant que je perçois effectivement la table, m'apercevoir la percevant. Quand je veux le faire, je cesse pour ainsi dire de plonger dans la table par mon regard, je me retourne vers moi qui perçois, et je m'avise alors que ma perception a dû traverser certaines apparences subjectives, interpréter certaines « sensations » miennes, enfin elle apparaît dans la perspective de mon histoire individuelle. C'est à partir du lié que j'ai secondairement conscience d'une activité de liaison, lorsque, prenant l'attitude analytique, je décompose la perception en qualités et en sensations et que, pour rejoindre à partir d'elles l'objet où j'étais d'abord jeté, je suis obligé de supposer un acte de synthèse qui n'est que la contrepartie de mon analyse. Mon acte de perception, pris dans sa naïveté, n'effectue pas lui-même cette synthèse, il profite d'un travail déjà fait, d'une synthèse générale constituée une fois pour toutes, c'est ce que j'exprime en disant que je perçois avec mon corps ou avec mes sens, mon corps, mes sens étant justement ce savoir habituel du monde, cette science implicite ou sédimentée. Si ma conscience constituait actuellement le monde qu'elle perçoit, il n'y aurait d'elle à lui aucune distance et entre eux aucun décalage possible, elle le pénétrerait jusque dans ses articulations les plus secrètes, l'intentionnalité nous transporterait au cour de l'objet, et du même coup le perçu n'aurait pas l'épaisseur d'un présent, la conscience ne se perdrait pas, ne s'engluerait pas en lui. Nous avons, au contraire, conscience d'un objet inépuisable et nous sommes enlisés en lui parce que, entre lui et nous, il y a ce savoir latent que notre regard utilise, dont nous présumons seulement que le développement rationnel est possible, et qui reste toujours en deçà de notre perception. Si, comme nous le disions, toute perception a quelque chose d'anonyme, c'est qu'elle reprend un acquis qu'elle ne met pas en question. Celui qui perçoit n'est pas déployé devant lui-même comme doit l'être une conscience, il a une épaisseur historique, il reprend une tradition perceptive et il est confronté avec un présent. Dans la perception nous ne pensons pas l'objet et nous ne nous pensons pas le pensant, nous sommes à l'objet et nous nous confondons avec ce corps qui en sait plus que nous sur le monde, sur les motifs et les moyens qu'on a d'en faire la synthèse. C'est pourquoi nous avons dit avec Herder que l'homme est un sensorium commune. Dans cette couche originaire du sentir que l'on retrouve à condition de coïncider vraiment avec l'acte de perception et de quitter l'attitude critique, je vis l'unité du sujet et l'unité intersensorielle de la chose, je ne les pense pas comme le feront l'analyse réflexive et la science.
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 274-276.
_________________
Date de dernière mise à jour : 29/04/2021







 ème visiteur
ème visiteur