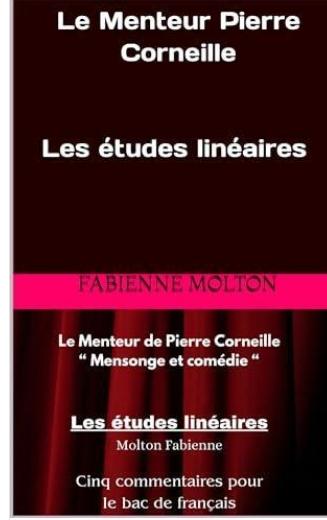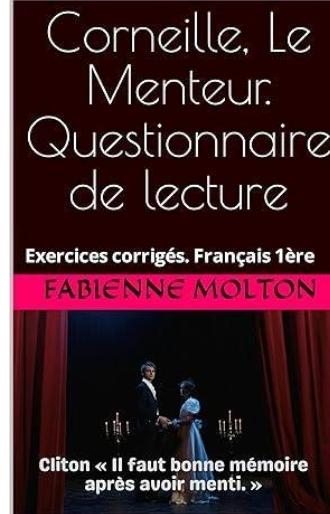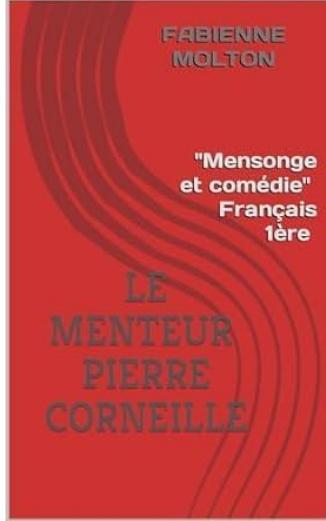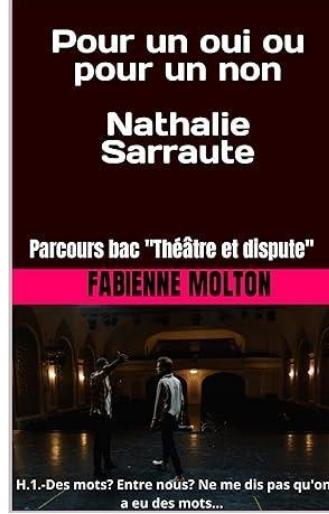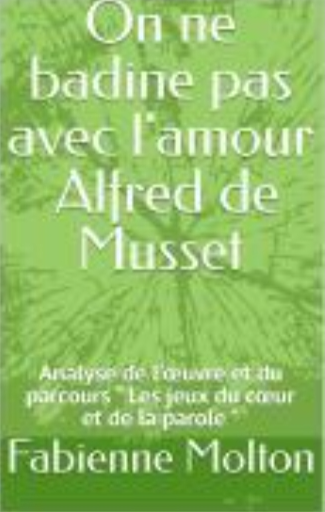Séquence roman : l'incipit

Le personnage de roman du XVIIème à nos jours
Séquence roman série S
Problématique : Dans quelle mesure l'incipit peut-il révéler la figure du personnage romanesque et annoncer le roman à venir?
Lectures analytiques
L'incipit de Madame Bovary
L'incipit de Bel ami, Maupassant
L'incipit de L'assommoir de Zola
L'incipit de l'Etranger de Camus
Etudes d'ensemble :
Etudier l'importance stratégique de l'incipit
Comparer le début et la fin d'un roman : incipit/excipit
Lectures cursives
Entre débuts et fins
Excipit Madame Bovary Flaubert
Excipit de Bel ami Maupassant
Excipit de l'assommoir Zola
Incipits et évolution du genre romanesque
Denis Diderot Incipit de Jacques le fataliste
Incipit de la modification de Butor
Incipit des Gommes, Robbe Grillet
ORAL
TEMPS DE PREPARATION : 30mn
ETAPES DE LA PREPARATION :
1- Cerner la question : bien comprendre les mots-clés.
2- Orienter la réflexion à partir de l’analyse de la question.
3- Mobiliser ses connaissances sur le texte et les organiser dans un plan qui s’adapte à la question posée.
OBJET D’ETUDE
LE PERSONNAGE DE ROMAN DU XVIIème À NOS JOURS
QUESTIONS POUR L’EXPOSE :
LECTURE ANALYTIQUE 1: Madame Bovary
1- En quoi cet incipit est-il déconcertant pour le lecteur?
2- Comment cet incipit annonce-t-il une œuvre novatrice ?
3- Pourquoi le personnage de Charles est-il « nouveau » ?
4- Cet incipit joue-t-il son rôle ?
LECTURE ANALYTIQUE 2: L’Assommoir
1- Cet incipit assure-t-il toutes les fonctions d’un incipit de roman?
2- Comment ce début de roman nous introduit-il dans un roman naturaliste?
LECTURE ANALYTIQUE 3: Bel-Ami
1- En quoi cet incipit constitue-t-il le début d’un roman naturaliste?
2- Cet incipit joue-t-il son rôle ?
3- Montrez que cet incipit inaugure un roman d’apprentissage.
LECTURE ANALYTIQUE 4: L’Etranger, INCIPIT
1- Camus présente son personnage comme "un homme qui, sans aucune attitude héroïque, accepte de mourir pour la vérité".
Peut-on dire que l’incipit du roman nous laisse deviner ce destin du personnage?
2- Cet incipit joue-t-il son rôle ?
3- En quoi ce début de roman est-il étrange ?
4- Comment cet incipit annonce-t-il une œuvre novatrice ?
 Madame Bovary, Flaubert
Madame Bovary, FlaubertMadame Bovary est un roman de Gustave Flaubert paru en 1857. Le titre original était Madame Bovary, mœurs de province. Au début, Flaubert ne voulait pas qu'on illustre son roman avec un portrait de femme pour laisser libre cours à l'imagination du lecteur.
La genèse de Madame Bovary
1 - A quelle date Flaubert commence t'-il son roman?
Flaubert commence le roman en 1851
2 - Pendant combien d'années y travaille t'-il?
Il y travaille pendant cinq ans, jusqu’en 1856.
3 - Dans quelle revue, le texte est-il publié?
le texte est publié dans la Revue de Paris sous la forme de feuilleton
4 - Que se passe t'-il en février 1857?
Flaubert, l'imprimeur et le gérant de la revue sont jugés pour "outrage à la morale publique et religieuse ainsi qu'aux bonnes moeurs".
5 - Flaubert est-il condamné?
Non, il est finalement acquitté grâce à ses liens avec la société du Second Empire et avec l'impératrice. A la même époque Baudelaire est poursuivi par le même tribunal après la publication des Fleurs du mal, il sera condamné.
6 - L'ouvrage de Flaubert connaît-il un grand succès?
Oui, le roman connaîtra un grand succès en librairie.
7 - Qui Flaubert côtoie t'-il dans les milieux littéraires?
Les Frères Goncourt, Baudelaire, Sainte-Beuve, Théophile Gautier
Le " bovarysme "
1 - Que signifie le "bovarysme"?
Le " bovarysme" est une insatisfaction à l'égard des choses du réel du fait d'une trop grosse tendance au rêve, à l'illusion et à l'idéalisation. C'est une échappatoire à la réalité, une mélancolie, un trouble de l'âme.
le bovarysme se définit comme un mal de vivre, un « spleen ».
« C'est, dit Georges Palante, le pouvoir qu'a l'homme de se concevoir autre qu'il n'est [...] : l'illusion bovaryque commence avec la substitution de l'être apparent ou imaginaire à l'être véritable.»
2 - Qui a initié le "bovarysme"?
Jules de Gaultier, en 1892
3 - Qui était Jules de Gaultier?
Un philosophe français influencé par Schopenhauer et Nietzsche. Il a ensuite influencé Georges Palante : philosophe et sociologue français.
4 - Quand le terme "bovaryser" est-il dans le dictionnaire?
En 2014, dictionnaire le Grand Robert. Il propose la définition suivante : "le fait de rêver à un autre destin plus satisfaisant".
5 - Citez un autre auteur qui a déjà décrit cet état d'âme dans la littérature
Honoré de Balzac, La Femme de trente ans. Flaubert s'en serait inspiré (dans cette hypothèse, Balzac serait l'inventeur du "bovarysme".
6 - Citez trois noms de personnages de la fiction qui sont passés dans la langue commune et désignent un type humain ou social ou encore psychologique.
Un Rastignac, un Don Juan, un tartuffe, une bovary
7 - Le bovarysme peut-il apparaître comme un symptôme de la modernité?
Oui, Madame Bovary, personnage flaubertien incarne un mythe littéraire et le bovaryme apparaît comme un symptôme de la modernité. On peut parler de dimension psychologique du "bovarysme". Baudelaire voyait un caractère hystérique dans le "bovarysme". Un mal moderne, une illusion romantique
8 - Comment se manifeste l'illusion romantique chez Emma Bovary?
Emma se nourrit des Méditations poétiques de Lamartine et des romans de Walter Scott. On retrouve dans le bovarysme d'Emma une version dégradée du romantisme.
9 - Peut-on dissocier le "bovarysme" de la condition de la femme au XIXe siècle?
On peut parler de femme objet condamnée à l'évasion, victime de désillusions, on le voit chez Emma qui en se mariant a perdu toute identité. Elle est seulement Madame Bovary.
10 - Quelle relation au monde Emma Bovary représente t'-elle?
Elle représente l'ennui dans sa vie quotidienne de petite bourgeoise provinciale dans un village Normand et l'échec dans son mariage avec Charles Bovary, officier de santé, en témoignent ses aventures adultères.
Emma se réfugie dans l'illusion d'un autre monde jusqu'à l'échec du rêve qui la mène au suicide.
11 - Peut-on parler d'une héroine tragique? En quoi?
Non pas vraiment car Emma Bovary ne ressemble pas au héros tragique en proie à une grande lucidité et toujours dans l'action. Elle incarne un personnage passif, nostalgique. Aucune prise de conscience ne sort de la rêverie, la déception devient synonyme de "petite mort".
12 - Quel roman de Georges Perec illustre le mieux ce bovarysme contemporain en 1965?
Le roman intitulé Les Choses, 1965
Extrait Des Choses de Perec
« Ils croyaient imaginer le bonheur [...]. Ils croyaient qu’il leur suffisait de marcher pour que leur marche soit un bonheur. Mais ils se retrouvaient seuls, immobiles, un peu vides. Une plaine grise et glacée, une steppe aride : nul palais ne se dressait aux portes des déserts, nulle esplanade ne leur servait d’horizon. » Georges Pérec, Les Choses, «J’ai lu ».
Le titre et le sous-titre
Que pouvez-vous dire du titre et du sous-titre?
Titre : Madame Bovary
Sous-titre : Moeurs de province
Madame Bovary est un personnage éponyme
Le sous-titre nous apprend que nous sommes dans la France provinciale au milieu du XIXe siècle.
Le titre nous enseigne que l'héroine est une femme manifestement privée de son identité, elle porte le nom de son mari. Son nom de jeune fille est Emma Rouault.
Comment vivait Emma avant de se marier avec Charles?
Elle vivait avec son père dans une ferme après avoir passé sa jeunesse dans un couvent. Emma se nourrissait durant cette période d'enseignement religieux, de livres romantiques. Sa vision de la vie est idéaliste. Elle s'ennuie à la ferme et rêve de rencontrer un homme. Charles Bovary sera une échappatoire à sa vie monotone, mais Emma va très vite s'ennuyer avec Charles, médecin de campagne sans grande personnalité.
Emma Bovary : un modèle typique de la femme du XIXe siècle?
Non Emma Bovary ne représente qu'une minorité des femmes de son époque.
La femme avait une éducation traditionnelle, la fidélité est la base du mariage et en ce sens on peut affirmer qu'Emma du fait de ses adultères successifs se distingue du modèle typique de la femme. Emma n'est pas une femme aimante, une mère attentive, elle fuit le foyer et s'égare dans ses aventures répétées pour fuir le quotidien de sa vie. En outre, Emma a accès aux économies de Charles, ce qui pour l'époque est inédit. Emma Bovary n'est donc pas représentative du modèle typique de la femme du XIXe siècle. Elle se détache de son rôle conventionnel, elle s'octroie une liberté que les femmes n'avaient pas à cette époque.
Emma Bovary : une femme universelle et intemporelle
Le personnage au cinéma après le XIXe siècle
Affiche du film par Claude Chabrol
Le réalisateur, 1991 commence son tournage de Madame Bovary inspiré du roman de Gustave Flaubert : son adaptation suit parallèlement l'oeuvre de Flaubert. Chabrol retranscrit cette tragédie avec une grande authenticité. Il s'attache à dépeindre avec mépris la bourgeoisie provinciale, les entrepreneurs et les banquiers. Il modernise l'histoire de Flaubert et fait d'Emma Bovary, une femme fyant la médiocrité, la monotonie, l'ennui avec la même élégance que l'auteur.
Bande dessinée, Gemma Bovery, 1999
Posy Simmonds, dessinatrice propose une BD intitulée Gemma Bovery en 1999, il s'agit d'une Emma Bovary des temps modernes.
Flaubert: sa vie et son œuvre:
1 - De quel siècle Flaubert est-il? 19e siècle.
Il est né le 12 décembre 1821 et est mort le 8 mai 1880
2 - Où est-il né? Rouen
3 - A quel milieu social appartient-il?
Il appartient à la petite bourgeoisie catholique
4 - Avec qui Flaubert fonde t'-il le journal manuscrit, Art et Progrès?
Avec Ernest Chevalier en 1834
5 - Qui rencontre t'-il dans les années 1836?
Elisa Schlésinger, à Trouville-sur-Mer.
6 - A quel ouvrage, cette rencontre a t'-elle donné lieu?
A l'Education sentimentale
7 - A t'-il marqué la littérature française?
Oui, du fait de la profondeur de ses analyses psychologiques, ses descriptions réalistes et le réalisme de son écriture.
8 - Citez trois ouvrages:
Mme Bovary, Salammbô, L'éducation sentimentale
9 - Quand l'ouvrage l'éducation sentimentale a t'-il été rédigé?
Septembre 1864
Il comporte des éléments autobiographiques comme par exemple la rencontre de Mme Arnoux qui fait allusion à Elisa Schlésinger, ou encore le personnage principal, Frédéric qui reflète les expériences de jeunesse de Flaubert.
10 - De qui le cœur du récit est-il tiré?
Du roman de Ste Beuve, Volupté. Balzac avait déjà traité le sujet dans le Lys dans la vallée mais Flaubert l'a réécrit. Les règles narratives sont nouvelles. Il réinvente ainsi la notion de Roman d'apprentissage
11 - Flaubert a t'-il fait des études?
Oui, des études de droit à Paris mais sans conviction.
12 - Quelle est son ambition?
Se consacrer à l'écriture. Il le fera après la mort de ses parents. Il vivra de ses rentes, son père lui laisse en héritage une fortune de 500 000 francs.
13 - Qui rencontre t'-il à Paris?
Victor Hugo, Maxime Du Camp.
14 - Avec qui Flaubert entretient-il une correspondance considérable?
Avec la poétesse Louise Colet avec qui il a vécu une liaison amoureuse sur 10 ans.
15 - Qui est le père littéraire de Flaubert?
Balzac. Il est très marqué par les productions littéraires de Balzac, il reprend les thème du Lys dans la vallée dans l'Education sentimentale et s'inspire de la Femme de trente ans dans Madame Bovary.
Le réalisme de Flaubert
Flaubert est-il considéré comme le chef de file du réalisme?
Oui, il est considéré comme le représentant du réalisme dans le sens ou il étudie la réalité historique et sociale tout comme Balzac mais il rejette ce titre réducteur de chef de file. Dans une lettre adressée à George Sand, il affirme " Notez que j'exècre ce qu'on est convenu d'appeler le réalisme bien qu'on m'en fasse un des pontifes."
Plutôt que transcription du réel, Flaubert revendique une transfiguration du réel par l'écriture.
Questions sur le naturalisme et le réalisme
Créé en même temps que le romantisme (De Balzac à Stendhal), le réalisme ne prend vraiment son essort que dans la période 1850-1900 (par Flaubert et Maupassant) et se retrouve dans le naturalisme créé par Zola.
1) Réalisme et Naturalisme (à travers l'histoire)
- Les romans emprunts de réalisme s'identifient à l'époque traversée: des révolutions de 1848 (qui se retrouve dans "L'Education sentimentale" de Flaubert, du coup d'état de L-N Bonaparte (conteste de "La Fortune des Rougon" de Zola) ou de la politique stable du 2ème Empire (1852 à 1870).
-Les Années 1850-1900 virent la vraie naissance du capitalisme moderne: Zola le décrit à travers les grands magasins dans "Au bonheur des dames" paru en 1883, et à travers la bourse dans "l'Argent" paru en 1891. C'est une époque de fortes évolutions tant sociales (naissance de la classe ouvrière) qu' urbaines (à travers le Paris du Préfet Haussmann).
-C'est enfin le grand moment du positivisme, qui use de l'expérience scientifique comme fondement à tout savoir. Les romanciers écrivent aussi sur les avancées en médecine et en psychologie, Maupassant disserte sur la folie ("Le Horla" en 1887), les frères Goncourt s'expriment sur l'hystérie féminine ("Germine Lacerteux" en 1865), ou encore Zola sur les valeurs de l'hérédité, servant de base à ses "Rougon-Macquart" (de 1871 à 1893), période romanesque sous titrée "Histoire Naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire".
Réalisme et naturalisme :
- A quel moment le naturalisme prend t'-il son essor?
- Citez deux romans réalistes
- Quelles sont les caractéristiques du réalisme?
- Quelles en sont les sources?
- Quel est le cadre historique?
2) Les clés du réalisme et du naturalisme:
-Les principes généraux de la vision réaliste naissent chez Balzac qui crée, avec "La comédie Humaine" le roman total, vrai "concurrence à l'Etat-civil" (préambule de 1842) et chez Stendhal qui crée le roman assimilé à "une glace qui déambule sur une grande-route" ("Le Rouge et le Noir" en 1830). Les 2 écrivains affirment retranscrire la réalité de manière fidèle.
-Le mot "réalisme survient, au début de manière péjorative pour enfin définir une nouvelle création de description, constituée autour de Gustave Courbet. Plus tard, Champfleury et Duranty se l'approprient en littérature en affirmant l'objectivité sur base romantique, et ses qualités de description. Le réalisme n'est cependant qu'au second plan comme courant en littérature: et même Flaubert, pourtant son affirmé (Chef de file, ne se disait-il pas comme non-réaliste).
-Par contre, le naturalisme a bien représenté une école littéraire, avec les frères Goncourt et Zola ("Thérése Raquin", en 1867, puis les "Rougon Macquart" à partir de 1871). Les écrits de ce dernier écrivain, Le Roman d'expérience (en 1880) et les Romanciers (1881) apportent leur fondement au naturalisme; ils revendiquent un réalisme extrémiste par leur expérimentation du modèle scientifique. Ils s'attirent toutefois des avis mesurés, chez Maupassant (exemple: la préface de "Pierre et Jean", en 1887) ou chez Huysmans "exemple: la préface de "A retours", en 1903).
Les clés du réalisme et du naturalisme :
- Quels sont les deux écrivains qui posent les clés du réalisme?
- Définissez "réalisme"
- Le naturalisme a t'-il représenté une école littéraire?
- Quels écrits sont à l'origine du fondement du naturalisme?
- Quel réalisme les écrivains fondateurs revendiquent-ils?
- De quel modèle s'inspirent-ils?
3) Les genres réalistes et naturalistes:
- Le roman est le genre le plus retenu: on estime qu'il décrit le mieux la réalité. Balzac avec "La Comédie Humaine", et Zola , avec les "Rougon-Macquart" racontent de grandes épopées familiales sur fond de social et d'histoire. Contrairement aux romantiques avec le roman sur fond d'histoire, les réalistes et les naturalistes s'intéressent eux au présent et tirent leur inspiration de la vie réelle (Stendhal écrit aussi son roman "Le Rouge et le Noir" en se basant sur un fait divers relaté dans un journal).
-Le descriptif a une grande importance, car il permet de décrire la réalité: il repète les "petits faits avérés" (Stendhal) et cela donne un effet de réalité.
-Enfin, se focaliser dans ce genre de romans, autorise des effets complexes, entre narrateur présent en permanence, image du démiurge qui crée tout un monde (Balzac), et le "se focaliser" propre à Zola, qui permet au narrateur de se dissimuler derrière ses personnages.
Les genres réralistes et naturalistes :
- Parmi les genres réralistes et naturalistes, quel est le genre le plus reconnu? Pourquoi?
- Que racontent Balzac et Zola dans la Comédie humaine et les Rougon Macquart?
- Quelle est la base de l'inspiration de ces genres littéraires?
- Quelle est la place du descriptif?
4) Les Thèmes réalistes et naturalistes:
-Le réalisme s'attaque d'abord au romantisme, qu'on accuse d'éloigner de la réalité. Flaubert dans "Madame Bovary", décrit les effets néfastes de l'illusion romantique sur l'héroisme de son roman). Par contre, réalistes et naturalistes revendiquent la réalité des villes, politique et sociale. Les héros de ces romans sont ordinaires, qu'ils soient de la classe bourgeoise de Flaubert ou de la classe ouvrière de Zola
- Zola décrit aussi, dans les "Rougon-Macquart" le monde des prostituées, l'alcool et le crime.
-C'est la réalité que les romans décrivent. C'est pourquoi le réalisme a souvent été qualifié d' inesthétique et parfois même manquant de moralité et apportant la subversion: en 1857; un procés a même été intenté contre Flaubert "Madame Bovary" sous l'accusation suivante: "Atteinte à la morale des gens et aux bonnes moeurs".
Les thèmes réalistes et naturalistes :
- A quoi le réalisme s'attaque t'-il?
- Donnez un exemple
- Que revendiquent les réalistes et les naturalistes?
- Citez trois thèmes recurrents chez Zola
- Le réalisme est -il associé à la moralité ou au manque de moralité?
- Que pouvons-nous dire à ce propos sur Madame Bovary?
Questions sur le roman :
Le roman et ses personnages : visions de l'homme et du monde, série de questions
-
Le roman et ses personnages : visions de l'homme et du monde, série de questions
-
1. Donner une définition du roman.
-
Le roman est, au XIIème siècle, un récit en vers français. A partir du XIVème siècle, le roman renvoie à des textes en prose. Selon son sens moderne, le roman est une « œuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. »
-
2. Quelles sont les différentes formes du roman ?
-
Le roman de chevalerie et les fabliaux (de petites histoires en vers simples et amusants) au Moyen-âge
-
Le roman comique au XVIIème
-
Le roman épistolaire et le roman picaresque (dont le héros est un aventurier ou un vaurien) au XVIIIème
-
Le roman historique, le roman de mœurs, le roman d’aventures, et le roman fantastique au XIXème
-
Le roman policier, le roman de science-fiction, le roman analyse et le « nouveau roman » au XXème.
-
3. Quelles sont les interrogations romanesques essentielles ?
-
La passion amoureuse
-
L’apprentissage du monde et la découverte du réel
-
Le jeu de la mémoire et du temps
-
L’interrogation devant la condition humaine.
-
4. Quelles sont les fonctions du roman ?
-
La fonction ludique (se divertir, s’évader, s’identifier…)
-
La fonction didactique :
-
o le roman comme connaissance du monde (roman historique, roman social, roman témoignage…)
-
o Le roman comme connaissance de l’homme
-
o Le roman comme leçon (le roman engagé, la morale)
-
o Le roman comme interrogation
-
5. Donner des exemples de romans à fonction didactique?.
-
Romans didactiques : Les lettres persanes de Montesquieu - Les liaisons dangereuses de Laclos - Le rouge et le noir de Stendhal
-
6. Qu’est-ce que le schéma actantiel ?
-
Le schéma actantiel s’applique parfois parfaitement à l’intrigue, et pour certaines œuvres, il ne coïncide que partiellement avec l’action. Les personnages principaux, qui ont une place importante dans le déroulement du récit (parmi eux, le héros) sont classés en deux catégories qui s’opposent :
-
o Les personnages adjuvants, qui aident le héros dans sa quête (de même, peuvent être adjuvants des objets, des évènements…)
-
o Les personnages opposants, qui sont en conflit avec le héros, et tentent de le mettre en échec.
-
Le héros, entouré des personnages principaux, subit une épreuve principale avant d’atteindre son but.
-
7. Comment la caractérisation des personnages est-elle réalisée ?
-
Elle est directe pour les descriptions, les renseignements explicites sur l’identité du personnage
-
Elle est indirecte quand il s’agit de déduire les traits de la personnalité du héros, de son comportement, ou ses paroles.
-
On appelle « effet personnage » l’illusion de réalité que donne le roman, le lecteur assemblant mentalement au fil du récit des éléments dispersés qui construisent peu à peu le personnage. Pourtant, celui-ci n’est rien au départ.
-
8. Quelles sont les fonctions des personnages dans un roman ? Représentation : le portrait des personnages donne au lecteur l’image d’une réalité.
-
Symbole : Le personnage symbolise souvent toute une catégorie de personnes, il dépasse les perspectives individuelles.
-
Interprétation : c’est à travers le personnage que se construit le sens du récit.
-
Identification : les comportements d’un personnage peuvent influencer le lecteur qui a tendance à s’identifier à lui.
-
Esthétique : il existe un art de la composition du personnage, et de le créer au fil du récit.
-
Information : Le personnage transmet des indices, des valeurs au lecteur.
-
9. Qu’est-ce qu’un héros ?
-
Le personnage principal d'un roman est la personne sur laquelle sont fondées toute l'action, et toute la cohérence de l'histoire contée. Dans notre langage quotidien, nous appelons toujours le personnage principal le héros de l'histoire ; or le véritable héros est l'individu qui parvient à vaincre les difficultés et à régler les problèmes par l'intermédiaire de sa force, son pouvoir ou son intelligence. Les vrais héros de romans vivent de multiples aventures racontées dans de nombreux ouvrages, ils ont déjà des capacités ou des facultés particulières qui autorisent ces aventures. Le mot « héros » désigne à l’origine, un demi-dieu, qui accomplit des exploits, et incarne le courage et des valeurs morales. Cependant, il existe des personnages principaux appelés des antihéros.
-
10. Qu’est-ce qu’un antihéros ?
-
On peut distinguer quatre types principaux d’antihéros:
-
o le personnage « sans qualités », l’être ordinaire vivant une vie ordinaire dans un cadre ordinaire
-
o le héros « décalé », un personnage ordinaire, sans qualités, qui par les circonstances se trouve plongé dans une situation extraordinaire.
-
o le héros négatif, porteur de valeurs antihéroïques et en général antisociales, mais sans qualités « héroïques ».
-
o le héros déceptif, un personnage ayant potentiellement des qualités héroïques mais qui n’en fait pas usage ou les utilise mal ou à mauvais escient, ou qui tend à perdre ces qualités, ou enfin qui se trouve dans un cadre où ces qualités ne sont plus appréciées ou admises.
-
11. Quelles sont les différents types de héros, et leurs caractéristiques ?
-
Au XVIIème siècle, prédominent les héros raffinés des romans précieux, les héros joyeux des romans comiques, et les héros parfaits du roman classique.
-
Au XVIIIème siècle, on assiste à la naissance du héros de roman moderne, avec les personnages entreprenants du réalisme, les héros du roman libertin, les héros philosophes du roman des lumières, les héros sensibles des romans du courant pré-romantique.
-
Au XIXème, le personnage idéalisé du roman romantique apparaît, ainsi que le héros moderne des romans réalistes, et le héros expérimental du roman naturaliste.
-
Au XXème siècle, on retourne à des personnages forts (vers les années 30), ce sont des héros engagés, aux prises avec les conflits de leur temps. Dans les années 50, les personnages dans le nouveau roman sont remis en question, par exemple en rendant le personnage principal anonyme, ou en ne se focalisant pas sur un personnage principal.
-
12. Qu’est –ce que la focalisation ?
-
Pour raconter une histoire, on doit choisir un point de vue, la focalisation : le romancier décide qui perçoit les événements rapportés. (le mot « focalisation » est issu du vocabulaire photographique : c’est le foyer à partir duquel une photo est prise.
-
13. Quels sont les différents points de vue utilisés dans un roman ?
-
Le point de vue externe = perception « du dehors », sans connaître les pensées des personnages.
-
Le point de vue interne = perception d’un seul personnage, dont on suit les pensées, les sensations.
-
Le point de vue omniscient (ou focalisation zéro) = perception de l’ensemble des sentiments et des sensations de tous les personnages, ainsi que du passé et de l’avenir.
-
14. Qu’est-ce que les modalités du récit ? Quelles sont-elles dans un roman ?
-
Le temps romanesque n’est pas linéaire comme le temps réel : le récit peut accélérer ou ralentir l’action, revenir en arrière, s’arrêter brusquement. Les personnages ont dans le roman une vie plus ou moins complète, certains ne font que des apparitions épisodiques, la façon dont ils s’inscrivent dans le temps peut donc être importante dans l’étude du roman. Ce sont ces « effets » que l’on appelle modalités.
-
La scène : durée du récit = vie du personnage. (Elle est calquée sur les évènements.)
-
La pause : (Comme son nom l’indique, c’est un arrêt du déroulement des évènements.)
-
Le sommaire : . (Les évènements sont énumérés ou résumés.)
-
Analepse : c’est un retour en arrière (qui provoque une pause dans le récit. Le temps n’avance plus, mais des renseignements qui font avancer le récit sont dévoilés.)
-
Prolepse : anticipation du futur
-
Ellipse : passage sous silence d’une période plus ou moins longue.
-
Modalité itérative : action répétée une seule fois.
-
15. Quelle est la structure du récit dans le roman ?
-
Le récit romanesque est composé de :
-
o La situation initiale : définit le cadre de l'intrigue, met en place le lieu, l'époque, les personnages... le héros vit une situation d’équilibre.
-
o L’élément perturbateur : C'est l'élément qui fait basculer la situation du début, remet en cause l'état initial: rencontre, découverte, événement inattendu...
-
o Les péripéties : c’est une suite de transformations qui modifie la situation des personnages.
-
o L’élément de résolution : il annonce la résolution de l’intrigue. C’est le dénouement.
-
o La situation finale : Le personnage principal trouve une nouvelle situation d'équilibre, sur laquelle s’achève le roman/le récit.
-
Ce modèle, à l'origine de toute invention narrative, peut être plus ou moins modifié; certaines étapes peuvent être difficiles à reconnaître, ou leur ordre changé. Mais retrouver et analyser ce schéma permet d'enrichir l'étude du roman.

DEFINITION DU ROMAN:
Les origines du roman sont liées à la langue romane et à l’affirmation de la langue française. Issus de l’épopée en vers, les premiers romans évoquent le monde de la chevalerie.
Le genre du roman adopte progressivement ses caractéristiques narratives. Mais il est longtemps considéré comme un genre mineur. C’est au XIXème siècle, reconnu comme l’âge d’or du roman, qu’il acquiert ses lettres de noblesse, au moment où la bourgeoisie affirme ses codes dans la société.
Le roman met toujours en scène un ou plusieurs individus qui cherchent à s’intégrer dans la société.
Le XXème siècle voit la remise en cause des codes traditionnels du roman, en particulier dans ce que l’on a appelé le nouveau roman.
Le roman, souvent inclassable, admet toutefois différentes catégories : le roman de chevalerie, le roman libertin, le roman épistolaire, le roman historique, le roman naturaliste, le roman d’initiation, le roman policier… reconnaissables à la structure narrative développée.
Incipit de Madame Bovary - Flaubert
Nous étions à l'Etude, quand le Proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.
Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d'études :
- Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge.
Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.
On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir, pour qu'il se mît avec nous dans les rangs.
Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière ; c'était là le genre.
Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manoeuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffure d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis s'alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d'or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait.
- Levez-vous, dit le professeur.
Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.
Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la ramassa encore une fois.
- Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d'esprit.
Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux.
- Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom.
Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible.
- Répétez !
Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe.
- Plus haut ! cria le maître, plus haut !
Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à pleins poumons, comme pour appeler quelqu'un, ce mot : Charbovari.
Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo, avec des éclats de voix aigus (on hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait : Charbovari ! Charbovari !), puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où saillissait encore çà et là, comme un pétard mal éteint, quelque rire étouffé.
Flaubert - Madame Bovary
Plan détaillé: Lecture analytique
Madame Bovary , Gustave FLAUBERT
→ Cet incipit remplit-il son rôle?
Introduction
Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, roman éponyme paru en 1857 qui connaîtra un vif succès.
Nous nous poserons la question de savoir si cet incipit remplit son rôle et pour répondre à cette question, nous allons analyser, dans un premier temps les fonctions essentielles de l'incipit, son aspect séducteur et intrigant puis, son double aspect original et novateur.
I/ Un incipit qui remplit ses fonctions essentielles
A
Une entrée dans le roman par le lecteur et le personnage
→ Nous entrons dans le roman en même temps que Charles, nouveau dans sa classe. C’est une entrée “in medias res” (alors que l’action a commencé). Il y a une répétition du mot “ nouveau ” huit fois qui est même en italique. Une entrée dans le roman in medias res = latin= "au milieu des choses" - est un procédé littéraire qui consiste à placer le lecteur, ou le spectateur au milieu de l'action. Les évènements qui précèdent ne sont relatés qu'après.
B
Une présentation détaillée d’un des personnages principaux
→ Charles Bovary a l’air mal à l’aise et imbécile. Ceci est mis en évidence par deux longues descriptions : celle de ses vêtements et celle de sa casquette. La plus importante est celle de la casquette, c’est une synecdoque . En effet, sa casquette est dite “ comme le visage d’un imbécile ”, voulant en réalité signifier que Charles Bovary a le visage d’un imbécile. Il n’est pas à sa place il est “plus haut de taille que chacun de nous tous” - Le terme "casquette" est utilisé 5 fois dans l'extrait, elle est décrite de façon ironique et péjorative. Ainsi Flaubert écrit : "C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile". La présentation de la casquette est très détaillée au point de mettre en avant sa "laideur muette" = c'est une coiffure grotesque qui a plusieurs couleurs, plusieurs formes et plusieurs matières. Cet aspect est encore renforcé par l'énumération :"bonnet à poil, du chapska...... pauvres choses". Notons la référence à l'animalité : "poil", "loutre", "poil de lapin" ainsi que la géométrie ridicule : "losange de velours", "boudins circulaires", "polygones de carton" sans oublier la personnification très insultante "une de ces pauvres choses". On peut parler de ton satirique.
C
Un début à la fois annonciateur de l’intrigue
→ Dès ses débuts dans le roman, et à moindre échelle dans la classe, Charles Bovary échoue.
Il y a un parallélisme entre la classe et le roman. Au sortir de la classe, Charles est ridiculisé notamment avec la punition qu’il récupère de son professeur qui lui dit “ vous me copierez vingt fois le verbe ridiculus sum ”
Ceci fait penser que Charles va ressortir ridicule du roman.
→ En même temps les informations sont peu nombreuses à propos d’une suite possible.
II/ Un incipit qui intrigue et séduit
A
De quoi amuser le lecteur
→ Il y a des comiques de situation et de gestes “ bredouillement ” de Charles: “ Charbovari ” (
Il ne sait que faire de la casquette “ sa casquette tomba [...] il se baissa pour la reprendre ”
puis ironie du professeur “ vous la retrouverez votre casquette on ne vous l’a pas volée! ”
La maladresse de Charles est accentuée par sa gestuelle maladroite « il se leva, sa casquette tomba », cela suscite les moqueries de la toute la classe, "toute la classe se mit à rire", "il y eut un rire éclatant des écoliers". Cet aspect est mis en relief avec les passés simples. Charles est seul face aux élèves et au professeur, sa solitude est complète ainsi que le suggère le pronom personnel "il " par opposition au "nous" collectif. Stupide, risible, docile, humilié, pitoyable : c'est ainsi qu'apparaît le personnage au lecteur.
B
Un narrateur qui varie et divertit
→ Le narrateur interne : pronom “ nous ” et “ on ”
narrateur qui devient omniscient ? : “ il ne savait ”
La focalisation omnisciente du narrateur met en avant la solitude et l'exclusion du personnage tout au long du texte. Il y a une opposition très nette entre les moqueurs et le moqué.
ironique : “ débarrassezvous donc de votre casque "
C
Une intrigue qui n’est pas entièrement dévoilée et qui nous apportera des surprises
→ L’héroine éponyne du roman est Madame Bovary or elle n’est aucunement mentionnée. Le caractère de Charles laisse penser qu’il ne fera pas grand chose d’incroyable il “ demeurait immobile ” et on le voit mal faire quelque chose qui soit digne d’écrire un roman.
III/ Un incipit tout de même original et novateur
A
Un cadre spatiotemporel temporaire
→ Cette entrée dans le roman se fait dans un cadre spatiotemporel différent du reste de l’histoire. En effet, le titre Madame Bovary est en opposition avec le fait que Charles ait “ une quinzaine d’années environ ” et soit donc trop jeune pour se marier. Il y a une ellipse entre l’incipit et le reste du roman.
B
Charles Bovary, un antihéros?
→ Le champ lexical de la honte est utilisé avec “ fort embarassé ” “ inintelligible ”
“ bredouillement ” “ les yeux baissés ” etc.. Cela montre que Charles n’est pas un personnage au caractère héroique habituel. Il est peu sûr de lui, hésitant et préfigure la médiocrité ce qui le différencie des héros habituels.
Flaubert fait de son personnage, un véritable antihéros, placé sous le signe de la médiocrité et de l'exclusion. Cette perception de Charles est suscitée par la casquette tout d'abord. Il refuse de se révolter et souligne sa soumission définitive faisant de lui un être timide jusqu'au ridicule. C'est donc par l'intermédiaire de la casquette que Flaubert fait de son personnage un antihéros.
"Charbovary" = première occurrence du nom Bovary = évocateur du mot latin "bos", "bovi" qui signifie boeuf. Charbovari a également une similitude sonore avec charivari = vacarme.
C
L’introduction d’un “genre nouveau”
→ Flaubert en débutant ce roman débute une nouvelle forme de genre. Il y a un parrallèle entre le nouvel élève et le nouveau “ genre ” créé par Flaubert. Il insiste ce mot de “genre” en le mettant en italique. La banalité de Charles est nouvelle et surprenante, comme ce type de roman au XIX ème siècle.
Conclusion
Nous pouvons donc conclure en affirmant que Flaubert nous propose un incipit qui remplit son rôle car il répond à ses fonctions essentielles mais il est en outre, séducteur, intrigant, original et novateur.
Cette scène réaliste a une portée symbolique car elle est annonciatrice d'une tragédie et d'un personnage assimilé à un antihéros.
Ouvertures possibles :
- Balzac, le Père Goriot, la pension de Madame Vauquer
Père Goriot " Sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne " = réciprocité de la propriétaire, Madame Vauquer et de la pension.
- Flaubert : Un Coeur simple, chapitre IV, l'auteur décrit le perroquet pour évoquer son propriétaire, Félicité.
Questionnaire sur l'incipit
Problématique :
Cet incipit remplit-il son rôle?
I/ Un incipit qui remplit ses fonctions essentielles
A -
1 - Comment le lecteur entre t'-il dans le roman?
2 - Comment Charles est-il perçu dès le début de l'extrait?
3 - Comment s'appelle ce genre d'incipit? Donnez-en la définition exacte
4 - Que traduit la récurrence par huit fois du mot "nouveau"?
B -
Une présentation détaillée d’un des personnages principaux
1 - Comment Charles Bovary se sent-il?
2 - Comment cela est-il mis en évidence?
3 - Quelle est la description la plus importante?
4 - A quelle figure de style pouvez-vous associer la casquette?
5 - Relevez la comparaison significative de la casquette et de Charles. Expliquez cette figure de rhétorique
6 - Que traduit la répétition du terme "casquette"?
7 - Montrez qu'elle est décrite de manière ironique et péjorative.
8 - Analysez la manière dont Flaubert souligne "la laideur muette"
9 - Relevez l'énumération essentielle relative à la description
10 - Y a t'-il une référence à l'animalité? Que traduit-elle?
11 - Relevez le champ lexical de la géométrie et montrez qu'elle renforce le ridicule.
12 - Relevez une personnification
13 - Le ton est-il satirique?
C -
Un début à la fois annonciateur de l’intrigue
1 - Expliquez le parallélisme entre la classe et le roman
2 - Montrez comment le ridicule de la situation transparait de manière hyperbolique avec l'exemple de la punition
3 - Cela anticipe t'-il sur l'état d'esprit à venir de Charles dans le roman?
4 - Avons-nous des informations sur une éventuelle suite possible de l'histoire?
II/ Un incipit qui intrigue et séduit
A -
De quoi amuser le lecteur
1 - Analysez en citant le ou les différent(s) comique(s)
2 - Relevez la citation du texte qui reflète l'ironie du professeur
3 - Comment la maladresse de Charles est-elle encore accentuée : analysez les temps et relevez les passages du texte révélateurs à cet égard.
4 - Comment la solitude de Charles contraste t'-elle avec l'ensemble des élèves de la classe et le professeur
5 - Donnez 5 adjectifs pour évoquer de la manière la plus précise possible le personnage
B -
Un narrateur qui varie et divertit
1 - Que peut-on dire du narrateur? Citez pour justifier votre réponse
2 - Que met en relief la focalisation omnisciente?
C -
Une intrigue qui n’est pas entièrement dévoilée et qui nous apportera des surprises
1 - L'héroine éponyme du roman est-elle mentionnée? Qui est-elle?
2 - Quelle citation de l'extrait montre au lecteur que Charles ne sera pas un personnage très digne.
III/ Un incipit tout de même original et novateur
A
Un cadre spatiotemporel temporaire
1 - Quel est le cadre spatio-temporel? Est-il différent du reste de l'histoire?
2 - Montrez qu'il y a une contradiction entre le titre du livre et le fait que Charles ait "une quinzaine d'années environ".
3 - Peut-on parler d'ellipse entre l'incipit et le reste du roman? Donnez la définition de l'ellipse.
B
Charles Bovary, un antihéros?
1 - Relevez le champ lexical de la honte
2 - Charles est-il un héros? Un antihéros?
3 - Proposez une définition du héros et de l'antihéros.
4 - Quel élément du passage connote par anticipation l'idée que le personnage est en échec et sous le signe de la médiocrité et de l'exclusion?
5 - Analysez l'effet et le sens de "Charbovary".
C
L’introduction d’un "genre nouveau"
1 - En quoi pouvons-nous parler d'un "genre nouveau"?
Définition de l'incipit: incipere: en latin: commencer
L'incipit est le début d'un roman
Il a pour fonction de renseigner le lecteur, de donner des informations sur la suite de l'histoire et d'éclairer sur le lieu, l'époque, les personnages secondaires et le personnage principal.
Il a donc dans un premier temps, une fonction informative. Il doit en outre être divertissant dans le sens où il doit intéresser, donner envie de poursuivre la lecture
Questions possibles à l'oral sur la notion d'incipit
Quelle est la définition de l'incipit? Donnez l'origine latine
Quelles sont les deux fonctions de l'incipit
Citez un autre exemple d'incipit in medias res
Bel ami, Maupassant, l'incipit
Anlayse de l'incipit et oral EAF
Questions sur Maupassant :
-
De quel siècle Maupassant est-il?
- Guy de Maupassant, né Henry-René-Albert-Guy de Maupassant le 5 août 1850 au château de Miromesnil à Tourville-sur-Arques et mort le 6 juillet 1893 à Paris, est un écrivain français.
- Citez trois de ses oeuvres
- Une Vie en 1883, Bel-Ami en 1885, Pierre et Jean en 1887-1888
- Citez deux de ses contemporains
- José Maria de Heredia et Flaubert
- A quel mouvement littéraire appartient-il?
- Au mouvement réaliste
- A t'-il marqué la littérature français?
- Oui, il a marqué la littérature, ces oeuvres retiennent l'attention par leur force réaliste.
- A quel âge Maupassant est-il décédé?
- Il meurt à 43 ans. Il sombre peu à peu dans la folie;
Bel-ami de Maupassant : l'incipit
Problématique
En quoi le personnage de roman est-il porteur de l’image d’une société?
George Duroy
Extrait partie I, chapitre 1 de « la caissière » à « des hommes de familles »
Incipit: portrait de Duroy
-Physique: beau
-Caractère (implicite): résolu
-son quotidien.
A la fin du texte, il est dans l’attente d’un changement, renouveau « un désir aussi le travaillait », « il attendait aussi autre chose, d’autres baisers, moins vulgaires ».
Son trajet des Bois de Boulogne vers les Champs-Elysées correspond à son ascension sociale qu’il souhaite atteindre.
I) Un portrait contrasté
a)La sensualité:
Georges Duroy est beau, naturel et charmant (il le sait), il attire les femmes, il aime la chair, il a les manières des bourgeois.
« regard de joli garçon », « uniforme des hussards », « poitrine bombée », « garder une certaine élégance tapageuse ».
Il est beau ce qui l’ avantage pour sa quête amoureuse « il volait un peu d’amour ».
b) la pauvreté:
Mais aussi un homme pauvre, contraint de compter ses moindres dépenses avant même de les faire « il lui restait juste 3 francs quarante… », « cela représentait … boulevard », « quoique habillé…60 francs ».
La pauvreté est un handicap, George aime les endroits renommés « gagnait les Champs- Elysée », l.37 on trouve le champ lexical de la saleté qui souligne le mépris de Duroy dans le lieu où il vit.
II) Le portrait d’un ambitieux
a) Caractère arrogant résolu
« frisa sa moustache », « il avait l’air de toujours défier quelqu’un », « coup d’épervier », G. Duroy se sent supérieur aux autres.
b)Envie de renouveau
« quand Georges…arbres », il va du milieu populaire vers le milieu bourgeois, il ne veut plus compter ses repas, il veut gagner plus d’argent. « Il attendait depuis 3 mois », « une rencontre amoureuse », « il attendait… d’autres baisers moins vulgaires » Duroy veut rencontrer une femme pour ne plus avoir à côtoyer les rodeuses. Il ne veut pas n’importe quelle femme.
Conclusion:
Cet incipit nous pose les bases du roman, comment G.Duroy va-t-il user de son charme pour rencontrer une vraie femme et connaître une ascension sociale?

Texte:
Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges Duroy sortit du restaurant.
Comme il portait beau, par nature et par pose d’ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d’un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon, qui s’étendent comme des coups d’épervier.
Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d’un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d’une robe de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cette gargote à prix fixe.
Lorsqu’il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu’il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche trois francs quarante pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks sur le boulevard. C’était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits ; et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette.
Il marchait ainsi qu’au temps où il portait l’uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes comme s’il venait de descendre de cheval ; et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l’oreille son chapeau à haute forme assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l’air de toujours défier quelqu’un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beau soldat tombé dans le civil.
Quoique habillé d’un complet de soixante francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d’un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d’une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires.
C’était une de ces soirées d’été où l’air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces.
Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d’un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main.
Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s’arrêta encore, indécis sur ce qu’il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l’avenue du bois de Boulogne pour trouver un peu d’air frais sous les arbres ; mais un désir aussi le travaillait, celui d’une rencontre amoureuse.
Comment se présenterait-elle ? Il n’en savait rien, mais il l’attendait depuis trois mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait, par-ci, par-là, un peu d’amour, mais il espérait toujours plus et mieux.
La poche vide et le sang bouillant, il s’allumait au contact des rôdeuses qui murmurent, à l’angle des rues : « Venez-vous chez moi, joli garçon ? » mais il n’osait les suivre, ne les pouvant payer ; et il attendait aussi autre chose, d’autres baisers, moins vulgaires.
Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues ; il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d’elles. C’étaient des femmes enfin, des femmes d’amour. Il ne les méprisait point du mépris inné des hommes de familles.
Deuxième partie de l'entretien sur Bel-ami : Entretien de 23 questions avec réponses en commentaire
*** Toutes les réponses aux questions sont dans le commentaire joint
Questions sur l'incipit :
- Problématique: En quoi le personnage de roman est-il porteur de l’image d’une société?
Plan de l'étude :
- Lecture du texte
- Introduction
- I- Un portrait contrasté
- A - La sensualité
- B - La pauvreté
- II - Le portrait d'un ambitieux
- A - Un caractère arrogant
- B - Envie de renouveau
L'oral du bac : questions sur le texte :
I -
A-
- - Faites le portrait physique de Duroy
- - Citez pour justifier votre réponse
- - Quel rapport peut-on faire entre son aspect physique et son rapport avec les femmes?
B-
- - Quel est son niveau social?
- - Comment vit-il?
- - Citez et justifiez votre réponse
- - A quoi aspire t'-il?
- - Cherche t'-il à avoir une meilleure qualité de vie?
- - Relevez le champ lexical de la saleté
- - Que lui inspire le lieu où il vit?
II -
A -
- - Quels sont les traits de caractère de Duroy?
- - Citez pour justifier votre réponse
- - Comment se perçoit-il?
- - Peut-on évoquer un complexe de supériorité?
B -
- - A quoi aspire t'-il?
- - Comment expliquer l' envie de renouveau?
- - L'estimez-vous exigeant? En quoi?
- - Pensez-vous qu'il s'agisse d'un personnage complexe?
- - Peut-on dire que cet incipit pose les bases du roman?
- - Est-il atypique? Traditionnel?
- - Faites un rappel des caractéristiques de l'incipit traditionnel
- - De l'incipit atypique?
- - Citez parmi vos références littéraires, un exemple de chaque.

*** Séquence roman, un roman naturaliste
Naturalisme de Zola : réalités, symboles et critique sociale
Objet d'étude« Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme »Problématique et objectifsA travers des textes représentatifs de l'écriture naturaliste du romancier, il s'agit d'étudier comment l'écrivain opère la transfiguration d'une réalité particulière en symboles, le plus souvent porteurs d'une critique sociale. critique de la société corrompue du second Empire.
Questions sur Zola :
Émile Zola est un écrivain et journaliste français
né à Paris le 2 avril 1840 et mort dans la même ville le 29 septembre 1902
Considéré comme le chef de file du naturalisme, c’est l'un des romanciers français les plus
Germinal, Nana, L’Assommoir
Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour Les Rougon-Macquart, fresque romanesque en vingt volumes dépeignant la société française sous le Second Empire et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart, à travers ses différentes générations et dont chacun des représentants d'une époque et d'une génération particulière fait l'objet d'un roman.
Les dernières années de sa vie sont marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus avec la publication en janvier 1898, dans le quotidien L'Aurore, de l'article intitulé « J'accuse » qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à Londres dans la même année. Zola, l'assommoir, l'incipit romanesque et naturalistele texte :Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à deux heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis huit jours, au sortir du Veau à deux têtes, où ils mangeaient, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du Grand-Balcon, dont les dix fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs ; et, derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à cinq ou six pas, les mains ballantes comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. Quand Gervaise s'éveilla, vers cinq heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et, lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d'une petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté, pour les enfants, un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les deux tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendaient un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de reconnaissances du mont-de-piété, d'un rose tendre. C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les deux enfants dormaient. Claude, qui avait huit ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis qu'Étienne, âgé de quatre ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots, elle tamponna un mouchoir sur sa bouche, pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre, elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. |
l’Assommoir, Emile Zola
→ En quoi cet incipit annonce-t-il un roman naturaliste?
Code couleurs: argument procédé citation
I/ Une héroïne typique du naturalisme
A- Un caractère propre au naturalisme
Gervaise est une héroïne imparfaite, elle n’a pas vraiment le caractère d’une héroïne classique, elle souffre = une souffrance propre aux romans naturalistes. Utilisation du champ lexical de la souffrance: “fiévreuse” “les joues trempées de larmes” “raidie” “les reins brisés” “crise de sanglots” etc.
B- Un personnage passif
Gervaise ne prend pas d’initiatives, elle n’agit pas, elle subit. Utilisation de verbes d’états et de verbes d’actions passives: “avait attendu” “s’était assoupie” “resta assise” “regardait”.
C- Un abandon moral et physique
Gervaise se fait abandonner par Lantier et s’abandonne elle-même, elle s’oublie, se néglige et ne prend plus soin d’elle suite à son désespoir. Utilisation du préfixe privatif pour l’action de Lantier “pour la première fois il découchait” et lexique de “pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées” “toute frissonnante d’être restée en camisole à l’air vif de la fenêtre”.
II/ Un milieu propice à une étude naturaliste
A- Un quartier ancré dans le réel
Le quartier de la Goutte d’Or est un authentique quartier de Paris bien qu’à l’époque faisant parti de la banlieue. Zola a fait de véritables recherches à propos de ce quartier, tel un scientifique. Précision descriptive de la rue, du boulevard, utilisation des noms de rues, boulevard et établissements existants dans la réalité: “boulevard de la Chapelle” “Hôtel Boncoeur” “presque en face d’elle [de l’hôtel] [...] la masse blanche de l’hôpital de Lariboisière”.
B- Un milieu populaire plein de misère reflétant le personnage
Le milieu dans lequel vit Gervaise est populaire et plein de misère. Il est représenté par la chambre qui reflète aussi le personnage. C’est une métonymie: la chambre insalubre partie du quartier et Gervaise habitant dans la chambre. Cette chambre est décrite à l’aide du champ lexical de la misère et du manque. “misérable chambre garnie” “manquait” “graisseuse” “ébréché” “vides” “vieux” “sales” “troué” “mangé par la boue” “nippes” “dépareillés” Cette misère est mise en exergue par une opposition ironique après la description péjorative de la chambre. “C’était la belle chambre de l’hôtel, la chambre du premier”
C- L’observation de Gervaise dans un milieu particulier
Durant le déroulement de l’histoire, on observe le comportement de Gervaise. Le narrateur garde en permanence un oeil sur elle. Souvent, les phrases commencent par un regard sur Gervaise: “Elle regardait à droite [...] où des groupes de bouchers [...] stationnaient” Il y a un parallèle entre le déroulement de l’histoire et les actions de Gervaise.
III/ Des caractériques naturalistes
A- L’effet de réel
Ce roman est ancré dans le réel grâce aux effets de réel du narrateur. Les descriptions longues et précises avec l’utilisation de l’imparfait “ils mangeaient , il l’envoyait se coucher” “reparaissaient” cherchait” et la focalisation interne à travers le regard de Gervaise avec le lexique du regard “elle croyait l’avoir vu” “elle guettait” “elle avait aperçu” sont des effets de réels
B- Une tonalité pathétique
Gervaise est une victime de la pauvreté, on ressent de la pitié envers elle. Ce sentiment provient du lexique de la souffrance, du manque et des dettes “yeux voilés de larmes” “les reins brisés” “déteinte” “flans vides” “reconnaissances du mont-de-piété”.
C- Des thèmes récurrents du naturalisme: la mort et l’alcool
La mort et l’alcool sont des thèmes majeurs de ce roman. On sent une forte présence de la mort avec un lexique tournant autour de la mort: “abattoirs” “tabliers sanglants” “bêtes massacrées” “hôpital”. Il y a également la présence du champ lexical de l’alcool “rouge lie de vin”
Questionnaire sur l'incipit dans le respect des axes du commentaire
- Rappel du plan
- I/ Une héroïne typique du naturalisme
- A- Un caractère propre au naturalisme
- B- Un personnage passif
- C- Un abandon moral et physique
- II/ Un milieu propice à une étude naturaliste
- A- Un quartier encré dans le réel
- B- Un milieu populaire plein de misère reflétant le personnage
- C- L’observation de Gervaise dans un milieu particulier
- III/ Des caractériques naturalistes
- A- L’effet de réel
- B- Une tonalité pathétique
- C- Des thèmes récurrents du naturalisme: la mort et l’alcool
Questionnaire possible sur le passage à présenter à l'oral
*** Les réponses sont dans l'étude proposée
- I -
- A -
- Montrez que Gervaise n'a pas les caractéristiques d'une héroine classique en citant le texte.
- I -
- B -
- Gervaise est-elle un personnage à prendre des initiatives?
- De quelle nature les verbes sont-ils? Montrez en citant les verbes du texte la passivité du personnage
- C -
- En quel sens peut-on parler d'un double abandon?
- Pourquoi peut-on dire que Gervaise s'oublie elle-même?
- Que traduit le préfixe privatif relatif à l'action de Lantier "pour la première fois il découchait"?
- Analysez le champ lexical
- II/
- A-
- Le quartier est-il ancré dans le réel? Cela traduit-il les recherches de Zola au sens scientifique du terme?
- Montrez en citant le texte que les détails concernant les rues, boulevards, quartier.... que l'auteur décrit un endroit authentique ayant ses racines dans la réalité.
- B-
- Le milieu populaire décrit reflète t'-il le personnage?
- Analysez la métonymie. Expliquez et citez le texte.
- Montez les traces d'ironie du texte. Quelle phrase intensifie ce ton ironique?
- C-
- Gervaise échappe t'elle au regard du narrateur? Justifiez votre réponse
- L'histoire se déroule t'-elle en au rythme des actions de Gervaise?
- III -
- A -
- Les caractéristiques naturalistes : Montrez que le roman est ancré dans le réel
- B -
- Quelle tonalité avons-nous?
- C -
- Quels sont les thèmes du naturalisme?
- Retrouvons-nous ces thèmes dans les autres romans de Zola?
*** Travailler l'ouverture
Il est possible de proposer une ouverture en comparant la description métonymique de Gervaise et la chambre et Madame Vauquer avec la pension dans le père Goriot ou encore la casquette avec Charles dans l'incipit de Mme Bovary de Flaubert.
On formule l'ouverture sous forme d'une question :
Retrouve t'-on dans le père Goriot avec Madame Vauquer, une telle description métonymique qui réduit en osmose le personnage et l'objet qui le caractérise? (ici la pension).
"L’ETRANGER" DE CAMUS"
Préparation de la deuxième partie de l'entretien
*** L'oral du bac de français : EAF
Support : L’Etranger de Camus : L’incipit: Du début à « officielle. »
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019