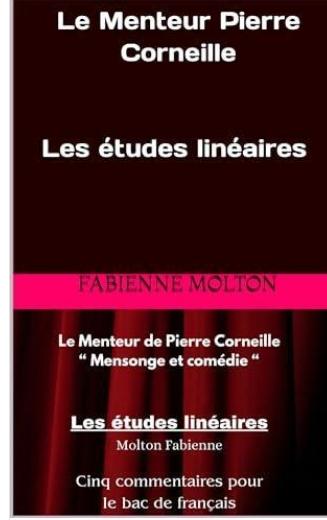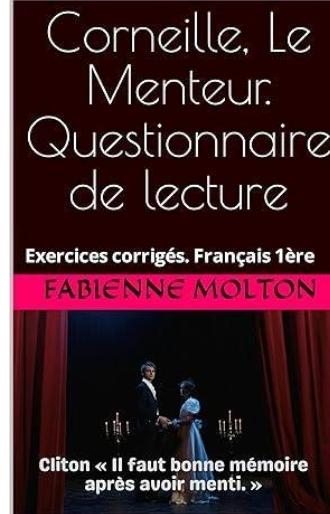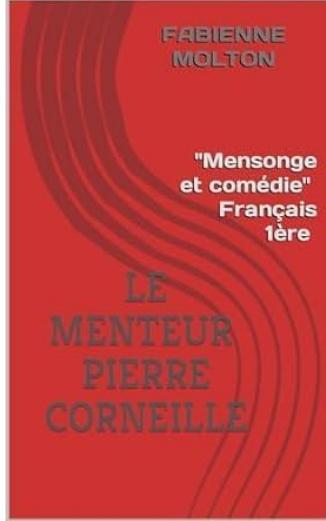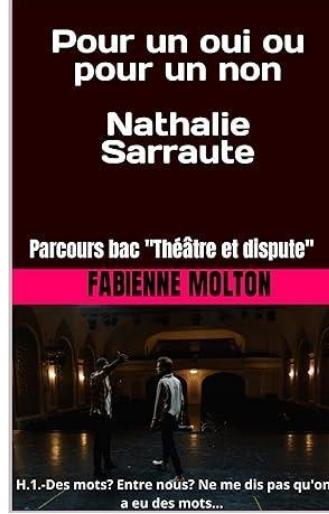Anthologie de textes : la conscience et la philosophie


Anthologie de textes : la Conscience
Descartes (1596-1650), le cogito
Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu’il n’y avait aucune chose qui fût telle qu’ils nous la font imaginer1. Et parce qu’il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matière de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j’étais sujet à faillir, autant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j’avais prises auparavant pour démonstrations2. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous dormons, sans qu’il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m’étaient jamais entrées en l’esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
René Descartes (1596-1650), Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637), quatrième partie.
1. En cette phrase, le doute ne porte pas sur l’existence des choses sensibles, mais sur la conformité des choses et de nos impressions sensibles. La réalité n’est peut-être pas semblable à ce que nous représentent nos sens. Ce doute est le propre de la critique du sensible intérieure à la science, critique que nous avons rencontrée, par exemple, dans les premiers chapitres du Monde. Les choses ne sont pas telles que nos sens nous les font imaginer, mais elles sont. Au reste, si elles n’étaient pas, la question même de leur conformité ou de leur non-conformité avec nos sensations perdrait toute signification. Et c’est cette seule question que pose ici Descartes en écrivant : qui fût telle que. Nous verrons du reste, dans la suite du texte, qu’il s’agit toujours de mettre en doute ou d’affirmer des relations. Descartes est ici occupé de science, non d’ontologie.
2. M. Gilson, s’appuyant sur un cours inédit de Lévy-Bruhl, estime que Descartes cherche ici « le fondement de la certitude des mathématiques elles-mêmes », « passe du plan scientifique au plan proprement philosophique », « substitue à une simple critique de nos connaissances une critique de nos moyens de connaître ». Cela sera vrai des Méditations. Mais le texte du Discours ne permet pas un tel commentaire. Loin de fonder son doute sur la mise en question de la valeur du raisonnement mathématique comme tel, Descartes invoque seulement le « fait » qu’il y a des hommes qui, même en mathématiques, commettent des erreurs. Dès lors, se jugeant sujet à faillir autant qu’un autre, il ne se fie plus à ce qui lui a paru démonstratif. C’est là l’effet d’une prudence qui, pour devenir radicale, ne change pas de plan, et demeure semblable à la prudence du savant qui craint de se tromper.
Descartes (1596-1650), je suis, j’existe
La Méditation que je fis hier m’a rempli l’esprit de tant de doutes, qu’il n’est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant je ne vois pas de quelle façon je les pourrai résoudre ; et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris, que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m’efforcerai néanmoins, et suivrai derechef la même voie où j’étais entré hier, en m’éloignant de tout ce en quoi je pourrai imaginer le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux1 ; et je continuerai toujours dans ce chemin, jusqu’à ce que j’aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu’à ce que j’aie appris certainement, qu’il n’y a rien au monde de certain. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu’un point qui fût fixe et assuré. Ainsi j’aurai droit de concevoir de hautes espérances, si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable2. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses ; je me persuade que rien n’a jamais été3 de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente ; je pense n’avoir aucun sens ; je crois que le corps, la figure, l’étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu’est-ce donc qui pourra être estimé véritable ? Peut-être rien autre chose, sinon qu’il n’y a rien au monde de certain. […] Mais que sais-je s’il n’y a point quelque autre chose différente de celles que je viens de juger incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute ? N’y a-t-il point quelque Dieu, ou quelque autre puissance, qui me met en l’esprit ces pensées ? Cela n’est pas nécessaire ; car peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. Moi donc à tout le moins ne suis-je pas quelque chose ? Mais j’ai déjà nié que j’eusse aucun sens ni aucun corps. J’hésite néanmoins, car que s’ensuit-il de là ? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens, que je ne puisse être sans eux ? Mais je me suis persuadé qu’il n’y avait rien du tout dans le monde, qu’il n’y avait aucun ciel, aucune terre, aucuns esprits, ni aucuns corps ; ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n’étais point ? Non certes, j’étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j’ai pensé quelque chose4. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n’y a donc point de doute que je suis, s’il me trompe ; et qu’il me trompe tant qu’il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu’après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut conclure, et tenir pour constant que cette proposition : Je suis, j’existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit5. Mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis; de sorte que désormais il faut que je prenne soigneusement garde de ne prendre pas imprudemment quelque autre chose pour moi, et ainsi de ne me point méprendre dans cette connaissance, que je soutiens être plus certaine et plus évidente que toutes celles que j’ai eues auparavant. C’est pourquoi je considérerai derechef ce que je croyais être avant que j’entrasse dans ces dernières pensées; et de mes anciennes opinions je retrancherai tout ce qui peut être combattu par les raisons que j’ai tantôt alléguées, en sorte qu’il ne demeure précisément rien que ce qui est entièrement indubitable. […] Je suis, j’existe : cela est certain; mais combien de temps ? A savoir, autant de temps que je pense; car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d’être ou d’exister6. Je n’admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai : je ne suis donc, précisément parlant, qu’une chose qui pense, c’est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m’était auparavant inconnue. Or je suis une chose vraie, et vraiment existante; mais quelle chose ? Je l’ai dit : une chose qui pense.
René Descartes (1596-1650), Méditation seconde (1641), De la nature de l’esprit humain ; et qu’il est plus aisé à connaître que le corps.
--------------------------------------------------------------------------------
1. La formule est plus atténuée que celle du Discours, où il est dit : « Je pensai... qu’il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute. » Le « tout de même que si je connaissais » introduit une nuance différente. La suite dira pourtant : « Je suppose (...) que toutes les choses que je vois sont fausses. »
2. Tout cela marque le caractère provisoire du doute cartésien, et le distingue du doute sceptique.
3. Ces formules indiquent bien que le doute n’est pas ici sélectif, mais ontologique. La question est : « Les choses que je vois existent-elles ? Les choses dont je me souviens ont-elles existé ? »
4. Ou seulement si j’ai pensé quelque chose est ajouté dans la traduction.
5. Il est à remarquer que la formule du Discours : « Je pense donc je suis » n’est pas ici reprise. Descartes atteint d’abord la certitude de son existence, et, par la suite, se demande quelle est la nature, ou l’essence, de ce moi qui existe : toute la Méditation seconde procédera à cette épuration, et aboutira à la conclusion : je suis une pensée, et seulement cela (ou, plus exactement : la seule chose dont je sois certain, c’est d’être une pensée). Il y a bien, en ce sens, au point de départ, une expérience ontologique du moi comme existant (ego sum, ego exista, dit le texte latin). Cette expérience nous place fort loin des interprétations idéalistes, qui voudraient voir Descartes partir de la pensée en général, ou du sujet proprement connaissant. Il convient d’ajouter cependant que le texte qui précède l’affirmation « Je suis » établit implicitement le « Je pense » à titre de condition, encore obscurément aperçue, de ce « Je suis » (ainsi : j’étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j’ai pensé quelque chose).
6. Au lieu de faire du temps une hypothèse, Descartes place résolument le moi dans le temps. On aperçoit, de toute façon, que le cogito cartésien ne nous révèle pas un sujet dont la connaissance aurait pour forme le temps, mais un être dans le temps, dont la certitude se limite à un instant considéré lui-même comme l’instant d’un temps réel, à un instant défini par rapport à un passé et à un futur objectifs.
Locke (1632-1704), l’identité personnelle
§ 17. Le soi dépend de la conscience. Soi est cette chose qui pense consciente (de quelque substance, spirituelle ou matérielle, simple ou composée, qu’elle soit faite, peu importe) qui est sensible, ou consciente du plaisir et de la douleur, capable de bonheur et de malheur, et qui dès lors se soucie de soi dans toute la mesure où s’étend cette conscience. Chacun trouve ainsi que son petit doigt, tant qu’il entre dans cette conscience, est une partie de soi autant que ce qui lui est le plus essentiel. Ce petit doigt étant amputé, si la conscience s’en allait avec lui et se séparait du reste du corps, il est clair que c’est le petit doigt qui serait la personne, la même personne ; et soi n’aurait alors rien à voir avec le reste du corps. De même que dans ce cas c’est la conscience qui accompagne la substance, lorsqu’une partie est séparée d’une autre, qui fait la même personne, et constitue ce soi indivisible, de même en va-t-il par rapport à des substances éloignées dans le temps. Celle avec qui peut se joindre la conscience de la chose pensante actuelle fait la même personne, elle forme un seul soi avec elle, et avec rien d’autre ; elle s’attribue ainsi et avoue toutes les actions de cette chose, qui n’appartiennent qu’à elle seule aussi loin que s’étend cette conscience (mais pas plus loin), comme le comprendra quiconque y pensera.
§ 18. Objet de récompense et de châtiment. C’est dans cette identité personnelle que se fondent tout le droit et toute la justice de la récompense et du châtiment, c’est-à-dire du bonheur et du malheur dont chacun se soucie pour lui-même, indépendamment de ce qui peut advenir à toute substance qui ne serait pas unie à cette conscience, ou affectée en même temps qu’elle. Car, comme il apparaissait clairement dans l’exemple que je donnais à l’instant, si la conscience s’en allait avec le petit doigt quand il a été coupé, ce serait le même soi qui hier se souciait du corps tout entier et le considérait comme faisant partie de soi, et dont il lui faudrait bien admettre alors que les actions sont maintenant les siennes. Tandis que si le même corps étant toujours en vie acquérait sa propre conscience aussitôt après la séparation du petit doigt, dont celui-ci ne saurait rien, il ne s’en soucierait plus, ne verrait pas en lui une partie de soi, ne pourrait faire siennes aucune de ses actions ni se les voir imputer.
§ 19. Ceci peut nous faire voir en quoi consiste l’identité personnelle : non dans l’identité de substance mais, comme je l’ai dit, dans l’identité de conscience, en sorte que si Socrate et l’actuel maire de Quinborough en conviennent, ils sont la même personne, tandis que si le même Socrate éveillé et endormi ne partagent pas la même conscience, Socrate éveillé et Socrate dormant n’est pas la même personne. Et punir Socrate l’éveillé pour ce que Socrate le dormant a pu penser, et dont Socrate l’éveillé n’a jamais eu conscience, ne serait pas plus juste que de punir un jumeau pour les actes de son frère jumeau et dont il n’a rien su, sous prétexte que leur forme extérieure est si semblable qu’ils sont indiscernables (or on a vu de tels jumeaux).
John Locke (1632-1704), Essai philosophique concernant l’entendement humain (1690-1694), II, XXVII.
Kant (1724-1804), conscience de soi et identité de soi
§ 16. — De l’unité ordinairement synthétique de l’aperception.
Le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes représentations; car autrement il y aurait en moi quelque chose de représenté, qui ne pourrait pas être pensé, ce qui revient à dire ou que la représentation serait impossible, ou du moins qu’elle ne serait rien pour moi. La représentation qui peut être donnée antérieurement à toute pensée se nomme intuition. Toute diversité d’éléments de l’intuition a donc un rapport nécessaire au je pense. Mais cette représentation [ : je pense] est un acte de la spontanéité, c’est-à-dire qu’on ne saurait la regarder comme appartenant à la sensibilité. Je la nomme aperception pure pour la distinguer de l’aperception empirique, ou encore aperception originaire, parce que cette conscience de soi-même qui, en produisant la représentation je pense, doit pouvoir accompagner toutes les autres et qui est une et identique en toute conscience, ne peut plus être elle-même accompagnée d’aucune autre. Je désigne encore l’unité de cette représentation sous le nom d’unité transcendantale de la conscience de soi, pour indiquer la possibilité de la connaissance a priori qui en dérive. En effet, les représentations diverses, données dans une certaine intuition, ne seraient pas toutes ensemble mes représentations, si toutes ensemble n’appartenaient à une conscience de soi.
§17. — Le principe de l’unité synthétique de l’aperception est le principe suprême de tout usage de l’entendement.
[…]L’unité synthétique de la conscience est donc une condition objective de toute connaissance ; non seulement j’en ai besoin pour connaître un objet, mais aucune intuition ne peut devenir un objet pour moi que sous cette condition; autrement, sans cette synthèse, le divers ne s’unirait pas en une conscience.
Cette dernière proposition est même, comme il a été dit, analytique, quoiqu’elle fasse de l’unité synthétique la condition de toute pensée. En effet, elle n’exprime rien autre chose sinon que toutes mes représentations, dans quelque intuition que ce soit, sont nécessairement soumises à la seule condition qui me permette de les attribuer, comme représentations miennes, à un moi identique, et en les unissant ainsi synthétiquement dans une seule aperception, de les embrasser sous l’expression générale : je pense. […]
Emmanuel Kant (1724-1804), Critique de la raison pure (1787), analytique des concepts chapitre II.
Hegel (1770-1831), la dialectique du maître et de l’esclave
Le Maître force l’Esclave à travailler. Et en travaillant, l’Esclave devient maître de la Nature. Or, il n’est devenu l’Esclave du Maître que parce que — au prime abord — il était esclave de la Nature, en se solidarisant avec elle et en se subordonnant à ses lois par l’acceptation de l’instinct de conservation. En devenant par le travail maître de la Nature, l’Esclave se libère donc de sa propre nature, de son propre instinct qui le liait à la Nature et qui faisait de lui l’Esclave du Maître. En libérant l’Esclave de la Nature, le travail le libère donc aussi de lui-même, de sa nature d’Esclave : il se libère du Maître. Dans le Monde naturel donné, brut, l’Esclave est esclave du Maître. Dans le monde technique, transformé par son travail, il règne — ou, du moins, régnera un jour — en Maître absolu. Et cette Maîtrise qui naît du travail, de la transformation progressive du Monde donné et de l’homme donné dans ce Monde, sera tout autre chose que la Maîtrise « immédiate » du Maître. L’avenir et l’Histoire appartiennent donc non pas au Maître guerrier, qui ou bien meurt ou bien se maintient indéfiniment dans l’identité avec soi-même, mais à l’Esclave travailleur. Celui-ci, en transformant le Monde donné par son travail, transcende le donné et ce qui est déterminé en lui-même par ce donné ; il se dépasse donc, en dépassant aussi le Maître qui est lié au donné qu’il laisse — ne travaillant pas — intact. Si l’angoisse de la mort incarnée pour l’Esclave dans la personne du Maître guerrier est la condition sine qua non du progrès historique, c’est uniquement le travail de l’Esclave qui le réalise et le parfait.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), La Phénoménologie de l'esprit (1807).
Marx (1818-1883), conception matérialiste de la conscience
Force nous est de constater d’emblée que la première condition de toute existence humaine, donc de toute histoire, c’est que les hommes doivent être en mesure de vivre pour être capables de faire l’histoire. Or, pour vivre, il faut avant tout manger et boire, se loger, se vêtir et maintes choses encore. Le premier acte historique, c’est donc la création des moyens pour satisfaire ces besoins, la production de la vie matérielle elle-même. En vérité, c’est là un acte historique, une condition fondamentale de toute histoire que l’on doit, aujourd’hui tout comme il y a des milliers d’années, remplir jour par jour, heure par heure, rien que pour maintenir les hommes en vie. Même si l’on réduit [...] la réalité sensible à un simple bâton, au strict minimum, cette réalité suppose l’activité qui produit ce bâton. La première règle de toute conception historique, c’est donc d’observer ce fait fondamental dans toute son importance et toute son étendue, et de lui faire droit. [...]
La deuxième condition préalable, c’est que, une fois satisfait le premier besoin lui-même, le geste de le satisfaire et l’instrument créé à cette fin conduisent à de nouveaux besoins – et c’est cette production de nouveaux besoins qui constitue le premier acte historique. [...]
La troisième relation qui intervient ici dès l’origine dans le développement historique est que les hommes, tout en renouvelant quotidiennement leur propre vie, commencent à créer d’autres hommes, à se reproduire – c’est la relation entre l’homme et la femme, entre parents et enfants, c’est la famille. Dès l’abord seul rapport social, cette famille devient plus tard une institution de second ordre (excepté en Allemagne), quand la multiplication des besoins crée de nouvelles relations sociales et que l’accroissement de la population engendre de nouveaux besoins. Il faut alors l’aborder et l’analyser sur la base des données empiriques existantes et non d’après le « concept de famille », comme on le fait habituellement en Allemagne. D’ailleurs, ces trois aspects de l’activité sociale ne doivent pas être conçus comme trois stades différents, mais précisément comme trois aspects et rien d’autre ou pour être compris des Allemands, trois Moments, trois facteurs, qui ont existé, simultanément depuis les débuts de l’histoire et l’apparition des premiers hommes et qui, aujourd’hui encore, jouent un rôle dans l’histoire.
La production de la vie, qu’il s’agisse de sa propre vie par le travail ou de la vie d’autrui par la procréation, apparaît donc dès à présent comme une relation double, tant naturelle que sociale ; sociale, en ce qu’il est question de la coopération de plusieurs individus, peu importe dans quelles conditions, de quelle manière et à quelle fin. Il en résulte qu’un mode de production ou un stade industriel déterminé est toujours lié à un mode déterminé de coopération ou à un stade social bien défini, et ce mode de coopération est lui-même une « force productive » ; que la quantité de forces productives accessibles aux hommes détermine l’état social, de sorte que « l’histoire de l’humanité » doit être étudiée et traitée en liaison avec l’histoire de l’industrie et du commerce. Mais il est non moins clair qu’en Allemagne, une historiographie de ce genre est impossible, car non seulement la compréhension et les matériaux, mais aussi la « certitude sensible » font défaut aux Allemands, et que, de l’autre côté du Rhin, on ne peut faire des expériences sur ces choses, puisque l’histoire s’y est arrêtée. Par conséquent, on constate, avant toute chose, un lien matérialiste des hommes entre eux, un lien déterminé par les besoins et le mode de production, et qui est aussi vieux que les hommes eux-mêmes – un lien qui adopte sans cesse de nouvelles formes et offre donc une « histoire », même sans qu’il existe un non-sens politique ou religieux d’aucune espèce qui serve spécialement à rapprocher les hommes.
C’est à présent seulement, après avoir examiné quatre éléments, quatre aspects des rapports historiques primitifs, que nous apprenons que l’homme possède également une « conscience ». Encore ne s’agit-il pas là, dès l’origine, de conscience « pure ». Dès l’origine, l’« esprit » est frappé par la malédiction d’être « entaché » de la matière, qui emprunte ici la forme de couches d’air agitées, de sons, bref la forme du langage. Le langage est aussi vieux que la conscience – il est la conscience réelle, pratique, aussi présente pour les autres hommes que pour moi-même, et, comme la conscience, le langage naît du seul besoin, de la nécessité du commerce avec d’autres hommes. Là où il y a relation, elle existe pour moi, alors que l’animal ne se « rapporte » à rien et n’a absolument aucune relation. Pour l’animal, ses rapports avec les autres animaux n’existent pas en tant que rapports. La conscience est donc, dès l’origine, un produit social et le demeure aussi longtemps qu’il existe des hommes, tout simplement. Naturellement, la conscience n’est d’abord que la conscience du milieu sensible immédiat, et celle du lien borné qui le rattache à d’autres personnes et choses extérieures à l’individu qui prend conscience de lui-même. C’est, en même temps, la conscience de la nature qui, au début, s’oppose aux hommes comme une puissance totalement étrangère, toute-puissante et inébranlable, envers laquelle ils ont un comportement purement animal et dont ils subissent l’ascendant comme s’ils étaient du bétail. Bref, c’est une conscience purement animale de la nature (religion de la nature), mais aussi la conscience de la nécessité d’entrer en communication avec d’autres individus alentour : l’homme commence à avoir conscience qu’il vit tout simplement dans une société. Ce début est aussi animal que l’est, à ce stade, la vie sociale elle-même ; c’est une pure conscience grégaire, et l’homme ne se distingue ici du mouton qu’en ce que sa conscience lui tient lieu d’instinct ou que son instinct est un instinct conscient. Cette conscience moutonnière ou tribale continue à se développer et à se former grâce à l’accroissement de la productivité, à la multiplication des besoins et à l’augmentation de la population, source du premier et de la seconde. Simultanément se développe la division du travail qui ne se manifestait primitivement que dans les rapports des sexes ; puis la division du travail qui résulte automatiquement ou « spontanément » des dispositions naturelles (vigueur physique, par exemple), des besoins, des hasards, etc. La division du travail n’acquiert son vrai caractère qu’à partir du moment où intervient la division du travail matériel et du travail intellectuel. Dès cet instant, la conscience peut vraiment s’imaginer qu’elle est autre chose que la conscience de la pratique établie et qu’elle représente réellement quelque chose sans représenter quelque chose de réel : à partir de ce moment, la conscience est capable de s’émanciper du monde et de passer à la formation de la théorie « pure », théologie, philosophie, morale, etc. Mais lors même que cette théorie, cette théologie, cette philosophie, cette morale, etc. entrent en conflit avec les conditions existantes, ce heurt ne peut se produire que parce que les conditions sociales existantes sont entrées en conflit avec la force productive existante. Cela peut d’ailleurs arriver dans un cadre national bien déterminé, quand le conflit surgit non pas dans ce contexte national, mais entre cette conscience nationale et la pratique des autres nations, c’est-à-dire entre la conscience nationale et la conscience universelle (comme c’est présentement le cas en Allemagne), et pour cette nation alors, parce qu’apparemment cette contradiction ne se présente que comme contradiction au sein de la conscience nationale, la lutte semble se limiter à cette ordure nationale, précisément parce que cette nation est la pourriture en soi. Au demeurant, ce que la conscience entreprend tout simplement n’a strictement aucune importance. De tout ce bourbier, nous retiendrons uniquement le fait que ces trois éléments, la force productive, l’état social et la conscience, peuvent et doivent entrer en conflit, étant donné qu’avec la division du travail, il peut arriver, et il arrive en fait, que l’activité spirituelle et l’activité matérielle, que la jouissance et le travail, que la production et la consommation échoient à des individus différents. La seule possibilité d’éviter ce conflit consiste, une fois de plus, à abolir la division du travail. Il va de soi, au demeurant, que les « fantômes », les « chaînes », l’« être supérieur », le « concept », l’« ambiguïté » sont tout simplement l’expression idéaliste, spéculative et sacrée, la représentation, apparemment, de l’individu esseulé, la représentation de chaînes et de barrières fort empiriques, à l’intérieur desquelles le mode de production de la vie gravite avec sa forme de commerce.
Husserl (1859-1938), l’intentionnalité de la conscience
Nous allons donc diriger la lumière de l’évidence transcendantale non plus sur l’ego cogito – ce terme est pris au sens cartésien le plus large, – mais sur les cogitationes multiples, c’est-à-dire sur le courant de la conscience qui forme la vie de ce moi (mon moi, le moi du sujet méditant). Le moi identique peut à tout moment porter son regard réflexif sur cette vie, qu’elle soit perception ou représentation, jugement d’existence, de valeur, ou volition. Il peut à tout moment l’observer, en expliciter et en décrire le contenu. (...) La perception de cette table est, avant comme après, perception de cette table. Ainsi, tout état de conscience en général est, en lui-même conscience de quelque chose, quoi qu’il en soit de l’existence réelle de cet objet et quelque abstention que je fasse, dans l’attitude transcendantale qui est mienne, de la position de cette existence et de tous les actes de l’attitude naturelle. Par conséquent, il faudra élargir le contenu de l’ego cogito transcendantal, lui ajouter un élément nouveau et dire que tout cogito ou encore tout état de conscience « vise » quelque chose, et qu’il porte en lui-même, en tant que « visé » (en tant qu’objet d’une intention) son cogitatum respectif. Chaque cogito, du reste, le fait à sa manière. La perception de la « maison » « vise » (se rapporte à) une maison ou plus exactement, telle maison individuelle de la manière perceptive : le souvenir de la maison « vise » la maison comme souvenir ; l’imagination, comme image ; un jugement prédicatif ayant pour objet la maison « placée là devant moi » la vise de la façon propre au jugement prédicatif ; un jugement de valeur surajouté la viserait encore à sa manière. Et ainsi de suite […]
Ces états de conscience sont aussi appelés états intentionnels. Le mot intentionnalité ne signifie rien d’autre que cette particularité foncière et générale qu’a la conscience d’être conscience de quelque chose, de porter, en sa qualité de cogito son cogitatum en elle-même ».
Edmund Husserl (1859-1938), Méditations cartésiennes (1929).
A consulter
-
Camus, les Justes
- Le 10/07/2012
- Dans Fiches de lecture français
- 0 commentaire

Camus, les Justes : analyse de l'oeuvre
-
Camus, de l'Etranger à la Peste
- Le 10/07/2012
- Dans Fiches de lecture français
- 0 commentaire

Camus, de l'Etranger à la Peste. Dossier bac.
-
Les héros camusiens, la Chute, l'Etranger, l'Homme révolté, Malentendu
- Le 10/07/2012
- Dans Fiches de lecture français
- 0 commentaire

Héros camusiens, L'Etranger, la Chute, l'homme révolté, le Malentendu
-
Camus, L'Etranger, La mort Heureuse
- Le 10/07/2012
- Dans Fiches de lecture français
- 0 commentaire

portrait de deux héros camusiens : Meursault et Mersault.
Date de dernière mise à jour : 29/04/2021