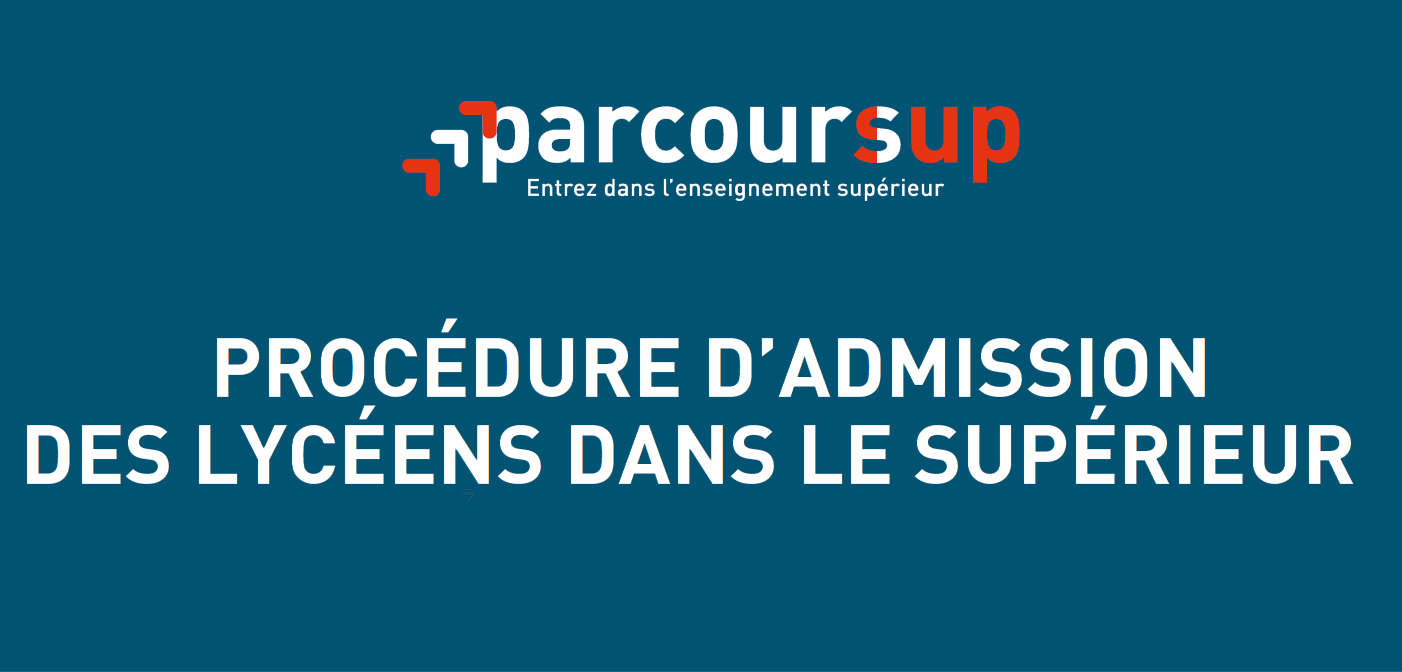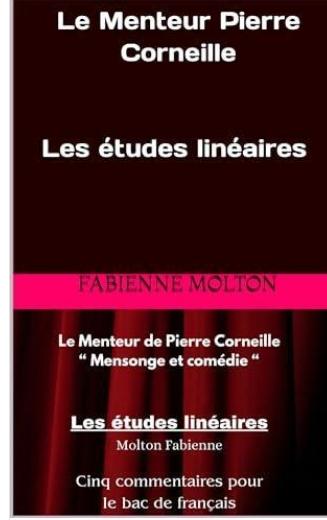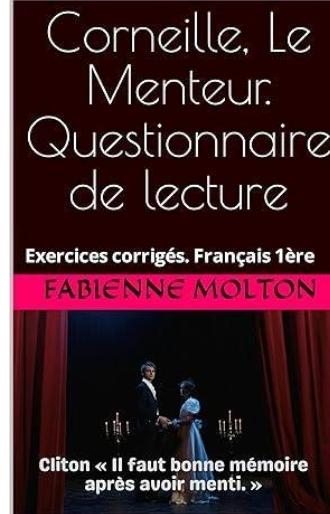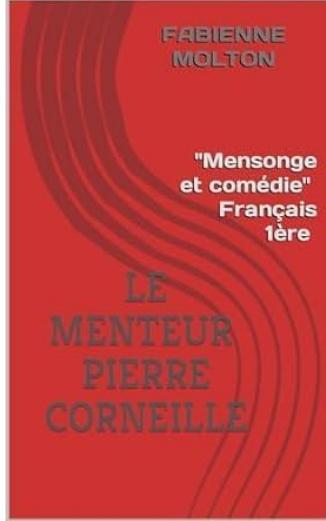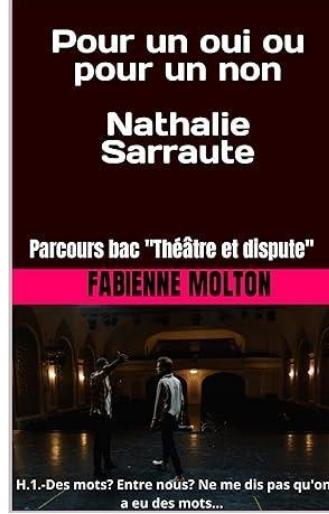Textes de référence sur les thèmes, liberté et devoir


Quelques textes de référence sur le thème de la liberté/devoir en philosophie
« S’il doit donc y avoir un principe pratique suprême et, vis-à-vis de la volonté humaine, un impératif catégorique, il faut que ce soit quelque chose de tel qu’à partir de la représentation de ce qui est nécessairement un fin pour chacun (parce que c’est une fin en soi), il définisse un principe objectif de la volonté, que par conséquent il puisse servir de loi pratique universelle. Le fondement de ce principe est celui-ci : la nature raisonnable existe comme fin en soi. C’est ainsi que l’homme se représente nécessairement sa propre existence ; dans cette mesure il s’agit donc d’un principe subjectif d’actions humaines. Mais tout autre être raisonnable se représente également de cette façon son existence, cela précisément en conséquence du même principe rationnel qui vaut aussi pour moi ; il s’agit donc en même temps d’un principe objectif à partir duquel doivent pouvoir être déduites, comme un principe pratique suprême, toutes les lois de la volonté. L’impératif pratique sera donc le suivant : agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme fin jamais simplement comme moyen. » (Kant – Fondements de la Métaphysique des Mœurs – Deuxième Section).
« En fait, il est absolument impossible d’établir par expérience avec une entière certitude un seul cas où la maxime d’une action d’ailleurs conforme au devoir ait uniquement reposé sur des principes moraux et sur la représentation du devoir. Car il arrive parfois sans doute qu’avec le plus scrupuleux examen de nous-mêmes nous ne trouvons absolument rien qui, en dehors du principe moral du devoir, ait pu être assez puissant pour nous pousser à telle ou telle bonne action et à tel grand sacrifice ; mais de là on ne peut nullement conclure avec certitude que réellement ce ne soit point une secrète impulsion de l’amour-propre qui, sous le simple mirage de cette idée, ait été la vraie cause déterminante de la volonté ; c’est que nous nous flattons volontiers en nous attribuant faussement un principe de détermination plus noble ; mais en réalité nous ne pouvons jamais, même par l’examen le plus rigoureux, pénétrer entièrement jusqu’aux mobiles secrets ; or, quand il s’agit de valeur morale, l’essentiel n’est point dans les actions, que l’on voit, mais dans ces principes intérieurs des actions, que l’on ne voit pas. » (Kant – Fondements de la métaphysique des mœurs)
« Ceci nous permet de comprendre ce que recouvrent des mots un peu grandiloquents comme angoisse, délaissement, désespoir. Comme vous allez voir, c’est extrêmement simple. D’abord, qu’entend-on par angoisse ? L’existentialiste déclare volontiers que l’homme est angoisse. Cela signifie ceci : l’homme qui s’engage et qui se rend compte qu’il est non seulement celui qu’il choisit d’être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soi l’humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. Certes, beaucoup de gens ne sont pas anxieux ; mais nous prétendons qu’ils se masquent leur angoisse, qu’ils la fuient ; certainement, beaucoup de gens croient en agissant n’engager qu’eux-mêmes, et lorsqu’on leur dit : mais si tout le monde faisait comme ça ? ils haussent les épaules et répondent : tout le monde ne fait pas comme ça. Mais en vérité, on doit toujours se demander : qu’arriverait-il si tout le monde en faisait autant ? et on n’échappe à cette pensée inquiétante que par une sorte de mauvaise foi. Celui qui ment et qui s’excuse en déclarant : tout le monde ne fait pas comme ça, est quelqu’un qui est mal à l’aise avec sa conscience, car le fait de mentir implique une valeur universelle attribuée au mensonge. » (Sartre – L’existentialisme est un humanisme)
« Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelque lieu de disputer sur cette différence de l’homme et de l’animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c’est la faculté de se perfectionner ; faculté qui, à l’aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’individu, au lieu qu’un animal est, au bout de quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu’elle était la première année de ces mille ans. Pourquoi l’homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête, qui n’a rien acquis et qui n’ rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l’homme reperdant par la vieillesse ou d’autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ? Il serait triste pour nous d’être forcé de convenir, que cette faculté distinctive, et presque illimitée, est la source de tous les malheurs de l’homme ; que c’est elle qui le tire, à force de temps, de cette condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents ; que c’est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature. » (Rousseau – Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes)
« Il n’y a que la seule volonté, que j’expérimente en moi être si grande, que je ne conçois point l’idée d’aucune autre plus ample et plus étendue : en sorte que c’est elle principalement qui me fait connaître que je porte l’image et la ressemblance de Dieu. Car, encore qu’elle soit incomparablement plus grande dans Dieu, que dans moi, soit à raison de la connaissance et de la puissance, qui s’y trouvant jointes la rendent plus ferme et plus efficace, soit à raison de l’objet, d’autant qu’elle se porte et s’étend infiniment à plus de choses ; elle ne me semble pas toutefois plus grande, si je la considère formellement et précisément en elle-même. Car elle consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose, ou ne la faire pas (c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir), ou plutôt seulement en ce que, pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l’entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu’aucune force extérieure nous y contraigne. Car, afin que je sois libre, il n’est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l’un ou l’autre des deux contraires ; mais plutôt, d’autant plus que je penche vers l’un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s’y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l’intérieur de ma pensée, d’autant plus librement j’en fais choix et je l’embrasse. » (Descartes – Méditations Métaphysiques)
La critique de la liberté d’indifférence peut être illustrée par l’histoire de l’âne de Buridan (exemple emprunté au philosophe médiéval Jean Buridan (vers 1300-1366) pour illustrer la théorie de la liberté d'indifférence) : Un âne, ayant également faim et soif et placé à égale distance d'une botte de foin et d'un seau d'eau, ainsi placé dans l'incapacité de choisir entre l'une et l'autre, se laisserait mourir.
« La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu’un aussi grand nombre d’hommes préfèrent rester mineurs leur vie durant, longtemps après que la nature les a affranchis de toute direction étrangère ; et ces mêmes causes font qu’ils devient si facile à d’autres de se prétendre leurs tuteurs. Il est si aisé d’être mineur ! Avec un livre qui tient lieu d’entendement, un directeur de conscience qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge pour moi de mon régime, etc… je n’ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine. Il ne m’est pas nécessaire de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront bien pour moi de cette ennuyeuse (…).
Dans ce qu’il lui incombe de savoir, un homme peut bien, pour lui-même, et encore seulement pour quelque temps, ajourner l’accession aux Lumières ; mais y renoncer pour lui-même, ou, pire, pour la postérité, cela s’appelle violer les droits sacré de l’humanité et les fouler aux pieds. » (Kant – Qu’est-ce que les Lumières ?)
« Partout où l’on a cherché des responsabilités, c’est l’instinct de la vengeance qui les a cherchées. Cet instinct de la vengeance s’est tellement emparé de l’humanité, au cours des siècles, que toute la métaphysique, psychologie, l’histoire et surtout la morale en portent l’empreinte. (…). Toute la théorie du vouloir, cette funeste falsification de toute la psychologie antérieure, a été inventée essentiellement pour des fins de châtiment. C’est l’utilité sociale du châtiment qui garantissait à cette notion sa dignité, sa puissance, sa vérité. » (Nietzsche – Volonté de Puissance)
« Il n’y a pas pour cet intellect une mission plus vaste qui dépasserait la vie humaine. Il n’est qu’humain et il n’y a que son possesseur et producteur pour le prendre aussi pathétiquement que si les pivots du monde tournaient en lui. Mais si nous pouvions nous entendre avec la mouche, nous conviendrions qu’elle aussi évolue dans l’air avec le même pathos et sent voler en elle le centre de ce monde. (…)
Cet orgueil lié au connaître et au sentir, bandeau de nuée posé sur les yeux et les sens des hommes, leur fait illusion quant à la valeur de l’existence en portant lui-même sur le connaître l’appréciation la plus flatteuse. Son effet le plus général est l’illusion, mais aussi les effets les plus particuliers portent en eux quelque chose du même caractère. (…)
En tant qu’il est un moyen de conservation pour l’individu, l’intellect développe ses forces principales dans la dissimulation ; celle-ci est en effet le moyen par lequel les individus plus faibles, moins robustes, subsistent en tant que ceux à qui il est refusé de mener une lutte pour l’existence avec des cornes ou avec la mâchoire aiguë d’une bête de proie. Chez l’homme cet art de la dissimulation atteint son sommet : l’illusion, la flatterie, le mensonge et la tromperie, les commérages, les airs d’importance, le lustre d’emprunt, le port du masque, le voile de la convention, la comédie pour les autres et pour soi-même, bref le cirque perpétuel de la flatterie pour une flambée de vanité, y sont tellement la règle et la loi que presque rien n’est plus inconcevable que l’avènement d’un honnête et pur instinct de vérité parmi les hommes. (…)
Dans la mesure où, face aux autres individus, l’individu veut se conserver, c’est le plus souvent seulement pour la dissimulation qu’il utilise l’intellect dans un état naturel des choses : mais comme l’homme, à la fois par nécessité et par ennui, veut exister socialement et grégairement, il a besoin de conclure la paix et cherche, conformément à cela, à ce qu’au moins disparaisse de son monde le plus grossier bellum omnium contra omnes[1]. Cette conclusion de paix apporte avec elle quelque chose qui ressemble au premier pas en vue de l’invention de cet énigmatique instinct de vérité. C’est-à-dire qu’est maintenant fixé ce qui désormais doit être « vérité », ce qui veut dire qu’on a trouvé une désignation des choses uniformément valable et obligatoire, et la législation du langage donne même les premières lois de la vérité : car naît ici pour la première fois le contraste de la vérité et du mensonge. Les hommes ne fuient pas tellement le fait d’être trompé que le fait de subir un dommage par la tromperie : au fond, à ce niveau, ils ne haïssent donc pas l’illusion, mais les conséquences fâcheuses et hostiles de certaines sortes d’illusions. C’est dans un sens aussi restreint que l’homme veut seulement la vérité : il convoite les suites agréables de la vérité, celles qui conservent la vie ; envers la connaissance pure et sans conséquence il est indifférent, envers les vérités préjudiciables et destructrices il est même hostilement disposé. (…)
Qu’est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement haussées, transposées, ornées et qui, après un long usage, semblent à un peuple fermes, canoniales et contraignantes : les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible (…).
Nous ne savons toujours pas encore d’où vient l’instinct de vérité : car jusqu’à présent nous n’avons entendu parler que de l’obligation qu’impose la société pour exister : être véridique, c’est-à-dire employer les métaphores usuelles ; donc, en termes de morale, nous avons entendu parler de l’obligation de mentir selon une convention ferme, de mentir grégairement dans un style contraignant pour tous. L’homme oublie assurément qu’il en est ainsi en ce qui le concerne ; il ment donc inconsciemment de la manière désignée et selon des coutumes centenaires – et, précisément grâce à cette inconscience et à cet oubli, il parvient au sentiment de la vérité. Sur ce sentiment d’être obligé de désigner une chose comme « rouge », une autre comme « froide », une troisième comme « muette », s’éveille une tendance morale à la vérité : par le contraste du menteur en qui personne n’a confiance, que tous excluent, l’homme se démontre à lui-même ce que la vérité a d’honorable, de confiant et d’utile. (….) Tout ce qui distingue l’homme de l’animal dépend de cette capacité de faire se volatiliser les métaphores intuitives en un schème, donc de dissoudre une image dans un concept. Dans le domaine de ces schèmes est possible quelque chose qui jamais ne pourrait réussir au milieu des premières impressions intuitives : construire un ordre pyramidal selon des castes et des degrés, créer un monde nouveau de lois, de privilèges, de subordinations, de délimitations, monde qui s’oppose désormais à l’autre monde, celui des premières impressions, comme étant ce qu’il y a de plus ferme, de plus général, de plus connu, de plus humain, et, de ce fait, comme ce qui est régulateur et impératif. » (Nietzsche – Introduction théorétique à la vérité et au mensonge au sens extra-moral).
« Nous n'accusons pas la nature d'immoralité quand elle nous envoie un orage et nous trempe: pourquoi disons-nous donc immoral l'homme qui fait quelque chose de mal? Parce que nous supposons ici une volonté libre aux décrets arbitraires, là une nécessité. Mais cette distinction est une erreur. En outre, ce n'est même pas en toutes circonstances que nous appelons immorale une action intentionnellement nuisible; on tue par exemple une mouche délibérément, mais sans le moindre scrupule, pour la pure et simple raison que son bourdonnement nous déplaît, on punit et fait intentionnellement souffrir le criminel afin de se protéger, soi et la société. Dans le premier cas, c'est l'individu qui, pour se conserver ou même pour s'éviter un déplaisir, cause intentionnellement un mal; dans le second, c'est l'État. Toute morale admet les actes intentionnellement nuisibles en cas de légitime défense, c'est-à-dire quand il s'agit de conservation. Mais ces deux points de vue suffisent à expliquer toutes les mauvaises actions exercées par des hommes sur les hommes: on veut son plaisir, on veut s'éviter le déplaisir; en quelque sens que ce soit, il s'agit toujours de sa propre conservation. Socrate et Platon ont bien raison : quoi que l'homme fasse, il fait toujours le bien, c'est-à-dire ce qui lui semble bon (utile) suivant son degré d'intelligence, son niveau actuel de raison. » (Nietzsche – Humain trop humain)
« 1.
Elever un animal qui puisse promettre n’est-ce pas là cette tache paradoxale que la nature s’est données à propos de l’homme ? N’est-ce pas là le problème véritable de l’homme ?... Que ce problème soit résolu dans une large mesure, voilà qui ne laissera pas d’étonner celui qui sait bien quelle force s’y oppose : la force de l’oubli. L’oubli n’est pas une simple vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels, c’est bien plutôt une faculté d’inhibition active, une faculté positive dans toute la force du terme ; grâce à lui toutes nos expériences, tout ce que nous ne faisons que vivre, qu’absorber, ne devient pas plus conscient, pendant que nous le digérons (ce qu’on pourrait appeler assimilation psychique), que le processus multiple de la nutrition physique qui est une assimilation par le corps. (…) : on voit aussitôt pourquoi sans oubli il ne pourrait y avoir ni bonheur, ni sérénité, ni espoir, ni fierté, ni présent. (…) Eh bien cet animal nécessairement oublieux, pour qui l’oubli représente une force, la condition d’une santé robuste, a fini par acquérir une faculté contraire, la mémoire, à l’aide de laquelle, dans des cas déterminés, l’oubli est suspendu – à savoir dans les cas où il s’agit de promettre : il ne s’agit nullement là de l’impossibilité purement passive de se délivrer d’une impression du passé, nullement d’une indigestion causée par une parole donnée, dont on n’arrive pas à se débarrasser, mais bien d’une volonté active de ne pas se délivrer, d’une volonté qui persiste à vouloir ce qu’elle a une fois voulu, à proprement parler d’une mémoire de la volonté : si bien qu’entre le « je veux », le « je ferai » initial et cette véritable décharge de la volonté qu’est l’accomplissement de l’acte, tout un monde de choses nouvelles ou étrangères, de faits et même d’actes volontaires peut très bien s’intercaler sans rompre la longue chaîne de la volonté. Mais que de conditions cela n’exige-t-il pas ! Pour pouvoir à ce point disposer à l’avance de l’avenir, combien l’homme a-t-il dû d’abord apprendre à séparer le nécessaire du contingent, à penser sous le rapport de la causalité, à voir le lointain comme s’il était présent et à l’anticiper, à voir avec certitude ce qui est but et ce qui est moyen pour l’atteindre, à calculer et à prévoir – combien l’homme lui-même a-t-il dû d’abord devenir prévisible, régulier, nécessaire y compris dans la représentation qu’il se fait de lui-même, pour pouvoir finalement, comme le fait quelqu’un qui promet, répondre de lui-même comme avenir.
2.
Voilà donc la longue histoire des origines de la responsabilité. La tâche d’élever un animal qui puisse promettre, suppose, comme nous l’avons déjà compris, qu’une autre tâche a été accomplie au préalable, celle de rendre l’homme jusqu’à un certain point uniforme, égal parmi les égaux, régulier, et par conséquent calculable. L’énorme travail de ce que j’ai appelé « la moralité des mœurs » - le véritable travail de l’homme sur lui-même pendant la plus longue période de l’espèce humaine, tout son travail préhistorique trouve ici son sens, sa grande justification, quelles que soient d’ailleurs la dureté, la tyrannie, l’hébétude et l’idiotie qui lui sont propres : la moralité des mœurs et la camisole de force sociale ont rendu l’homme vraiment prévisible.» (Nietzsche - Généalogie de la morale, deuxième dissertation : la « faute », la « mauvaise conscience » et ce qui leur ressemble).
A consulter
-
Bonne écriture d'invention, séquence argumentation, Vous êtes critique pour un hebdomadaire culturel. Note obtenue, 7,5/10
- Le 09/02/2019
- Dans Ecritures d'invention. Les écritures au bac de français toutes séries et toutes séquences, poésie, théâtre, argumentation, roman, réécriture, Renaissance et Humanisme
- 0 commentaire

Date de dernière mise à jour : 29/04/2021